Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |
Moteur de recherche interne avec Google |
Violence institutionnelle, frontières mentales
et pouvoir en milieu militant
Préliminaire : La violence institutionnelle, son lien avec la loi, la nécessité du « tiers symbolique ».
C’est par la loi et ses interdits que l’on devient humain.
J’emploie le terme de « loi » au sens général telle que l’utilise l’anthropologie, la sociologie et la psychanalyse, je ne me réfère pas ici à des formes particulières de la loi que j’aborderai ultérieurement. Il n’existe pas de culture sans lois. Ces deux aspects de l’humanité sont indissociables. La culture commence avec la mise en place d’un ensemble symbolique qui règle la hiérarchie des êtres et les relations d’échanges. La loi est primordiale au sens où elle institue le règne du signifiant, de la parole. C’est par ce système symbolique que nous humain(e)s nous accédons au sens, à la signification. La transmission de ce sens se faisait, et se fait encore en partie, par des récits mythiques qui expliquent l’origine et permettent l’avenir des communautés humaines. C’est ce que soutient, entre autres, Levi-Strauss :
« Toute culture peut-être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se situe le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la science, la religion » .
La loi qui nous fait advenir humain est basée sur des interdits : l’inceste en particulier. C’est le premier universel humain, il est de fait le prototype de la notion d’universel. Il existe sous des formes culturelles variées, mais a également l’aspect d’une loi générale. C’est lui qui est considéré comme la base de la culture humaine. Il est basé sur la prise de conscience de la séparation entre l’identique et le différent. Ainsi il modèle la pensée, pousse à l’échange (l’exogamie), il donne une base à la logique . Sous une forme de rituel il installe une instance symbolique qui est le lieu de l’interdit et ce quelque soit les formes particulières dans lesquelles il se réalise. Ce qui ne veut pas dire que l’inceste ne se pratique pas, mais c’est justement parce qu’il n’est jamais acquis définitivement et si tentant qu’il faut insister autant sur sa condamnation.
Deux autres interdits fondamentaux sont l’infanticide et le parricide ou le matricide. Ces deux types de crime ont toujours un statut spécial dans les civilisations humaines. Ils sont dérivés de l’inceste et liés à la reproduction de la structure familiale.
Autres interdits importants à relever : le cannibalisme et le meurtre. Je parle ici du crime intra-spécifique, à l’intérieur de l’espèce humaine, pas de la guerre ou du meurtre politique. C’est à dire que malgré l’interdit « Tu ne tueras point ! », il était possible de tuer facilement en situation de conflit guerrier. Ce qui est toujours le cas. De plus, l’autorité politique ne s’est pas privée d’éliminer physiquement beaucoup de gens sans qu’elle soit condamnée pour autant. Le cannibalisme, lui, est condamné dans sa forme première, le fait de se nourrir de la chair d’un autre humain(e), mais n’est-il pas encore bien vivant dans le fonctionnement du capitalisme contemporain ? Que dire de l’économie d’usure, des pressions sur les salarié(e)s, du pillage des ressources mondiales, etc. ?
Ces interdits ont été véhiculés par la morale et les religions principalement (par exemple « les Dix Commandements » dans le contexte judéo-chrétien). Avec la modernité, la notion de personne a pris plus d’ampleur et la loi humaine s’est enrichie de l’interdit de torture ou d’emprisonnement pour opinion. Sur le plan politique, à partir de l’idée d’égalité, on en est arrivé après bien des vicissitudes à proposer : une personne humaine = une voix. De ce point de vue, les droits de la personne humaine s’inscrivent dans la continuité du renforcement de la loi et de son enrichissement.
Les débats actuels sur la notion de « revenu » ou sur « les sans-papiers » indiquent bien que nous essayons d’aller dans le même sens : une augmentation du respect des personnes et de leurs opinions (ce qui ne veut pas dire que l’on en tienne compte réellement, surtout dans le contexte actuel du relativisme et de l’individualisme). Ce qui est en cause c’est la définition même de l’humain. Que faut-il pour vivre dans cette société ? Une identité, de quoi vivre, donc les papiers et le revenu sont des enjeux qui concerne la loi et son contenu !
On peut résumer ce tableau historique (certes un peu trop succinct) comme une tendance vers la fin de la maltraitance des corps. C’est ce que constate Foucault dans Surveiller et punir à propos des brimades physiques. Cette évolution s’accompagne du développement d’un savoir sur l’humain et de la mise en place d’un appareillage social de contrôle. L’augmentation du poids du mental dans la vie sociale a comme corollaire la domination mentale. Cette tendance est visible surtout en Occident. Ailleurs la façon dont sont traité(e)s les opposant(e)s est souvent violente pour les corps et vise bien la destruction des êtres physiquement. Il faut nuancer le constat parce que, dans le contexte de déréglementation actuel, la barbarie possède à la fois un visage soft et un visage très hard, même si on ne torture plus ou si l’égalité est proclamée. La destruction des humain(e)s continue dans des modalités toujours plus sophistiquées mais qui sont toujours aussi brutales . Car il s’agit encore et toujours de contrôler les corps, le concept de biopolitique rend bien compte de cela. Ce sont tous les aspects de la vie (corps et esprit) qui sont pris dans les filets de la domination capitaliste. Ce qui a changé ce sont les moyens, ils sont plus complexes et techniques, moins directs, presque invisibles. C’est ce constat qui est à la base de la notion de domination mentale. Le contrôle des esprits permet de domestiquer les corps en préservant l’illusion de liberté des individu(e)s. De ce fait on peut se demander si la domination n'est pas de plus en plus mentale, les technologies qui sont mises en oeuvre pour contrôler l’opinion, l'information, influencer le sens commun et clore les débats sont devenues suffisamment efficaces pour éviter à la domination de toujours avoir recours aux CRS. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y pas un aspect militaire et policier dans l’exercice du pouvoir, mais la surveillance et la répression semblent complémentaires des procédés de manipulations mentales développées par le spectacle. Ils atteignent une puissance nouvelle qu'il nous faut prendre en compte. Tout le monde se croit libre et pourtant tout le monde fait la même chose, ceci devrait nous étonner. Encore une fois l'étude de la servitude volontaire, la servitude libérale est à l'ordre du jour.
La double articulation du symbolique :
Pour expliquer le fonctionnement de la loi, on peut se référer à la thèse d’Edouardo Colombo sur la complémentarité de loi familiale et de la loi sociale (patriarcale et étatique). C’est une articulation entre la sphère privée et la sphère sociale, une double articulation du symbolique . On peut remarquer à la fois une continuité et une séparation entre les sphères privées et publiques. Du côté personnel, il s’agit d’une transmission et d’une intériorisation des normes, des valeurs, par l’inscription dans un système relationnel et l’accès à l’ordre des significations par l’acquisition du langage ; du côté de la société, il s’agit de la prise de conscience d’un fonctionnement collectif et d’un rapport de force social. Suivant les analyses, on peut insister plus ou moins sur l’individu(e) ou sur la société.
La difficulté c’est que la loi c’est à la fois la loi du « nom du Père » (nommée ainsi par la psychanalyse freudienne et lacanienne puis par Pierre Legendre à sa suite ) et la loi de l’État. Lacan dans la dernière partie de son oeuvre évoque la possibilité de se passer du père, ce qui ouvre des perpectives assez novatrices puisque la place du père peut être occupée par une autre personne. Cette position atténue fortement l’obligation d’une liaison entre le lieu de l’autorité et la forme autoritaire de son énonciation. D’autre part, ceci permet de comprendre pourquoi la loi qui énonce l’interdit prend autant de formes différentes dans les civilisations humaines.
Souvent, les théories philosophiques ont essayé de trouver une origine divine ou transcendantale à cette loi, mais aujourd’hui plus rien de tout cela ne résiste aux critiques. Celles-ci tendent à montrer en premier lieu le caractère construit de la notion de loi, et, d’autre part, qu’il est nécessaire de renforcer régulièrement la croyance dans cette loi pour qu’elle fonctionne correctement. L’absence de fondement est clairement démontrée, par exemple, à propos de la notion de « loi naturelle » et du « droit naturel » qui sont deux nominations abusives d’un processus culturel. Les discussions sur le fondement du droit font toujours appel à des choix idéologiques. Aujourd’hui, le contexte idéologique post-moderne renvoie toutes les théories dos à dos. Il ne reste que l’état de fait et l’intérêt individuel ou étatique : le rapport de force et le cynisme. Certaines approches se réfèrent au seul droit positif avec la notion de texte supérieur ou de loi suprême dont découle tout l’édifice juridique. Dans ce cadre, c’est ce texte qui contient les principes et ce qui importe c’est le fonctionnement du droit pas son fondement.
La violence institutionnelle serait donc, en partie, ce qui institue l’humain par la violence de l’interdit, la loi. D’un autre point de vue, Leroi-Gourhan arrive à la même conclusion. A propos de l’outil et du langage, il parle de « la mise hors de soi » ou de « prises de distances » :
« Toute l’évolution humaine concourt à placer, en dehors de l’homme ce qui, dans le reste du monde animal, répond à l’adaptation spécifique. Le fait matériel le plus frappant est certainement la « libération » de l’outil, mais en réalité le fait fondamental est la libération du verbe et cette propriété unique que l’homme possède de placer sa mémoire en dehors de lui-même, dans l’organisme social. »
L’institution a toujours été un outil de domination.
Le caractère conventionnel de la loi réelle est facilement mis en évidence, sa relativité dans l’espace et dans le temps est indéniable. Par contre, on constate aussi sans grandes difficultés que la loi a toujours été conjointe d’un système de domination (loi machiste des pères et loi de l’institution collective : royauté, État). Celle-ci justifie toujours l’inégalité sociale.
La forme prise a été le moralisme si souvent critiqué. Les débats sur la morale ont fait dire au début de ce siècle à Paul Rée que la morale était une nécessité pour la vie en société et que la notion de bien et de mal étaient des subterfuges sans fondements. Ce qui était une énonciation assez scandaleuse à l’époque, il prenait Kant à contre-pied et bousculait ainsi le bel édifice de la philosophie classique qui essayait de fonder la morale et de défendre l’existence d’un sujet libre, conscient et volontaire.
Si la loi humaine est résultat d’une décision, son contenu peut être évalué. C’est ce qu’avait déjà mis en évidence Rousseau avec son « contrat social ». La question de la définition de ce contenu fait débat, et c’est un enjeu majeur de la politique aujourd’hui. Face au vide et à l’absurdité de ce monde, à la prégnance de l’argent, de la marchandise et du spectacle, on se prend à rêver d’égalité et de justice assez vite et de possibles décisions politiques.
Il est possible de distinguer deux types de violence institutionnelle :
1/ Celle de la domination citée plus haut,
2/ Celle que nous inventons et utilisons dans nos structures militantes et alternatives où la loi existe aussi : on n’y fait pas n’importe quoi. C’est entre autres par la structure organisationnelle que nous nous instituons comme sujets politiques, ce qui nous permet d’agir collectivement, de construire une puissance politique en vue de la transformation sociale et politique.
La loi existe dans la militance.
La question éthique en milieu libertaire est un souci important et provoque toujours des débats très forts. La liaison entre le contenu de la loi et l’éthique est évident, car il s’agit de savoir ce qui est bien ou mal au niveau individuel et collectif.
C’est bien au nom d’une loi que nos interdits et nos condamnations s’exercent. Même si on n’emploie pas toujours le mot « loi », on y préfère en général le mot « politique ». Il y a régulièrement des évaluations, des jugements sur les activités, les comportements, les thèses.
De plus, en milieu militant on peut aussi constater des évolutions : la sensibilité, l’attention aux problèmes de l’écologie, du féminisme ou de l’homosexualité n’a pas toujours eu cours de la même manière qu’aujourd’hui.
La nécessité du « tiers symbolique » (nommée ici loi) pour devenir humain et pour la construction de l’humanité est fondamentale. Même si on sait aujourd’hui que trop d’institution tue le sujet, il faut réaffirmer qu’il n’existe pas de sujet sans institution.
Ceci est valable aussi pour la militance. Mais une fois cette nécessité constatée, nécessité pour la vie en commun (l’être ensemble des philosophes, la vie sociale pour les sociologues), nécessité pour accéder à l’ordre des significations par le langage (les structures du langage pour les linguistes et l’étude du psychisme humain pour les psychologues), il faut ensuite remarquer que le contenu de la loi réelle est questionnable et n’est pas complètement identifiable à la loi symbolique, que le contenu de la loi réelle peut se discuter. C’est pour cette raison que se justifie l’étude des règles ou lois pratiques pour évoluer dans un sens plus conforme aux besoins de l’humanité. Souvent, les libertaires affirment ne pas avoir de règles ou de lois, mais leurs façons de condamner prouvent qu’ils ont des valeurs, des éléments de référence pour argumenter leurs jugements. La règle ou la loi peut être exprimée clairement ou restée en partie non-dite et inconsciente. Il est important d’examiner nos règles et nos lois pour en comprendre la nécessité, savoir qu’elles existent, comment elles fonctionnent, mais aussi pour les évaluer, juger de leur bien-fondé et éventuellement les faire évoluer dans un sens qui nous conviendrait mieux ou conviendrait mieux à l’idée que l’on se fait de l’humanité. C’est pour cette raison que nous allons essayer d’étudier quelques points significatifs de notre militance.
I / L’existence de frontières mentales
Le point de départ vis à vis de cette notion, pour moi, a été l’analyse de D. Bigo sur l’État de population. La question du danger et de l’identité rend la question des modes de vie et de la culture très sensible. Pour surveiller l’ennemi potentiel, il faut le définir et mettre en place une suspicion généralisée des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Dans un contexte de pluralité des mondes, il n’existe pas seulement des frontières physiques, mais aussi des frontières spirituelles, des frontières culturelles et symboliques. Le différentialisme culturel au service de la séparation permet en partie de justifier l’apartheid social. Ne sommes-nous pas là face à de nouvelles variétés de la biopolitique ? En effet, la gestion des populations devient importante pour la domination et sa reproduction. Dans ce cadre, la frontière devient aussi mentale et la mondialisation accentue le phénomène.
La question de l’identité est difficile et le thème du danger devient central dans les préoccupations de nos sociétés. Les États de population impliquant de définir et de surveiller les populations dangereuses ou potentiellement dangereuses, pour remarquer la différence on s’appuie sur le faciès et les comportements, les habitudes de vie, les façons de s’habiller ou de parler, de faire la fête. On se place face à une norme et un racisme diffus, mais puissant qui donne un contenu culturel à notre supériorité. La domination due au système est aussi mentale et passe par l’individu(e), par son adhésion et son conditionnement, celui-ci se croit libre et différent(e) alors qu’il ou elle est comme tout le monde et se décline à l’identique de façon illimitée.
Si on porte le regard sur nos pratiques politiques et associatives ou syndicales, ne sommes-nous pas normatifs dans notre façon de militer, de développer des identités, des formes symboliques, des ensembles culturels ?
Les chapelles militantes sont nombreuses, le sens commun militant d’un groupe, d’un courant tend souvent à discréditer les autres façons d’être en politique. Les apports critiques venant de l’extérieur (ou de l’intérieur) sont assez difficiles à accepter. Les systèmes idéologiques de la militance sont en général peu ouverts.
Exister par la différence, c’est aussi valable pour nous. Le besoin d’identité et de sens dans un monde vide et absurde est très fort. La politique donne une bonne image de soi et un sentiment de différence par rapport au commun des mortel-les, ce qui nous permet d’accéder à la valorisation symbolique. La militance est un des moyens d’atteindre une certaine « auto-réalisation », un « auto-accomplissement de soi » que nous interdit le système capitaliste et sa machinerie sociale complexe. C’est un des points que soulève Human Bomb dans La société industrielle et son avenir, où il se livre à une critique acerbe du « progressisme » militant. Cette critique, nous ferions bien de l’intégrer et de la tourner sur nous-mêmes avant de proclamer si fort que nous sommes révolutionnaires. Si nous militons, c’est aussi pour exister pour nous-mêmes et pas seulement comme trop souvent on voudrait le faire croire pour les autres. Ceux et celles pour qui nous prenons fait et cause sont souvent d’excellents prétextes à nos besoins existentiels .
L’individualisme et les affinités électives sont complémentaires.
Les affinités électives existent en lien avec l’individualisme qui est à la base de la société. Je n’emploierai pas le terme « néo tribalisme » développé par Maffesoli . Il ne me semble pas adapté au contexte post-moderne. La tribu on ne la choisissait pas, c’était une communauté basée sur les liens de sang, même si le terme est élargi et employé dans un sens métaphorique, ce n’est pas tout à fait de cela qu’il s’agit pour nos pays. Les affinités électives, les communautés, nommées néo-tribus, existent parce que l’individualisme est très fort et que les personnes se sentent isolées les unes des autres. Le besoin de se regrouper en communautés éphémères, où le plaisir lié au copinage est la base du regroupement, c’est une nécessité complémentaire de l’individuation capitaliste. On peut illustrer notre propos par l’exemple de la danse actuelle où les individu(e)s se côtoient sans se toucher. La communion collective passe par la présence dans un même lieu et par la technique qui permet l’écoute de la musique. Dans les danses tribales des sociétés primitives, l’individu(e) ne s’exprime que comme partie d’un tout, voire du cosmos, il, elle appartient à la communauté. La danse, dans ce cadre, est partie intégrante d’un rituel collectif.
Il faut également souligner l’importance des mythes dans les tribus. La légitimation passe par un récit qui fonde la vie commune. Dans le contexte post-moderne la fiction n’a plus le même rôle ; on peut considérer que la fiction c’est le « monde » lui-même, il est construit par les médias et le sens commun de la pensée dominante. D’autre part, il existe un bricolage idéologique important au niveau personnel, les personnes ont tendance à se faire elles-mêmes leur formation intellectuelle ou idéologique avec ce qu’elles ont à leur disposition ou trouvent sur leur chemin, dans leurs rencontres. La constitution des opinions est conjointe des circuits de vie, de l’existentiel.
Dans le même temps, il est facile de constater que les humain(e)s bougent beaucoup dans leurs façons de s’associer, la rotation, le turn-over est réel et massif. Une autre caractéristique de notre situation, c’est la pluralité des mondes et l’absence de circulation ou le peu de circulation d’idées ou d’informations entre les mondes (sauf par l’intermédiaire des grands médias qui s’adressent à toutes et tous indifféremment). Les personnes humaines bougent, sont nomades, mais la pensée des « mondes » organisés évolue peu, les représentations restent assez stables. On voit bien comment sont liées pouvoir et représentations, la domination maîtrise les énoncés, le pouvoir tient le miroir. La maîtrise des images identificatoires est une des clés de la domination au niveau idéologique.
Les mondes militants sont souvent liés à des réseaux et à des domaines de luttes particuliers : Immigration, droit d’asile, tiers-mondisme et solidarité internationale, chômage et précarité, syndicalisme, antifascisme, lutte des femmes, écologie et anti-nucléaire, antimilitarisme, luttes contre le centralisme nationaliste, squats, luttes dans le domaine culturel, etc. Les frontières existent dans la militance et entre les militances, mais aussi entre les mondes associatifs, les mondes culturels, les mondes sportifs, les classes sociales, les quartiers, les régions, les générations, etc. L’atomisation et le particularisme identitaire sont deux aspects de la domination contemporaine, une conséquence de ce que Deleuze et Guattari nomment déterritorialisation.
Peut-on échapper aux institutions totales ?
Cette définition convient bien pour les associations ou regroupements qui incluent la militance dans beaucoup d’aspects de la vie, toute la vie ou presque est concernée. On lutte ensemble, on milite ensemble, mais on boit aussi des coups ensemble, on cause, on mange ensemble, on chante, on fait la fête, les activités ludiques se conjuguent au militantisme, des relations affectives fortes se nouent, on est bien ensemble, toute déchirure prend un aspect dramatique, etc. Cette notion a été évoquée par certaines personnes pour décrire le Gasprom et ses difficultés (il s’agit de l’Asti de Nantes où certaines tensions sont apparues, entre autres, en Décembre 1997 et Janvier 1998. C’est une association dont j’ai été membre pendant longtemps, son but est la solidarité avec les étrangers). Les relations humaines et affectives ont brouillé si fortement le débat politique que beaucoup de gens disent n’avoir pas compris ce qui s’est passé et sont incapables d’examiner rationnellement le fait qu’ils et elles ont voté une motion préconisant l’unité avec la social-démocratie au pouvoir.
Cette hypothèse d’institution totale semble valable pour un certain nombre de nos regroupements militants. Il semble bien que ce genre d’institution totale corresponde aux besoins des personnes pour exister dans un cadre collectif et ce dans le contexte de la post-modernité où l’individualisme et affinités collectives sont la règle.
Les frontières mentales et les territoires organisationnels sont à relier aux constats suivants :
1 / Il est très difficile d’exister de façon autonome et originale dans cette société. Ce phénomène a été décrit dans l’Homme unidimensionnel de Marcuse, il est également évoqué par l’Homme sans qualités de Musil.
2 / Les organisations se sentent propriétaires des idées et tendent à perdurer pour elles-mêmes comme toutes les institutions. C’est pourquoi l’aspect identitaire est si important dans les groupes.
En cas de conflit, la violence des mises à mort symboliques est réelle. Le maintien des frontières mentales peut conduire à la mort mentale si le flux des idées se tarit ou si l’organisation fournit seule le prêt à penser et le cercle des relations humaines.
II / Le pouvoir en milieu militant :
Ce sujet est rarement évoqué, il est même plutôt tabou. J’ai déjà abordé ce thème dans deux textes :
« Comment devenir un bon dirigeant politique en 10 leçons ? » en Juin 96.
« Est-il possible de vivre en paix avec la chefferie militante ? » en Janvier 98 (publiés en annexe).
A chaque fois, le contexte était difficile dans la militance locale et c’était un moyen pour moi de tenter de m’en sortir et d’essayer de poser publiquement le problème. Ce qui s’est passé depuis me renforce dans la conviction que la question vaut toujours le coup d’être soulevée ici ou là-bas, hier comme aujourd’hui et sans-doute encore demain.
Le pouvoir prend de multiples formes.
Le plus courant dans la pratique militante c’est le pouvoir charismatique, mais il peut être aussi organisationnel, informationnel, machiste, ethnique, urbain, générationnel, centraliste, financier, technique, parisien, symbolique. Dans ce domaine on peut observer le poids important de "l’Aura" acquise par la participation à des événements historiques voire mythiques comme 36 en Espagne ou Mai 68 ; on peut également vérifier le prestige dû à la position d’intellectuel reconnu ; la valeur de l’origine sociale, la classe ouvrière en particulier ; l’autorité que confère l’origine familiale par le lien avec les grands ancêtres ; le respect que procure le fait d’avoir été victime de la répression, etc. Tout ceci donne un label difficile à contester, parfois même incontestable.
L’argument d’autorité n’a pas qu’une seule forme. L’existence de féodalités dans le milieu libertaire n’échappe à personne et personne n’en parle évidemment. Si on en parle, c’est en catimini, et ceci ne fait qu’amplifier le malaise. Etonnant comment au nom de la « cause » on fait silence !
La solidarité entre les pouvoirs et le machisme semble bien être une des caractéristiques majeures de cet aspect de notre vie militante.
Pour s’en rendre compte il suffit d’observer nos moeurs avec un tout petit peu d’attention :
Qui dirige dans les groupes politiques ?
Qui parle dans les débats ?
Dans les initiatives militantes et les réunions qui prend majoritairement les notes ?
Le rapport à « la » vérité cause de bien des soucis :
La question de la vérité est un enjeu puisque c’est en son nom que l’on dit avoir raison et que les autres sont des mauvais(e)s. Mais qui détient la vérité en politique ?
La volonté de vérité est suspecte nous a enseigné Nietzsche, la posture des partis peut être comparée à celle des prêtres dénoncée par ce fou illuminé de poésie : le ressentiment. Zarathoustra énonce que Dieu est mort, le monde est désenchanté et nous sommes condamné(e)s à vivre dedans. Toutes nos tentatives de l’enchanter à nouveau sont vouées à l’échec. La clôture sur « l’un » que véhicule la notion de parti ou d’organisation est une figure de la prétention à « la » vérité.
La position des humain(e)s qui pensent être porteurs de la vérité leur permet de transformer leurs croyances en certitudes. Être porteur de la vérité donne le droit de se sentir dans la bonne position et d’avoir le beau rôle. Le passage de la théorie à la pratique est facilité parce qu’on a raison. La vérité est un bien précieux qu’il faut garder à tout prix quitte à construire des délires pour s’arranger du réel.
Il faut se poser la question, à mon avis, de savoir si on ne confond pas trop souvent sujet et organisation comme sur le plan personnel on confond si souvent individu(e) et sujet . Le sujet peut être individuel ou collectif de temps en temps. Croire que le regroupement politique est toujours un sujet est un leurre qui est dangereux. D’autre part, le souci de pureté est également nuisible, il permet l’exclusion, l’isolement dans une position élitiste et méprisante pour les autres. L’organisation est une variété d’institution qui a ses exigences propres, elle aussi a besoin d’un système de pouvoir et d’obéissance afin de fonctionner et de continuer quels que soient les aléas de la vie politique. Au contraire le sujet est lié au désir, ce qui donne un fonctionnement très différent ne visant pas la durée, mais la satisfaction du désir de liberté, d’égalité et de justice.
Le fonctionnement autoritaire et sectaire chez les libertaires est assez courant même si ce n’est pas admis ouvertement. La question du respect des personnes n’est pas souvent abordée, elle ne semble pas faire de difficultés quand tout va bien, mais en cas de désaccords et de rejet, le respect peut faire problème. Les disqualifications, la mise en place de procès existe souvent, même si ce n’est pas dit comme cela, mais on demande des comptes et on invective assez facilement. Le discrédit cours vite, comme la rumeur, il fonctionne à l’ambiance, son efficacité est redoutable .
Quand je parle de violence institutionnelle en milieu militant, je nomme ainsi ce qui institue par le regroupement collectif le sujet politique, ce qui définit et transmet le contenu de la règle, de la loi. Parfois celle-ci n’est pas explicitée complètement, mais son existence est indéniable. En milieu militant on ne fait pas n’importe quoi au risque de critiques très virulentes ou de processus d’exclusion et de condamnations violents. Il faut mettre cela en rapport avec les problèmes existentiels qui sont à la base de notre engagement. La déstabilisation mentale de la personne qui quitte un groupe est réelle et forte, la destruction psychique et la castration mentale peuvent être au bout du chemin militant. On se rend compte à ce moment là qu’il est difficile au sujet d’exister hors du groupe, hors de l’institution totale. Si on veut permettre l’autonomie réelle des personnes et l’existence des sujets politiques, il me semble nécessaire de plaider pour plus de souplesse dans notre vision de l’engagement et dans notre façon de concevoir les organisations.
La question de la croyance n’est pas réservée aux sphères religieuses, elle nous concerne aussi. Notre besoin de certitude, notre désir de croyance, d’absolu et de pleinitude existe et est inclus dans notre fonctionnement mental individuel et collectif. La croyance ne se donne pas comme telle, elle est incluse dans un ensemble dit de vérité où la cohérence fait bloc pour légitimer une idéologie, même si dans cet ensemble d’idées il existe de nombreux points de savoir déjà démontrés et vérifiés. Le fait de questionner un petit point de détail de cette vérité peut mettre en danger l’ensemble de la théorie, ce qui explique la violence des réactions devant la mise en cause de cette vérité et les accusations de trahison si couramment employées dans nos milieux. Si cette affirmation semble trop forte, il suffit de se rappeler, par exemple, les mots employés lors de la scission entre les deux CNT. C’était il y a quelques temps en France, ce phénomène n’a rien d’exotique. On peut m’opposer le caractère exceptionnel de cette situation, mais, pour ne citer que deux autres cas récents et connu(e)s d’un grand nombre de personnes dans la mouvance libertaire : Que dire des débats autour de la mobilisation contre la tenue du G7 à Lyon ? Comment appréhender les déchirures lors du mouvement des chômeurs(euses) et précaires sur la notion de radicalité au début de 1998 ?
Je ne pense pas qu’il existe une position plus éclairée qu’une autre, puisqu’il n’existe pas de position de vérité absolue. Ce qu’il est possible d’encourager c’est l’attention au doute et à la confrontation, à la curiosité, à l’ouverture qui peuvent tempérer ce genre de dérapage et de clôture .
III / Le multiple :
Il se constate facilement avec la :
- Multiplicité des bases de la révolte.
- Multiplicité des formes de révoltes.
- Multiples lieux et multiples subjectivités.
- Multiplicité des approches critiques. Pour développer les théories critiques il faut confronter les écoles, les niveaux humains (psychologie, sociologie, psychosociologie, langage, histoire, économie, cultures, idéologies, mentalités, etc.), les courants d’idées, etc.
En conséquence, il est donc nécessaire de favoriser les transversalités, les échanges, de ne pas hésiter à citer ses sources, même si elles ne sont pas orthodoxes ou si elles viennent de la bourgeoisie (universitaire ou non), d’accepter la pluralité, la multiplicité des démarches en acceptant la discussion raisonnée et de dépasser les frontières mentales trop étriquées de nos organisations respectives.
Toute approche particulière montre ses limites si on la pousse jusqu’au bout. Le développement maximal de chaque théorie critique met en évidence qu’elle contient un aspect erroné. Chaque discipline intellectuelle a besoin d’être complétée par d’autres approches. Pour illustrer notre propos, on peut prendre l’exemple en philosophie des thèses qui défendent la primauté de l’idée sur la matière, thèses qui ont conduit certains penseurs à affirmer qu’il n’existait que de l’idée et que les choses n’existaient que si on les pensait, ce qui est absurde. A l’inverse certaines écoles de pensée affirment la priorité de la matière sur l’idée et refusent tout rôle important à l’idée (donc à la culture, au symbolique et à l’idéologie), ce qui est aberrant. Pour donner un autre exemple, on peut partir de l’individu(e) et dire que tout passe par lui et minimiser ou nier les phénomènes sociaux (ce que font certaines théories psychologiques). On peut aussi insister de façon outrancière sur le fonctionnement collectif et dénier toute importance aux problèmes personnels (ce que faisaient certaines variétés de marxismes et font encore certaines théories sociologiques).
IV / Le rapport moyens / fins
On constate facilement qu'au nom d’un idéal on peut parfois faire n’importe quoi. Il est possible de devenir un soldat au nom du collectif (le guerrier du Service d’Ordre par exemple), de manier la violence sans état d’âme contre les faschos, les flics parfois, de temps en temps contre le P.S., mais aussi contre d’autres organisations si nécessaire. On peut le constater à Nantes ou à Paris.
Souvent, la fin est censée justifier les moyens. Comme si, en s’identifiant au collectif, on avait le droit d’employer la violence, d’être sectaire, d’user d’autorité. La fin ne se discutant pas, il n’y a pas d’autorisation à demander avant d’agir ni d’examen à posteriori. Pourtant, en suivant le conseil de Foucault, l’étude peut porter sur le pourquoi mais aussi sur le comment. Dans ce cadre, le lien avec la notion de vérité est à noter. En son nom les moyens sont considérés comme légitimes, si on détient la vérité il n’y a pas de raison de se poser des questions ou d’accepter les critiques. Le passage à l’acte est autorisé par la possession de la vérité.
Mais comment avec des moyens violents, sectaires, autoritaires peut-on prétendre aller vers une fin libertaire ?
Je considère, comme beaucoup d’autres personnes, que les moyens sont constitutifs des fins.
Les fins sont rationalisables et rationnelles, on peut en débattre collectivement. Mais les moyens sont humains et (parfois, souvent, tout le temps ?) que peu rationnels (affectivité, désirs, peurs, sensibilité, aspects identitaires, croyances, opinions, mythes, besoins existentiels, imaginaire, etc.) et, là, il n’y a pas beaucoup de débats. Si le débat existe, il se focalise surtout sur la période révolutionnaire, pour ma part je parle d’aujourd’hui, en particulier des rapports entre personnes militantes ici et maintenant.
Encore une fois il me semble fondamental de promouvoir la sortie de la violence. Comment dialoguer et échanger des idées si l’insulte et les coups font office d’arguments ? Il est quand même étonnant que des personnes qui s’affirment libertaires et disent vouloir libérer l’humanité de l’oppression soient incapables d’admettre les règles de base de ce qui est censé définir la civilisation. Ce sont les conditions mêmes du débat qui sont en cause : l’accès à une parole universelle. Ceci peut sembler anodin et désuet pour les grand-es révolutionnaires que nous sommes, mais les événements récents montrent que ceci doit être réaffirmé.
V / L’universel
Après avoir souvent constaté que ce qui est valable pour les autres n’est pas valable pour soi, je pense que la notion d’universel est à rediscuter. Si on accepte cette modalité d’être, c’est le règne du particulier, ce qui rend impossible toute discussion raisonnée et détruit toute possibilité d’action collective. Au contraire, je pense qu’on peut accepter une version simple de l’universel où les mots ont le même sens pour tout le monde ou à peu près. Je ne refuse pas la polysémie, je n’oublie pas la coupure entre le signe et le contenu, mais un minimum de cohérence me semble indispensable. D’autre part, je pense que les critiques sont valables pour toutes et tous indistinctement, donc y compris pour les personnes ou les groupes qui les énoncent. C’est une condition de base pour faire de la politique et intervenir dans le champ collectif. S’il y a divergence sur le sens des mots, des idées le débat démocratique doit être ouvert et on doit essayer de préciser l’acception que l’on emploie. Je pense que c’est une nécessité de situer qui parle et d’où on parle.
VI / Au multiple et aux moyens constitutifs des fins s’opposent les frontières mentales et « l’un » organisationnel :
La question du « tiers institutionnel » est sans cesse ramenée sur l’autorité humaine pratique et structurelle : organisations et chefferies, État et pères en tout genre. Mais on ne devrait pas oublier son origine et sa valeur, elle est imaginée et symbolique, donc « sur-humaine ». Elle permet la constitution de l’humain, mais n’est pas qu’humaine au sens où elle est une fiction nécessaire pour qu’advienne l’humanité, une condition de possibilité de l’humain. De ce point de vue elle a un aspect extérieur à l’humanité. En même temps on ne peut pas la séparer de l’humain, en effet d’un autre coté elle n’est pas complètement externe à l’humanité, car sans la loi celle-ci ne serait pas devenue ce qu’elle est. On le constate la loi est un effet, un acquis de la culture, sa source c’est l’humanité. Cela dépend du point de vue d’où on part : l’humanité comme espèce ou l’humanité comme culture, mais on voit bien qu’il soit délicat de séparer les deux. Il est également important de remarquer que cette fiction nécessaire (le « tiers symbolique ») n’est jamais totalement accessible :
- Elle est en partie le résultat des luttes passées et fruit de l’évolution historique.
- Son contenu culturel est large et pluriel, c’est à dire ne nous appartenant jamais complètement.
- La présence des aspects mythiques est indéniable.
- Le fonctionnement du récit a un rapport avec la croyance.
- Cette fiction est construite socialement.
- La coupure signifiant - signifié, signe - contenu rend impossible l’énonciation totalisante.
- La relativité des cultures est réelle, etc.
C’est pour cette raison ou ces raisons que l’étude des modèles est si fondamentale et que je plaide pour plus de rigueur théorique et de souplesse organisationnelle afin que la transversalité puisse se mettre en oeuvre et soit féconde.
Ce qui fait difficulté ce sont les modèles dans lequel l’existentiel militant se réalise. En fait il n’y a pas ou peu de débats de fond sur les références théoriques ou les buts généraux, le communisme libertaire ou la révolution ne font pas problème en eux-mêmes. On peut d’ailleurs facilement constater que les grands buts humains sont nécessaires pour justifier le sacrifice à la cause, pour rationaliser la soumission militante. Ce qui est en question, encore une fois, c’est la tactique et la stratégie, la vie militante et existentielle au quotidien.
La voie libertaire en visant l’autonomie, l’auto-institution humaine sans hiérarchie, l’auto-organisation, nommée si souvent autogestion, reste un idéal difficile à atteindre.
La réflexion des libertaires se porte donc toujours sur le contenu des idées et sur le fonctionnement, sur le pourquoi mais aussi sur le comment qui éclaire autant et parfois beaucoup plus. C’est à dire que je pense qu’il est possible et nécessaire de jouer sur le décollement possible entre le tiers institué et l’instituant, sur l’écart entre les idées de référence si belles et la réalité militante si froide et si triste. Cet écart permet de critiquer la discordance entre les idées et les actes, mais il peut également être utilisé pour évoluer vers une meilleure cohérence.
Comme pour la loi, on ne peut identifier totalement la personne qui dit la loi et la loi elle-même. Il est nécessaire de permettre la variation, la création par le jeu sur l’écart possible.
Si les personnes militantes s’identifient totalement à leur organisation, il y a une difficulté, le « soi » est fait de culture et de politique, mais pas que de cela. D’autre part, il faut bien que l’organisation serve le « moi » de la personne militante à un moment ou à un autre. L’étude du don et du contre-don montre qu’il y a nécessité d’un retour, d’une circulation de la valorisation symbolique et de l’amour en compensation du sacrifice militant. Qui n’a pas joué à Zorro dans la solidarité et l’entraide ?
Pour essayer de modéliser le fonctionnement humain, militant ou non, on peut proposer un schéma où deux triangles représentent les trois pôles où on peut repérer le tiers symbolique si souvent confondu avec le pouvoir et l’institution.
Le pouvoir
La loi des pères, la famille, le miroir
L'État, l'institution
Le tiers symbolique
Les représentations, la culture.
La notion d'humanité (fiction construite)
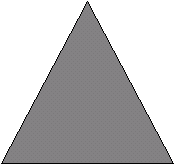

Le réel, la vie, l'humanité pratique
L'image de soi, la conscience de soi
L'imagination, le moi
[Note du gestionnaire du site : Les triangles se chevauchent dans le dessin d'origine]
Le fait que nous puissions faire bouger, faire retour et faire évoluer nos représentations montre que ces deux triangles peuvent se superposer, qu’ils sont généralement collés l’un à l’autre, mais aussi qu’ils ne sont pas identiques. La subversion des images, la création, les hypothèses nouvelles sont notre chance. En ce sens, la politique, au sens de la lutte pour la liberté, l’égalité et la justice, appartient à la sphère culturelle, champ où les représentations peuvent naître et mourir ou se transformer.
Si notre visée n’est pas une visée de pouvoir, mais de liberté, nos actes et nos pensées politiques travaillent partout à la fois et fortement au niveau symbolique.
En conséquence, je proposerai d’être prudent avec la notion de vérité. Le constat de la liaison entre la vérité et la subjectivité suffit à proposer une attitude ouverte où la transversalité permet de prendre de la hauteur, surtout si on admet conjointement la relativité des situations et des approches critiques.
S’élever pour essayer de répondre à la question « qu’est-ce qu’être humain ? » est une nécessité liée à la crise de la militance, crise qui entre en résonance avec la crise de notre civilisation.
C’est à partir de ces questionnements que j’affirme qu’il est impossible de répondre de façon péremptoire à la question de savoir qui est révolutionnaire, libertaire ou non. Qui doit ou qui peut définir le contenu de la notion de « révolutionnaire » ou de « libertaire » ? Est-ce l’organisation dont on est membre, la répression de l’ennemi, les autres structures qui vous reconnaissent comme tel et / ou soi-même par l’auto-proclamation parce qu'on se sent libertaire ou révolutionnaire ?
Nous savons que le fonctionnement individuel s’intègre dans des fonctionnements collectifs et des modèles mentaux qui sont liés à l’histoire sociale. Dans le contexte de crise généralisée où nous sommes plongé(e)s, je pense qu’il est nécessaire d’être prudent sur les jugements de valeur et sur les anathèmes. Il me semble fondamental de tenter de dépasser l’identitaire qui survalorise l’ego militant pour enfin pouvoir sortir de l’atomisation organisationnelle, du séparatisme et de l’éparpillement (à quand une fédération libertaire européenne ?) afin de donner de la force à la politique, identifiée comme lieu de la transformation sociale.
Comment développer sa puissance ou la puissance collective sans opprimer ? C’est une exigence éthique, certes, mais comment supporter d’énoncer de belles idées politiques et des contredire dans la pratique ? Comment vivre notre militance ? restent des questions préoccupantes.
Philippe Coutant Nantes, le 22 Décembre 1998
Ce texte a servi de base à un débat lors du vingtième anniversaire de la librairie La Gryffe à Lyon en Mai 1998. Lors de ce débat la question du machisme chez les hommes militants libertaires a été soulevée. La suite du débat est expliquée dans le texte "Anarchie ou patriarchie" disponible sur cette page :
"Anarchie ou patriarchie"
Ce texte a été retravaillé pour le publication dans la revue Réfractions http //refractions.plusloin.org/