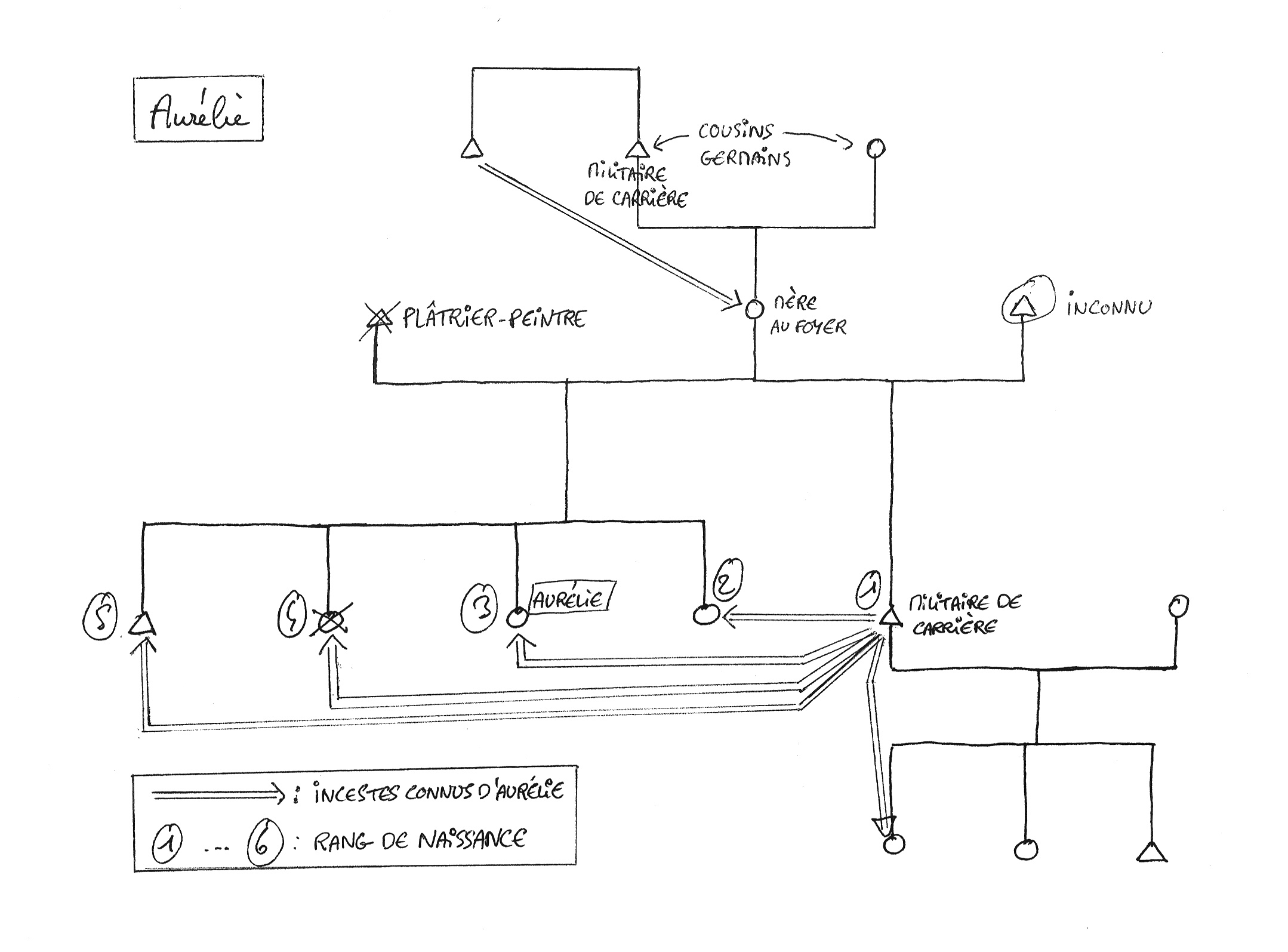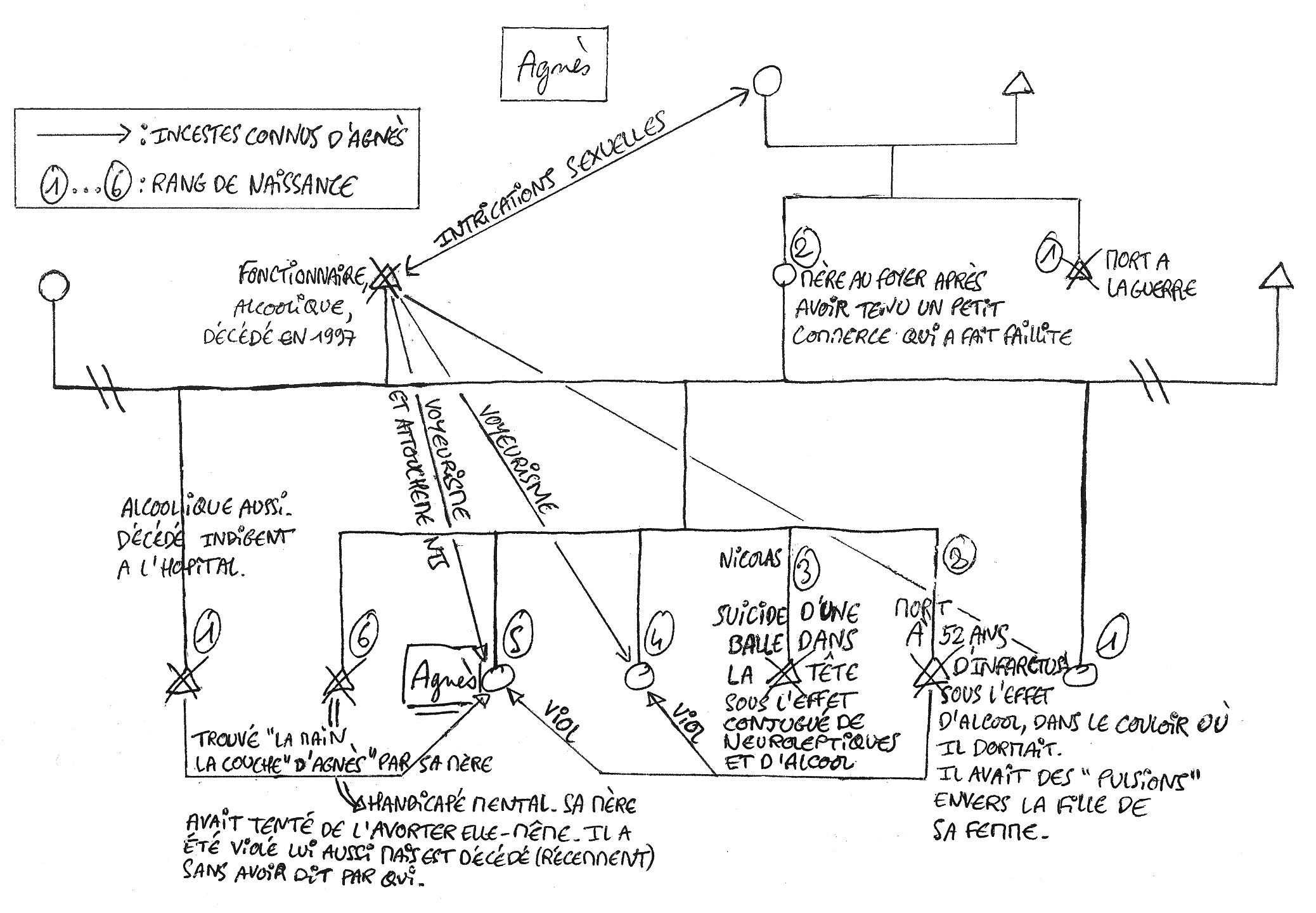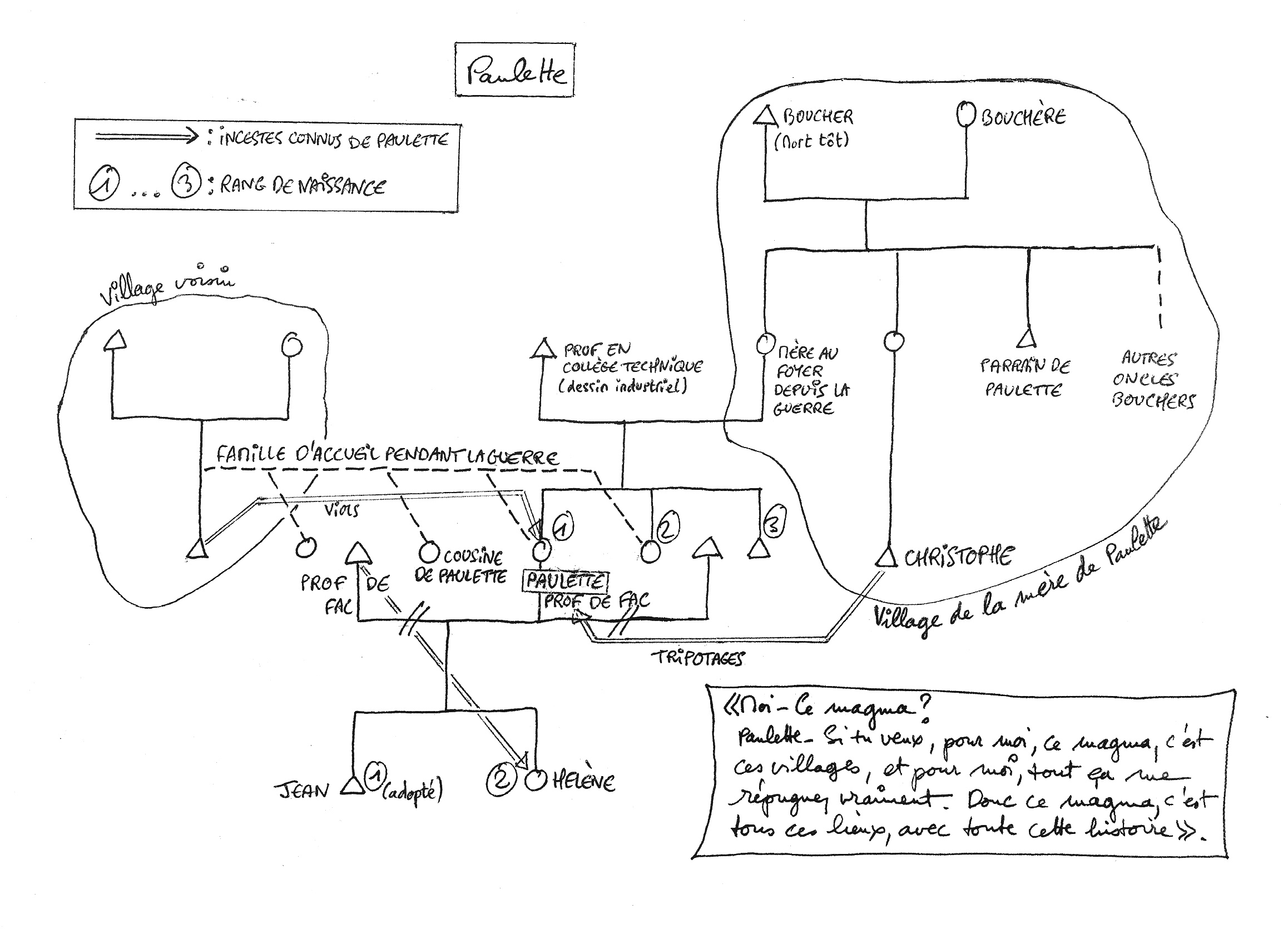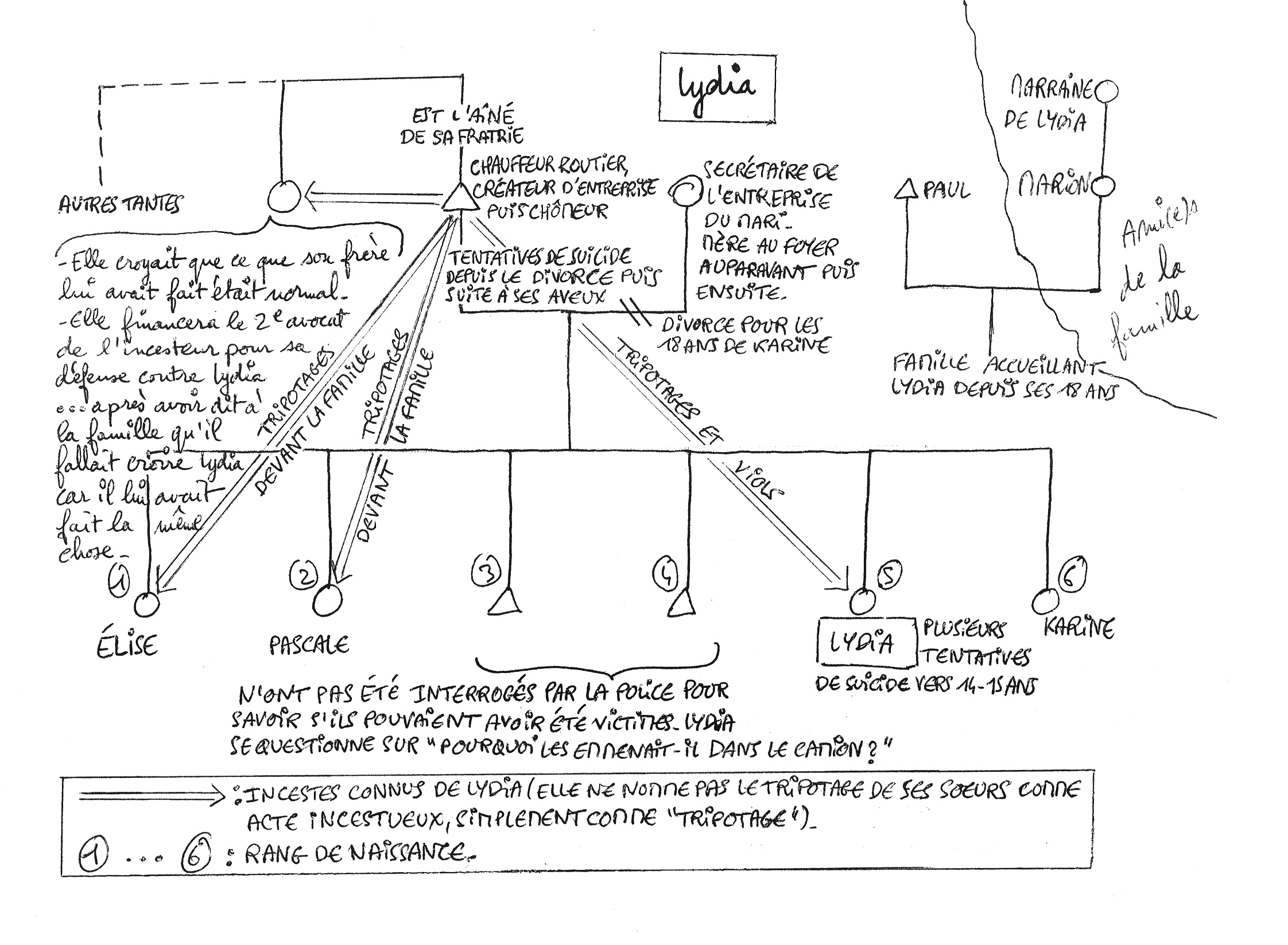Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |
Moteur de recherche interne avec Google |
anthropologie d'une entreprise de démolition systématique de la personne,
France, 20e - 21e siècle,
par Sophie Perrin
|
Origine : http://sophia.perrin.free.fr/memoireM1public.htm SSophie Perrin nous indique comment trouver de l'aide en cas d'inceste et de violences sexuelles http://sophia.perrin.free.fr/telechargement.htm L'inceste : anthropologie d'une entreprise de démolition systématique de la personne, France, 20e - 21e siècle, par Sophie Perrin est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons (P/M)aternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Remerciements Tout d’abord merci à Paulette, Agnès, Aurélie, Danielle et Lydia, sans lesquelles ce mémoire n’existerait pas, ou serait bien différent. Merci de votre confiance, de votre accueil, du temps très conséquent que vous avez consacré à ces récits … c’est beaucoup et c’est important. <Puis à François Laplantine et Axel Guioux, pour avoir dirigé ce mémoire … pour votre patience, votre présence tout au long de ce travail un peu mouvementé. Merci aussi à Marie-Carmen Garcia, enseignante en sociologie, pour la possibilité de présentation en exposé durant son cours, courant avril, des premiers aboutissements de ce travail, et pour ses cours de sociologie, en 1995-1996, à l’université Lyon 1, alors que j’étais en D.E.U.G M.A.S.S, ainsi qu’à Lyon 2 en 2006 et 2008. Merci pour les échanges d’alors et ceux de maintenant, merci pour votre soutien tout au long de mes études en sciences humaines. Merci à Martin Soares, enseignant en anthropologie, pour les échanges de courriels, les moments de discussion … qui souvent ont eu peu à voir avec cette recherche, mais ont puissamment contribué à sa réalisation. Merci à l’ensemble des enseignant/e/s de sociologie anthropologie pour leurs cours. Merci à Jacques Pellegri, ex-directeur adjoint de l’agence ANPE Lyon Opéra. Pour dire ce que je te dois ce mot sera trop court. Merci pour ta présence dans ce bureau en compagnie de notre DRH, à la réputation méritée, présence qui a rendue possible mon embauche alors que j’étais en position difficile, en 2002. Merci pour ton attention durant tout le temps que je suis restée employée à l’Agence. Merci pour m’avoir répondu en 2004, quand j’étais au bord du vide. Enfin, merci pour ta présence et ton soutien lorsque ce mémoire n’était encore qu’un projet même pas écrit. Merci à Yves Laurent, également connu à l’ANPE (via le même syndicat que Jacques). Merci pour ta présence trop brève, ornée d’inoubliables chapeaux, et surtout d’humour et de chaleur humaine. En janvier 2005, Yves, tu as décidé de quitter ce monde. Merci à Léo Thiers Vidal pour ses passages furtifs dans ma vie, pour les écrits qu’il laisse. En novembre 2007, je m’apprêtais à reprendre contact pour discuter ensemble de mon thème de recherche, proche de tes préoccupations. Mais c’est à ce moment-là que toi aussi, tu as décidé de quitter ce monde, devenu trop difficile pour des raisons que tu as emportées avec toi, et qui t’appartiennent à toi seul. Merci à Michel Roche, psychothérapeute, pour n’avoir été ni sourd ni aveugle en 1996. Merci à Bernard, rencontré via le groupe Déjacque, pour sa présence de 1991 à 1996, et pour avoir été, presque, un parent adoptif pour moi. Merci à Jacqueline Allombert, pour ses cours de philosophie, et à Mr Maury, pour ses cours d’Histoire, au lycée. Merci à Plume, chat de gouttière, qui n’est resté qu’un an, en 1986, et à Osiris, également chat de gouttière, là depuis 18 ans. Merci à Mr Grimm et tou/te/s les autres, pour les contes lus la nuit durant les années 80, à Jules Vernes et aux rédacteurs/trices des livres de la bibliothèque verte, pour les aventures dans leurs mondes imaginaires, quand le monde réel était insupportable. Merci à Mme Krispi, institutrice de C.P, qui m’a appris à lire et à … écrire. Merci à Fabien et Violaine pour leur amitié au début des années 1980, dans la classe de Mme Krispi et un peu avant. Ce mémoire est un peu dédié à mon oncle, Jean-Luc Poyet, pour les rues de la ville dans lesquelles nous avons chacun erré nos souffrances durant les années 1990 sans jamais nous y rencontrer hélas. Enfin,
merci aux étoiles pour leur(s) lumière(s), aux arbres pour l’air
qui nous permet de vivre et pour leur beauté. Paroles Courant 2005, un soir, dans un squat que j’ai participé à ouvrir, nous discutons toutes deux autour de la table. Quelques mois auparavant, dans un autre squat, nous avions discuté autour d’une autre table : une plus grande table, d’une dizaine de personnes. Discuté du rendez-vous chez une avocate, d’où je revenais, amère. C’est ainsi qu’elles ont su ce qui m’était arrivé. C’est ainsi que, peu à peu, les mois suivant, plusieurs d’entre elles m’ont fait savoir ce qui leur était arrivé … Et ce soir, autour de cette table plus petite dans ce squat plus petit, cette fille me dit « Sophie, ma mère m’a confié un secret ». Quel secret ? Sa mère a été abusée par un cousin, elle vient de le lui dévoiler. C’est la première fois que cette mère en parle, et c’est à sa fille qu’elle choisit de le faire. Silence. Durant lequel je me souviens de ma famille, de ce que j’en ai appris au fil des années. D’où ma question, d’instinct : « Et … il n’y a pas d’autres secrets, dans ta famille ? ». Dans la mienne, à ma grande surprise, il y en a eu tant, aussi atroces, insoupçonnés tant qu’aucune parole ne venait les éclairer. Elle me répond : « si, il y en a un autre, il me concerne moi, mais c’est un secret pas grave, pas comme celui-là ». Je poursuis : « c’est à dire ? ». Le secret pas grave, pas comme celui-là, c’est sa relation sexuelle avec son cousin, à elle. « J’y prenais du plaisir ». « J’étais consentante ». Enfant, ado. Sensation de malaise, j’entre dans le brouillard par ses propos. Me souviens de ses attaques de panique, de ses malaises, qui me rappellent là, à tort ou à raison, les miens. Consentante. Plaisir. Son cousin a commencé au même âge que celui de sa mère. Etrange cette sensation de malaise que je ressens. Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots. Etrange cette sensation de malaise, de doute, que je ressens. Déjà ressentie auparavant. Où ? Quand ? Quand ma famille me reproche d’exagérer, de mettre le bronx pour rien. Pour rien ? Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots. Consentante. Plaisir. Pas grave. Secret. Les mots. Ces mots … Moi aussi, j’étais consentante, moi aussi, j’ai pris du « plaisir », selon mon incesteur … et longtemps selon ce que je croyais, c’était même moi qui lui demandais ce qu’il me faisait, parce qu’il n’y avait pas de violence, pas de coups, pas de sang autour de ces moments, dans mes souvenirs. Lieu. Une salle, pleine de miroirs, déformants. Renvoient des images. Jamais la bonne. Brouillard. Croire aux images. Images destructrices. Miroirs menteurs : mes cauchemars à moi sont plein de violence, de sang répandu par ses mots meurtriers. C’est un enfer. Pour le secret de cette fille du squat, je ne sais pas. Je sais juste que le « plaisir » peut aussi démolir [1] . Un tas de pierres. Un à un, briser les miroirs. Sortir du brouillard. Sommaire Introduction : étudier l’inceste : quelques raisons d’un choix. 1 I – Panorama et perspectives 1 1) L’inceste : un phénomène important mais peu connu. 1 2) Les travaux existant en anthropologie sur ce sujet 2 3) Mon questionnement et ma problématique de départ 6 II-Méthodologie et questionnements que cela suscite pour l’anthropologie. 7 1) De l’observation participante au récit 7 2) De l’objectivité aux points de vue. 8 III-Obstacles et rencontres 11 3) Mes relations avec le terrain, et ses difficultés (parfois) surprenantes pour moi 11 a. Ma première difficulté : moi 11 b. Ma seconde difficulté : autour de moi 12 d. Une dernière difficulté : la mise au secret des incesté/e/s par leurs proches. 16 4) Présentation des personnes avec qui j’ai eu des entretiens. 17 5) Le cadre et ses garant/e/s légitimes. 18 6) Mais au fait … une étude non psychologique de l’inceste est-elle pertinente ?. 19 IV-Décrire la démolition … et ses suites 21 1) La vie de famille : ouvrons la porte et allumons la lumière. 21 a. « Hitler, je l'avais à la maison ». 21 c. Les rôles des mères : absence de recours et efficacité de la honte. 30 2) Les incestées et les hommes … mais aussi les femmes, et les ami/e/s. 33 4) Incestées et psychothérapies. 39 5) L’inceste : une frontière floue, une hiérarchie des abus ?. 46 6) Victimes d’inceste et Justice. 52 Introduction : étudier l’inceste : quelques raisons d’un choix Un élément fondamental, fondateur de ce choix, est ma situation de victime, moi-même, d’abus sexuel incestueux, dans une famille bien française, de la fin du 20e siècle, en milieu urbain et sans problèmes de chômage ou d’alcoolisme (parents et apparenté/e/s fonctionnaires d’Etat). Dès lors, je ne sais pas si j’ai choisi ce sujet, ou si c’est lui qui s’est imposé à moi. Tout ce que je sais, c’est que c’était celui-là ou rien. Je n’aurais pas pu faire ce premier mémoire sur un autre sujet. Tout autre sujet m’apparaissait en effet futile à l’époque, hormis bien sûr ceux ayant trait aux phénomènes de violence, tels l’excision, ou encore la torture et la répression sournoise et brutale effectuée par les dictatures. Et puis, comme une évidence : on n’en parle pas, ici aussi. Les familles comme ma famille d’origine, cela n’existe pas. Et si cela n'existe pas, je n’ai rien à faire ici. Ou alors, il faut que j’en parle moi, puisque personne d’autre n’en a l’idée, et que j’ai envie de continuer mes études dans cette discipline qu’est l’anthropologie. C’est ainsi que l’idée de ce mémoire a germée… Par ailleurs, je vivais de plus en plus mal le fait d’être considérée, voire de me considérer, comme une « victime » et rien d’autre : autour de moi, les seules personnes reconnues comme expertes du sujet, légitimes à en parler, étaient les personnes spécialisées en psychologie ou du milieu associatif (aide aux victimes, etc). Or par mes nombreuses lectures, souvent compulsives et envahissantes, pour comprendre ce qui m’était arrivé, par mon vécu « à plein temps » d’un univers familial incestueux et violent durant 18 ans (jusqu’à ma majorité), puis en pointillés (et le moins possible) depuis, et enfin par mes recherches personnelles, ce qu’elles m’ont appris peu à peu me concernant, concernant l’histoire de ma famille et la transmission/reproduction de ces violences en son sein, j’estimais avoir moi aussi acquis une certaine … expérience, qui pouvait devenir expertise, au sens de « connaissance reconnue sur le sujet », et mise en discussion parmi celles d’autres personnes. Je voulais donc passer de la situation de simple victime à celle de personne ayant voix au chapitre, pouvant contribuer et apporter à la connaissance de ce sujet. Un premier élément très matériel de cette transformation d’objet de discours en auteure potentielle de discours, fut sans doute, dès ma thématique de recherche acceptée par un enseignant de cette Faculté, le rangement de la littérature, abondante, qui était répartie un peu partout dans mon appartement, sur cette thématique : enfin, elle avait cessé d’envahir mon espace, physique et mental, pour trouver une place plus raisonnable et bien identifiée. C’est ainsi que commence ce mémoire. 1) L’inceste : un phénomène important mais peu connuLorsque, dans le cadre d’un entretien avec un juge d’instruction, effectué en 2007 pour un travail d’anthropologie sur le métier de magistrat, je pose la question : « Et au niveau des délits, justement, en tant que juge d’instruction, enfin, des délits et des crimes pêle-mêle, c’est quel genre d’action que tu retrouves le plus fréquemment ? », à ma grande surprise, mon interlocuteur me répond : « Oh ben, ce qui arrive en tête depuis, moi ça fait 12 ans (…). Bon ce qui arrive en tête, c’est les affaires sexuelles, les affaires de mœurs, viol ou agression sexuelle, en milieu familial (…). ». Lorsque, fin 2007, je questionne une intervenante d’une association de lutte contre la maltraitance des enfants avec qui j’avais rendez-vous pour un stage éventuel sur « qui sont les personnes qui viennent les voir ? », elle me répond que l’association ne reçoit jamais directement les enfants, et me précise aussitôt que dans environ 70% des cas parmi leurs dossiers, la maltraitance est en fait un abus sexuel. Ce sont soit des voisin/e/s (« qui entendent des cris ») soit un « parent protecteur » qui leur téléphone. Dans ce dernier cas, souvent après avoir enclenché la procédure judiciaire. Elle m’explique qu’en général, les mères appellent quand elles viennent de découvrir, qu’elles sont alors sous le choc. Puis qu’il y a les problèmes de droits de visite vis à vis du parent incesteur [2] . Lorsque j’échange des courriels début 2008 avec une doctorante qui réalise une thèse sur le viol, en sociologie (approche quantitative), je lis sa réponse : « Et oui, l’ampleur des viols par inceste est toujours surprenante, moi-même je ne m’y attendais pas quand j’ai commencé à travailler sur le viol ». Pourtant, à ce jour, les seuls chiffres robustes qui pourraient exister sur ces abus sexuels incestueux en France métropolitaine, concernant ne serait-ce que la proportion de victimes femmes (il existe aussi des victimes hommes), devraient être tirés de l’enquête ENVEFF (sur les violences faites aux femmes) réalisée par l’INED en 2000, ou de l’enquête CSF de 2006. Or, dans l’ouvrage de Maryse Jaspard qui exploite l’enquête ENVEFF, la seule allusion aux abus sexuels intrafamiliaux se trouve ici : « Selon un mode d’interrogation particulier à base de dessins, utilisé dans les enquêtes de la zone pacifique, il a pu être estimé que 15% des femmes [kanak] avaient été victimes d’inceste avant 15 ans. » (M. Jaspard, 2005, p. 60-61). En revanche, pour la métropole, aucun chiffre n’est donné, alors même que des questions posées dans l’enquête l’auraient permis. L’inceste, sur un simple plan quantitatif, reste donc un phénomène très mal connu en France (métropolitaine surtout), ce qui peut laisser place à tous les mythes et toutes les ignorances…et par suite également à tous les aveuglements. A moins que des publications très récentes, telles le n°445 de Population et sociétés, le mensuel de l’INED, exploitant l’enquête CSF réalisée en 2006, commencent à changer la donne [3] . 2) Les travaux existant en anthropologie sur ce sujetQu’en est-il en anthropologie ? Dans son ouvrage Anthropologie de la famille et de la parenté, Robert Deliège introduit ainsi le chapitre qui traite de la prohibition de l’inceste : « Pour paradoxal que cela puisse paraître, l’inceste, en tant que tel, n’a guère retenu l’attention des ethnologues. Nous ne disposons, en effet, que de données relativement éparses sur la réalisation proprement dite de l’inceste dans les sociétés traditionnelles qui constituent notre objet d’étude privilégié. » (Robert Deliège, 2005, p. 39). Disant cela, Robert Deliège pense à l’inceste comme chez les pharaons ou en Afrique, qu’il évoque plus loin dans ce chapitre, à savoir une alliance par mariage entre personnes déjà apparentées entre elles par d’autres liens (frère-sœur notamment). Et ces alliances par mariage sont, dans l’un comme dans l’autre cas, le fait de personnes bien spéciales, à part des autres humains qui sont leurs sujets : le pharaon en Egypte, le roi dans les endroits d’Afrique noire évoqués. C’est à dire des personnes conçues comme se situant au-dessus des règles ordinaires. On voit donc que le mariage incestueux reste, même là, à caractère transgressif pour l’humain ordinaire. Dans le texte d’une intervention, intitulé « construire une anthropologie de l’inceste », l’anthropologue Dorothée Dussy explique que l’inceste (mais pas sa réalisation dans la réalité) est un des thèmes qui a été le plus traité en anthropologie. Elle relève que ce qu’on peut comprendre de la définition de l’inceste, tel qu’il est pensé par des auteurs tels Bronislaw Malinowski dans La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, c’est : « il s’agit d’une vraie relation amoureuse, interdite, entre adultes consentants » (Dorothée Dussy, 2004). Certains de ses informateurs lui indiquent que quelques petites filles ont déjà eu des rapports complets, avec pénétration. Mais Bronislaw Malinowski ne cherche pas à en savoir plus et croit « devoir rabattre ces affirmations » plutôt que d’enquêter autour de lui pour savoir qui sont les partenaires sexuels des fillettes, pensant avoir affaire à une manifestation d’un « certain humour malicieux à la Rabelais » caractéristique de ces insulaires. Et finalement, Dorothée Dussy conclut que le regard de Bronislaw Malinowski sur la sexualité prénuptiale des Trobriandais n’apprend rien sur l’inceste, ce qui, par défaut, en confirme la définition qu’il en fait au départ. Ceci est, grosso modo, affirme-t-elle, l’approche caractéristique de l’inceste en anthropologie jusqu’à Claude Levi-Strauss : l’inceste est une transgression, par des adultes consentants, des règles matrimoniales qui interdisent les relations sexuelles entre apparentés trop proches. Après Claude Levi-Strauss, du point de vue de l’anthropologie, l’inceste n’existe plus, développe-t-elle : ce qui existe, c’est l’interdit de l’inceste, élément fondateur de toute société, qui « constitue l’acte de naissance du groupe humain et marque le passage de la nature à la culture, de la bestialité à l’humanité » (in Les structures élémentaires de la parenté). Enfin, Françoise Héritier construit la notion d’inceste du deuxième type, qui advient quand deux personnes apparentées au degré d’interdit matrimonial partagent le/la même partenaire sexuel/le. Cet inceste du deuxième type n’est ainsi pas incorporable dans la théorie Lévi-Straussienne de l’échange exogamique, puisqu’ici, l’interdit porte aussi sur des femmes appartenant à des groupes dans lesquels il est normalement possible de prendre une épouse. Finalement, Françoise Héritier conclut que la véritable nature de la prohibition de l’inceste « consiste avant tout à éviter de mettre en contact des « humeurs identiques » ou encore des personnes partageant la même substance » (Robert Deliège, 2005, p. 53). Dorothée Dussy remarque, quant à elle, que la grande majorité (à deux exceptions près) des cas d’inceste relevés et décortiqués par Françoise Héritier dans Les deux sœurs et leur mère sont fictifs, relevant soit de constructions théoriques, soit de créations littéraires. Et finalement, que l’anthropologie dit donc très peu sur ce qu’est l’inceste dans la vraie vie de vraies personnes. Et ne sachant rien de ces situations réelles, l’anthropologie développe, conclue-t-elle, des représentations symboliques de l’inceste spéculatives, et non descriptives. Ceci alors que dans d’autres disciplines, telles l’Histoire, la psychologie, le domaine juridique ou la littérature, le regard porté sur l’inceste, quand il existe, relève d’une approche bien différente : quand l’inceste apparaît (ce qui reste rare), c’est accolé à la problématique du viol, et non de l’alliance, précise-t-elle. Pour autant, l’inceste-alliance et l’inceste-viol sont-ils deux entités si différentes ? C’est une question qu’elle n’évoque pas. Or, les cas réels connus d’alliance incestueuse évoqués plus haut, outre qu’il ne s’agissait ni de mariages d’amour comme ils sont recommandés aujourd’hui en Europe par exemple, ni même de mariages choisis, consentis par les époux, constituent bel et bien une transgression majeure de la règle valable pour le commun des mortel/le/s. Et cette transgression est prescrite, plus que prescrite : obligatoire, pour des humains qui sont, précisément, en-dehors des règles ordinaires : roi ou pharaon. L’alliance incestueuse sépare, finalement, la famille royale du reste des humains. Il existe d’autre part les différentes traditions de mariages endogames prescrits : le mariage de l’homme avec sa cousine croisée est ainsi recommandé dans de nombreuses sociétés ; le mariage de l’homme avec sa cousine parallèle, appelé aussi « mariage arabe », est quant à lui prescrit dans une minorité de sociétés, réparties autour du bassin méditerranéen y compris en France jusqu’à une époque historiquement récente. Dans les deux cas, au contraire du mariage exogame, il s’agit ici de rester entre soi, ce qui « implique la reproduction, génération après génération, de l’échange de conjoints entre deux « lignes » » (Maurice Godelier, 2004, p. 223), qui renforce et confirme l’alliance entre les deux familles, les deux lignes, au fil du temps. Il faut noter que dans tous ces exemples, la question du mariage, de l’alliance, n’est pas nécessairement liée à des sentiments entre individus tels « l’amour », ce qui est une spécificité de certaines sociétés dont la nôtre aujourd’hui, mais plutôt, ouvertement et simplement, liée à celle de l’alliance entre familles via celle matrimoniale de leurs membres (alliance entre familles qui continue également dans notre société via le « mariage d’amour »). La question du mariage et de l’alliance n’implique pas non plus nécessairement l’idée de consentement, de respect ou de désir mutuel. Ainsi, en France, « la société estime depuis peu que les gestes et les rapports sexuels doivent être consentis » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 19), et la notion de « devoir conjugal », n’est d’ancienne mémoire dans les textes que depuis la loi du 23 décembre 1980, qui permet de reconnaître qu’il peut y avoir viol entre époux. Et que dire, par exemple, des « certitudes » de Louis Virapoullé dans le débat du sénat en 1978 : « il n’y a pas de possibilité de viol dans le cadre de l’union légitime, car, alors, que deviendraient les devoirs conjugaux ? » (Georges Vigarello, 1998, p. 259) ? Et ce n’est qu’en 1992 que la Cour de cassation, invalidant un arrêt de la chambre d’accusation de Rennes, fait date : le viol entre époux peut être réellement jugé en France (Georges Vigarello, 1998, p. 260). Ces constats et rappels peuvent permettre de relativiser l’opposition entre l’inceste-alliance dont les règles de prohibition sont étudiées par l’anthropologie, et l’inceste-viol : l’alliance n’est pas nécessairement synonyme « d’amour », elle peut à l’inverse, sans que cela choque, aller de pair avec une violence banalisée, voire le viol, nommé en France, pour rester volontairement sur cet exemple non exotique, « devoir conjugal ». Dans le cadre de sa recherche sur les violeurs effectuée à la fin des années 1980, Daniel Welzer-Lang [4] (note importante au bas de cette page) explique : « j’avais décidé, au début de cette recherche, d’extraire les viols d’inceste de mon projet de recherche. Mais je n’ai pas eu le choix : parmi les violeurs rencontrés et dans les dossiers de viol étudiés, l’inceste était présent » (Daniel Welzer-Lang, 1988, p. 138). Après avoir relaté les témoignages de femmes de son entourage, victimes d’inceste qui lui en parlent pour la première fois alors qu’elles savent qu’il effectue cette recherche sur le viol, il évoque les statistiques d’appels reçus par l’association SOS viol, qui le conduisent à conclure : « à travers l’ensemble de ces exemples pris dans des surfaces d’émergence très diverses, se dessine une vague approche de l’inceste. Le viol d’inceste pourrait être la partie immergée d’un iceberg nommé viol » (ibid, p. 142). Enfin, il enchaîne, dans les pages suivantes, sur un récapitulatif concernant les théories anthropologiques de la prohibition de l’inceste, et les doutes émis par quelques anthropologues les concernant. C’est finalement à cela que se résumera son analyse du viol d’inceste dans cette recherche sur le viol. Son livre apporte essentiellement une analyse et une déconstruction du « mythe du viol » commis par un homme fou, un monstre, loin de l’homme ordinaire, inconnu de sa victime et dans l’espace publique, la nuit, critique effectuée sous un angle différent d’ouvrages tels Le viol de Susan Brownmiller (1978), qui avaient déjà largement entamé cette déconstruction auparavant. C’est donc bien plus tard, en 2004, qu’une véritable recherche en anthropologie débute concernant les violences sexuelles incestueuses [5] . Dorothée Dussy, anthropologue au CNRS, travaille sur le sujet depuis 2004 : elle est pour cela bénévole dans deux associations, une au Québec et une à Paris (AREVI ). Elle a co-fondé AREVI [6] , qui signifie Action Recherche Echange entre Victimes d’Inceste, et où sont mis en place, en plus des groupes de paroles et autres formes d’entraides thérapeutiques, des ateliers thématiques de discussion entre victimes dont les retranscriptions sont mises à la disposition de tou/te/s sur leur site internet. Elle explique : « Ces ateliers fonctionnent sur le principe de la compétence d’expertise que les victimes d’inceste ont de la question. Cette compétence particulière et unique (que ni les médecins, ni les travailleurs sociaux ne peuvent acquérir) repose sur l’expérience incestueuse des victimes. (…) Les matériaux de travail sont enregistrés, avec l’accord de l’ensemble des participants, qui partagent le projet de fournir collectivement un nouveau regard sur l’inceste aux professionnels de la recherche, de la santé, de l’éducation et de la Justice. » [7] . De plus, récemment, un second volet de l’enquête a démarré via des entretiens avec des personnes incarcérées après avoir été reconnues coupables de violences incestueuses, au Québec et en France. Après plusieurs années de terrain depuis 2004 début de ce travail, Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne (2007, pp. 13-30) remarquent alors que la situation incestueuse a pour élément fondateur le silence. Silence qu’elles ne définissent pas, et que je propose pour ma part de conceptualiser comme suit : « le silence est (…) à la base de la subjugation. Le silence dont il est question ici est celui des victimes qui ne parlent pas de l’abus, même si elles en souffrent. La première cause de ce silence est simple : l’absence de recours. Si un enfant est victime d’abus de la part d’un parent, vers qui peut-il se tourner pour recevoir de l’aide ? Se taire signifie pour lui survivre, mais à un prix incroyablement élevé. La deuxième cause est l’entourage. Lorsque l’enfant demande de l’aide, son discours et son expérience sont souvent niés par la famille immédiate qui évite de faire face à la situation. Le silence n’est donc pas qu’une absence de paroles. C’est une relation créée et maintenue par des individus selon des règles implicites. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (Stéphane La Branche, 2003, p. 28). Seule la rupture de ce silence peut perturber une situation incestueuse, affirment Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, ce qui signifie à l’envers que tant que rien n’est dit, rien ne bouge. Elles se proposent alors de décrire les modalités de la mise au secret des familles tout le temps que dure la période des abus sexuels, de s’interroger sur ce qui pérennise le silence une fois que les enfants sont devenus adultes, et sur ce que l’on tait, par exemple le nombre d’incestes dans la famille, la généalogie de l’inceste, etc. Elles citent également l’introduction de Victimes en souffrance, de l’anthropologue Dominique Dray, qui indique que « les travaux de victimologie ont pour point commun d’aborder (…) le désordre social et moral engendré par l’agression » (Dominique Dray, 1999, p. 29). Or la victimologie limite son champ d’intérêt à la paire victime – agresseur, ce qui n’a en réalité pas de sens pour l’étude des situations incestueuses, expliquent-elles : l’inceste est, en fait, une affaire qui concerne l’histoire de toute la famille (ce que j’aurai l’occasion d’expliciter plus loin, moi aussi, de façon plus concrète), et ne se limite pas au seul moment des agressions sexuelles. Et, finalement, l’inceste, contrairement aux agressions (cambriolages, etc) étudiées par Dominique Dray, n’est pas un désordre, mais un ordre social, « alternatif et impensé » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 15) : c’est l’hypothèse à laquelle elles parviennent. Comme tout ordre social, développent-elles, ses modalités s’enseignent aux plus jeunes, et se communiquent entre apparentés. Par des paroles (visant à briser la capacité de résistance des adversaires du système) et des gestes (éventuellement des coups). Cet ordre comporte, comme tout ordre social, ses propres valeurs, ici bien particulières et déclinées autour du silence. Ses normes de l’acceptable (le viol répété d’enfants de la famille, l’autodestruction et/ou le suicide de certains membres de la famille, par exemple) et ses normes de l’inacceptable : parler des violences sexuelles. Cet ordre social est « alternatif et impensé », car il s’inscrit dans la vie des jeunes victimes « parallèlement à [l’]apprentissage commun du monde social (…). Ils aiment leur père, leur frère, leur mère, sont assurés qu’ils seront protégés d’un éventuel danger venant de l’extérieur mais, dans le même temps, subissent de leur part des actes sexuels interdits et destructeurs. Jamais énoncé par ceux qui l’imposent, cet apprentissage contradictoire opère comme un habitus. La distinction entre le répréhensible et l’admis, le dangereux et l’inoffensif, le bon et le mauvais pour soi et pour les autres sera désormais différente de celle des non-incestés. » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 16). « Ainsi, quelles que soient la durée et la nature des agressions sexuelles, quel que soit le lien de parenté avec l’agresseur, les enfants incestés ont en commun d’avoir à se construire sur une double approche de la réalité sociale aux valeurs antagonistes. D’un côté, des paroles, des gestes et un discours dominant qui prône l’interdit de l’inceste, de l’autre les viols et l’absence absolue de paroles relatives à l’expérience effective du viol subi dans le silence et l’isolement total. (…) Mais de leur socialisation limite qui repose sur la coexistence de ces deux réalités contradictoires, les incestés n’ont pas conscience. En interdisant de dire cette contradiction, l’injonction au silence – règle d’or de la famille incestueuse clairement énoncée ou sous-entendue par l’agresseur, et parfois indirectement par l’ensemble des membres de la famille – empêche l’incesté de la voir et d’y penser, et, plus simplement, de penser aux viols comme à des viols » (ibid, p. 17). C’est pourquoi « seul un autre que soi, extérieur à la famille, peut mettre les mots de viols et/ou d’inceste sur l’indicible expérience et signifier à l’incesté son statut de victime d’inceste » (ibidem, p. 18). Ce tiers, Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne le théorisent en s’inspirant du concept « d’annonciateur » développé par Jeanne Favret-Saada via son travail sur la sorcellerie dans le bocage normand. Ici, contrairement au cas de la sorcellerie du bocage, « l’annonciateur ne cherche pas nécessairement à informer la victime. C’est celle-ci qui, en l’entendant ou le lisant, se dit : « mais c’est bien sûr ! ». [Autre différence :] Pour désigner l’inceste, la parole doit avant tout être légitime, c’est à dire avoir été prononcée par une autorité sociale, morale et psychique » (p. 18), par exemple un/e policier/e, un/e juge, un/e intervenant/e à la télévision, un/e « psy », une autre victime d’inceste via son témoignage légitimé par sa publication en livre ou en passage filmé (« vu à la télé »). De plus, à la différence de l’annonciateur du bocage qui parle par sous-entendus, par allusions (« vous pensez-pas qu’y en a qui vous voudraient du mal ? »), « Pour être entendus, les propos de l’annonciateur doivent (…) être rigoureux, c’est à dire désigner les faits sans détour et avec autorité.[Et, finalement, ] les faits vécus passent [alors] d’un statut anomique –une expérience subjective et individuelle non désignée et incompréhensible - au statut de fait social communicable, dans lequel chaque acteur est positionné : l’incesté est une victime d’inceste et son incesteur va devenir un agresseur. » (p. 20). Mais celui qui commet le désordre n’est alors pas le violeur : c’est celle (ou celui) qui dénonce le système, qui est alors souvent accusée de mensonge, voir taxée de folie, et dans l’immense majorité des cas, se retrouve rejetée(é) de la famille, cependant que l’agresseur est le plus souvent ré-accueilli, lui, dans cette famille à sa sortie de prison (quand il passe par cette case). Ainsi, « on renvoie la victime au récit familial en vigueur avant l’annonce, et à la place qu’elle occupait dans l’ordre familial » (p. 25), on la qualifie elle de folle, de menteuse, d’original/e de la famille, etc. Et, « A force de s’entendre répéter (…) qu’on n’est pas crédible, on finit aussi par ne plus tenter de convaincre les familiers et les proches de la réalité de l’inceste. Cette perte d’élan vaut à l’intérieur de la famille comme à l’extérieur où il faut aussi insister pour convaincre de la réalité de l’inceste. » (p. 26). C’est ainsi que le silence et l’ordre familial incestueux se perpétuent malgré tout, à moins que la victime « refuse ce compromis et/ou persiste dans sa révélation et sa dénonciation, [elle sera alors], et avec elle ceux qui la soutiennent, (…) vraisemblablement sacrifiée ou rejetée, implicitement ou non : on oubliera de lui rendre les clefs de la maison de campagne, on ne la conviera plus aux réunions familiales, à moins qu’on refuse définitivement de la revoir. » (p. 30). 3) Mon questionnement et ma problématique de départIl s'agissait pour moi de centrer cette recherche sur les parcours des personnes (plutôt que les mécanismes de l'inceste comme Dorothée Dussy, par exemple), et donc de décrire les histoires de personnes ayant été incestées, décrire comment se détruisent et se (re)construisent leurs existences avec l'empreinte de cette enfance-là, et avec les représentations et réactions qu'elles rencontrent à ce propos de la part de leur entourage, des systèmes de santé (psychologique notamment) et judiciaire. Pour cela, je pensais m'attacher à décrire les relations dans leur famille d'origine, le fonctionnement de cette famille, à l'époque des violences incestueuses qu'elles ont subi, notamment sous l'angle des rapports de pouvoir et de contrôle (des personnes, de l'espace domestique) et aussi des solidarités quand il en existe. Je pensais ensuite décrire l'empreinte de cette enfance telle que vécue par les incesté/e/s durant leur vie : comment modèle-t-elle leur existence (fondation d'une famille, profession, mobilité géographique …) et leur quotidien (c'est à dire comment sont les traces de leur blessure telles qu'elles les vivent elles, et non simplement telles qu'elles sont décrites nosographiquement) ? Enfin, je pensais traiter les questions suivantes : comment les incesté/e/s décrivent-elles (ils) l’inceste qu’elles ont subi (grave, pas grave ? Violent, pas violent ? Etc) ? Cette perception a-t-elle évoluée dans le temps et comment, en fonction de quels facteurs ? Comment décrivent-elles(ils) les regards des interlocuteurs/trices et instances auxquelles elles(ils) ont eu affaire en tant que victimes d’inceste (Justice, santé, entourage) et les possibilités de reconnaissance que ces rencontres leur ont (ou non) apportées : ces regards sont-ils marqués par le soupçon, la théorie du trauma (Fassin et Rechtman, 2007) ? Quels liens existe-t-il éventuellement, à travers les récits des incesté/e/s, entre ces regards sur elles (eux) et leur place à elles (eux) dans les rapports sociaux de domination (notamment de sexe et d’âge) ? A postériori,
cette problématique s’avère vaste pour un mémoire de master 1,
certains aspects (vie quotidienne des incesté/e/s par exemple)
seront donc très peu développés finalement. De plus, au fil de
ma recherche, j’ai découvert d’autres questionnements auxquels
je ne m’attendais pas, été amenée à apercevoir des aspects invisibles
pour moi d’où j’étais auparavant. L’existence d’une hiérarchie
des abus, pensés comme plus ou moins minimes selon plusieurs facteurs
que j’expliciterai, ainsi que le rôle souvent important du travail
dans l’évolution des incesté/e/s, sont ceux que je développerai
en sus des points cités ci-dessus.
II-Méthodologie et questionnements que cela suscite pour l’anthropologie 1) De l’observation participante au récitLa méthodologie, sur un tel sujet, est contrainte, du fait du caractère violent de la situation incestueuse. Michel Agier, travaillant sur des situations de violences dans l’espace public (guerres), explique quant à lui : « mes échanges avec les personnes réfugiées et déplacées se situent à l’écart des événements violents dont parlent leurs témoignages : de fait, ma réflexion s’inscrit dans le cadre d’une anthropologie des espaces humanitaires et des prises de parole dont ils sont le lieu, mais non d’une ethnographie de la violence. En effet, « l’observation participante » de cette part de violence qu’on dit physique, « réelle » ou « visible » est insoutenable, sauf à être soi-même victime, coupable, complice, ou encore saisi personnellement par un sentiment de complicité ou de culpabilité. Dans tous les cas, cette contrainte, physique ou morale, empêche l’exercice ordinaire de l’enquête ethnographique. On peut donc énoncer ainsi le commencement de cette réflexion : c’est par le constat d’une faille ou d’une impossibilité de l’enquête ethnographique (pas d’enquête directe ou « participante » sur des actes de violence) que, faisant de nécessité vertu, je sollicite des récits de violences vécues (« racontez-moi ce qui vous est arrivé, comment êtes-vous arrivé ici ? ». » (Michel Agier, 2006, p. 151). Dans le cas de l’inceste comme dans celui des situations étudiées par Michel Agier, le primat de la vue, via l’ethnographie classique, est donc impossible. Les violences incestueuses sont généralement passées, et, même si l’agresseur exerce encore son influence dans la famille d’origine des incesté/e/s, voire sur les incesté/e/s elles/eux-même, elle ne se VOIT pas : elle se raconte et s’entend. Et, alors que Michel Agier relate « une scène souvent vue, bien connue de tous ceux qui ont mené ce genre d’entretiens : l’auteur du témoignage s’interrompt et se déshabille pour montrer à son auditeur la cicatrice qu’il porte encore (…). [L’ethnologue] proteste contre une attitude qui lui semble impudique et il jure à son hôte qu’il croit ses propos sur parole, qu’il n’est pas de la police ni du HCR, etc. Mais rien n’y fait. Il doit attester qu’il a bien vu la marque de la violence » (Michel Agier, 2006, p. 157), les violences incestueuses laissent, en revanche, rarement des traces visibles sous forme de blessures physiques. Elles font au contraire partie des procédés de violence invisible : l’inceste s’avère, en ce sens, souvent un crime sans traces. Sauf lorsqu’il y a procédure judiciaire, où existent alors des traces officielles sous forme d’expertises psychiatriques, de P.V., de témoignages, etc. Traces qui ne montrent pourtant qu’une partie du réel tel que les personnes me le décrivent lors des entretiens. Et, finalement, ce qui peut faire trace visible, ne sont-ce pas justement les récits que peuvent produire les victimes ? A ces questionnements s’ajoute la question de la mémoire d’une histoire traumatisante. Ainsi, Dorothée Dussy explique que : « Il faut compter aussi le problème fréquent de l’amnésie sur tout, ou partie des abus sexuels subis, et sur tout, ou partie, de la vie quotidienne durant l’enfance. (…) D’où la nécessité de faire des entretiens répétés, à plusieurs moments de l’enquête, car la connaissance que chacun a de son histoire familiale, ou la façon de présenter cette histoire peut varier d’un retour de souvenir à l’autre. D’où la nécessité aussi d’être avertie sur le fait que le savoir donné vaut pour le moment où il est donné ; il faut le dater » (Dorothée Dussy, 2004). Pour ma part, je n’ai effectué qu’un entretien par personne. J’ai donc pu surtout constater dans la majorité de mes entretiens les sensations de flou, de brouillard, voire d’intrications, d’emmêlements étranges, existant autour des moments les plus pénibles lorsqu’ils m’étaient racontés. Je n’étais pas étonnée car j’en ai l’habitude sur moi-même. En revanche, il a été parfois surprenant pour moi d’en ressentir les effets en tant qu’interlocutrice : certains abus semblent irréels, je me retiens pour ne pas douter de leur réalité (m’a-t-on bien raconté quelque chose de grave ? Oui pourtant !). D’autres sont décrits de manière quasi photographique, ou plutôt leur environnement : je vois par exemple la poussière dans le rayon de soleil d’une grange, qui date des années 40. Enfin, les descriptions peuvent changer pour une même personne, quand elle a été agressée par plusieurs abuseurs différents. La forme « récit » pose alors explicitement la question du rapport à l’histoire, ici histoire de la personne et de la famille dont elle est issue : il existe généralement plusieurs versions de cette histoire, celle de l’agresseur et ses soutiens au sein de la famille différant généralement largement de celle relatée par les victimes, qui plus est marquée par les brouillages dus à la mémoire traumatique. Dès lors, se pose la question de la vérité des récits, « parce que certains récits sont à ce point stupéfiants qu’on pourrait se demander s’ils sont plausibles » (Dorothée Dussy, 2004). D’autant qu’ils ne proviennent pas de régions en guerre, toujours lointaines pour nous, mais de personnes qui pourraient être ou avoir été nos voisin/e/s, collègues, ami/e/s. Ces doutes sont amplifiés par l’attitude des abuseurs : « quand l’agresseur ne peut plus nier purement et simplement les faits, ce qui est la réaction la plus fréquente, il dénie les conséquences de ses actes. Dans un second temps, les pères abuseurs organisent généralement un mode de défense qui consiste à transférer la responsabilité de leurs actes sur les autres membres de la famille » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 108). « Bon nombre de pères incestueux sont passés maîtres dans une technique particulière d’information, que l’on pourrait appeler « l’effort pour rendre l’autre confus », en paraphrasant Harold Searles, L’effort pour rendre l’autre fou, technique qui va de pair avec « l’effort pour rendre l’autre coupable à sa place ». » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 113). Confus, c’est à dire doutant de ce qu’il a vécu, ou vu, ou entendu, ou simplement compris. On conçoit donc qu’en plus d’avoir uniquement des récits, il faut littéralement « choisir un camp » : celui de la victime, ou bien celui de l’abuseur. Cela n’est pas sans rappeler, en partie, les problèmes rencontrés par Jeanne Favret-Saada dans son étude de la sorcellerie normande, en remplaçant « ensorcelé/e » par « incesté/e », et « sorcier » par « abuseur » : « On ne peut donc étudier la sorcellerie sans accepter d’être inclus dans les situations où elle se manifeste et dans le discours qui l’exprime. Cela entraîne des limitations fâcheuses aux tenants de l’ethnographie objectivante : 1. On ne peut vérifier aucune affirmation : d’abord, parce que la position de témoin impartial est absente de ce discours. Ensuite, parce qu’il est inutile d’interroger des tiers : être ensorcelé, c’est avoir interrompu toute communication avec son sorcier supposé (…). 2. On ne peut pas entendre les deux parties – les ensorcelés et leurs sorciers supposés – puisque entre eux, la communication est coupée. Non seulement ils ne se parlent pas, mais ils ne s’autorisent pas du même discours. Quand, par exception, on a pu obtenir les deux versions d’une même affaire, il est impossible de les confronter, les sorciers déclarant uniformément ne pas croire aux sorts et récusant le discours de la sorcellerie au nom du discours positif » (Jeanne Favret-Saada, 2005, p. 43). Par ailleurs, concernant la question de la vérité, Michel Agier fait, précisément, remarquer le lien entre vérité et pouvoir de parole : « la posture de recherche opère, contre la doxa de l’ordre contextuel lui-même, un déplacement depuis la question de la vérité vers la question du pouvoir – et du pouvoir de parole en particulier » (Michel Agier, 2006, p. 156). On peut dès lors noter l’usage qui est fait, dans la citation qui suit, du pouvoir de parole : « L’inceste est donc un phénomène beaucoup moins rare qu’on ne le croit habituellement. Aux Etats-Unis par exemple, on considère parfois qu’entre quatre et sept pour cent de la population féminine aurait été impliquée dans des relations sexuelles intrafamiliales (Twitchell, 1987, p. 13). Il convient cependant de considérer ces chiffres avec une certaine réserve car on sait la propension de certaines féministes américaines à qualifier de viol la moindre caresse paternelle. » (Robert Deliège, 2005, p. 43). Aucun travail de terrain ne vient pourtant à l’appui de ces considérations sur la différence entre « viol » et « la moindre caresse paternelle », mais l’autorité scientifique a parlé. Pour ma part, j’ai effectué un terrain constitué d’entretiens longs avec cinq personnes : aucune ne connaissait les autres. Pourtant, ces récits, tous ahurissants pour une personne peu familière des situations incestueuses, comportent beaucoup de ressemblances les uns les autres notamment dans l’usage de la menace, les procédés de mise sous terreur des victimes, ce, qu’il s’agisse de « viols », de « caresses » (mot inusité par mes interlocutrices, qui dans ces cas emploient le terme juridique « attouchements », ou encore expliquent « il me tripotait ») : pour le dire ainsi, le terrain a parlé. 2) De l’objectivité aux points de vue« L’autorité scientifique a parlé » - « le terrain a parlé » : ces considérations mènent alors à la question de l’objectivité scientifique. Ainsi, Dorothée Dussy compte, parmi les raisons pouvant amener à mettre en doute la crédibilité des interlocuteurs/trices, « le manque de distance de l’enquêteur, ou son absence d’objectivité, pour commencer » (Dorothée Dussy, 2004). Un moyen possible de réponse à ce questionnement peut être selon moi trouvé via la notion de savoirs situés, rompant avec une conception Durkheimienne de l’objectivité, qui serait en quelque sorte un point de vue surplombant, dégagé des prénotions et affects, et, de ce fait même, suffisamment distancé. Or, les faits sociaux ont ceci de particulier que nous y participons tou/te/s, y occupons une place. Pascale Molinier, réfléchissant avec les membres de son équipe de recherche autour du travail domestique, constate ainsi : « nous avons fait la découverte désagréable mais instructive de nos propres résistances et censures. (…) Fils et filles de maîtres ou fils et filles de serviteurs (ou assimilés), nous ne réfléchissions pas tous et toutes à partir du même point de vue, et cela générait, autour de la table, beaucoup d’irritation et de ressentiment. Bref, les chercheurs aussi sont situés. (…) L’épistémologie du point de vue ou des savoirs situés a mis en évidence que les sciences sociales ont été construites à partir du point de vue « homme, blanc, bourgeois, du Nord occidental » et que ce point de vue étant le seul considéré comme objectif, les points de vue minoritaires étaient considérés comme « subjectifs » ou « particuliers » et finalement rejetés comme non scientifiques. » (Pascale Molinier, 2006, p. 45). Ainsi, plus qu’un point de vue objectif unique, surplombant car suffisamment distancé, il convient de « rendre visible et interrogeable la situation de qui produit des connaissances sur qui. » (Pascale Molinier, 2006, p. 46), en effet, « les déformations ethnocentriques [ou de classe, ou de genre], dues à la culture à laquelle on appartient, sont inévitables. Plutôt que de les déplorer, nous devons en tenir compte, comme de sources d’erreurs systématiques » (Georges Devereux, 1980, p. 198). Dès lors, « si nous utilisons, côte à côte et de manière avertie, à la fois une source occidentale et une source non occidentale, chinoise par exemple [ou bien un/e fils/fille de serviteur et un/e fils/fille de maître], en gardant présentes à l’esprit les imperfections spécifiques (préjugés, astigmatisme) de chacune de ces paires d’yeux respectivement, l’exactitude de la vue obtenue sera comparable à celle obtenue par triangulation » (Georges Devereux, 1980, p. 198). L’objectivité apparaît alors plutôt comme une triangulation de plusieurs points de vue, quand cela est possible, que comme donnée par un seul point de vue, qui serait doté de la capacité de s’abstraire par lui-même de toute déformation (prénotions, ethnocentrisme, etc), et capable de tout voir. Ainsi, le présent mémoire se veut plus modestement une contribution, un point de vue, situé, qui en appelle d’autres et vient après d’autres, situés également, pour construire une connaissance anthropologique de l’inceste. Le fait d’être ainsi « situé/e », ne doit néanmoins pas être un prétexte afin d’éviter de réfléchir sur la distanciation, ou, dit autrement, sur la réflexivité par rapport au thème d’étude. En effet, la démarche anthropologique « consiste d’abord à nous étonner de ce qui nous est le plus familier […] et à rendre plus familier ce qui nous est étranger » (François Laplantine, 2001, p. 24). Ceci n’a rien d’une gageure : ainsi, je me suis rendue compte, au fur et à mesure que mes directeurs de mémoire me questionnaient sur l’avancement de mon travail, de ma tendance à retenir de mes entretiens surtout les éléments qui ressemblent à mon histoire à moi. Tendance que j’ai alors, par ricochet, également perçue dans des ouvrages que jusque là, pour le dire ainsi, je vénérais : Le sang des mots, d’Eva Thomas, par exemple. On y lit notamment « Dans le courrier [de l’association SOS inceste pour revivre dont Eva Thomas a impulsé la création en 1986], nous avions eu la surprise de constater que c’était une pratique courante : les victimes d’inceste avaient souvent changé de prénom, même si elles ne le faisaient pas officiellement. Pour beaucoup une sorte d’évidence s’était imposée : il fallait se faire appeler autrement par l’entourage : changer de prénom dans la vie, pour créer un espace vital et échapper au massacre de l’identité. D’autres femmes racontent qu’elles se sont mariées très vite, surtout pour changer de nom. J’avais, moi aussi, changé de prénom plusieurs fois (…) ». (Eva Thomas, 2004, p. 69) Eva Thomas parle des autres, mais c’est pour revenir à elle : « j’avais moi aussi changé … ». Pas changé de nom de famille, comme elle l’évoque juste avant, mais de prénom : je remarque la différence, car personnellement, je ne voudrais surtout pas changer de prénom … en revanche, je me sens très concernée par la question du nom de famille. Aussi, cette démarche de faire de son cas une généralité, ou plutôt, surtout, à faire de la généralité … son cas, m’apparaît ici au grand jour, ce qui m’incite à faire preuve de prudence pour ne pas réduire les autres à … moi, comme j’ai moi aussi tendance naturellement à le faire. Mais à cela s’ajoute la considération suivante : « Quand des victimes d’inceste se retrouvent pour parler de leur expérience, il se passe très vite un étrange phénomène, nous entendons les autres prononcer notre parole, ce que nous avons eu si souvent tant et tant de mal à élaborer, voilà que ces phrases sortent d’une autre bouche. Etrange impression de familiarité avec celui ou celle dont pourtant nous ne savons rien, et qui parfois a une histoire si différente. » (Eva Thomas, 2004, p. 136). Constat stupéfiant que j’ai fait, pour ma part, en 2004 : alors que je croyais que le premier écrit posté par mes soins sur un forum internet d’entraide entre victimes d’inceste était simplement mon histoire, mon ressenti, les autres participantes du forum trouvaient que je mettais en mots par ce texte … leur vécu également. Il y est même arrivé à une personne d’être absolument hors d’elle, ayant retrouvé copiés-collés sur un autre blog ses poèmes à elle. Après explications avec la créatrice du blog, il s’avérait que cette dernière n’avait pas de mots pour dire ce qu’elle avait subi, c’est pourquoi elle avait utilisé ceux déjà écrits par une autre, et qui disaient si bien … son vécu à elle. Finalement, entre personnes ayant subi un ou des incestes, ce qui vient en premier lieu, c’est donc le général, ce qui nous est, ou en tout cas nous semble être commun. Or, en termes méthodologiques concernant les récits de vie, habituellement, « c’est en découvrant le général au cœur des formes particulières, que l’on peut avancer dans cette voie [la voie de la généralisation]. Cela passe par la comparaison, la recherche des récurrences et par ce qu’on appelle la saturation progressive du modèle » (Daniel Bertaux, 2005, p. 34). Etant donné que
ce qui est premier pour moi, ce sont précisément des récurrences,
étant donné également qu’il me semblait difficile de faire de
nombreux entretiens de durée « classique », car j’avais
l’impression qu’ils ne me permettraient pas d’aller au-delà de
ces récurrences « évidentes » entre anciennes victimes
d’inceste, je compte dans ce mémoire, comparer bien sûr, mais
en prenant soin, à l’inverse, de bien relever aussi les singularités,
les différences. Ceci me rapproche plus, finalement, d’approches
en lien avec l’Histoire, telles celle développée par Franco Ferrarotti :
« J’étais particulièrement frappé par le caractère synthétique
du récit auto-biographique en tant que pratique de vie.
Mais je percevais en même temps le danger de la littéralité,
c’est à dire que j’étais freiné et tourmenté par le fait incontestable
que la biographie singulière était après tout le récit d’un destin
unique et irréductible. » (Franco Ferrarotti, 1983, p. 41),
mais, en fait, « Chaque vie humaine se révèle jusque dans
ses aspects les moins généralisables comme synthèse verticale
d’une histoire sociale. Chaque comportement et acte individuel
apparaît dans ses formes les plus uniques comme la synthèse horizontale
d’une structure sociale. Combien faut-il de biographies pour atteindre
une « vérité » sociologique, quel matériel biographique
sera le plus représentatif et nous donnera le premier des vérités
générales ? Ces questions n’ont peut-être aucun sens.
Parce que – en toute lucidité, allons jusque-là – notre système
social est tout entier dans tous nos actes (…), et l’histoire
de ce système est tout entière dans l’histoire de notre vie individuelle »
(Franco Ferrarotti, 1983, p. 50).
1) Mes relations avec le terrain, et ses difficultés (parfois) surprenantes pour moia. Ma première difficulté : moiMa première difficulté pour parvenir à effectuer des entretiens, a été moi-même. Non pas sous l’angle « je vais entendre des choses horriblement angoissantes qui pourraient être douloureuses pour moi », comme beaucoup de personnes l’ont pensé autour de moi, mais sous l’angle « ces entretiens ne risquent-ils pas de faire du mal à celles (ou ceux) qui les accepteraient, en « remuant le couteau » dans la plaie de leur histoire d’une façon trop abrupte, ou maladroite ? » : j’avais beaucoup de doutes sur moi, sur mes capacités à mener ces entretiens d’une façon qui ait un impact autre que négatif pour les personnes volontaires. En effet, sur le forum internet que je fréquentais depuis 2004 [8] , les propos suicidaires, les « j’ai envie de faire une connerie » ou parfois les « je viens de faire une connerie » (automutilation ou bien tentative de suicide), par exemple, ne sont pas exceptionnels. Ceci au milieu des autres humeurs noires et souffrances déposées là, parce que c’est un des rares endroits où c’est possible, en compagnie des clins d’œil, messages chaleureux et moments d’espoir, également mis ici, sous forme de mots jolis. En revanche, parallèlement, je savais (intellectuellement et malgré ce ressenti défavorable sur moi) que proposer à des incesté/e/s cette occasion de parler de leur histoire si elles(ils) le souhaitaient, ne pouvait pas vraiment être négatif, et plutôt le contraire. D’autre part, sur ce forum internet, le fait d’être plusieurs à répondre les un/e/s aux autres, ainsi que celui de ne « connaître » les personnes qu’à travers les écrits échangés via l’écran, ont longtemps été indispensables pour ma capacité personnelle d’entendre ces propos. C’est d’ailleurs pour cela que j’avais résolument évité toute occasion de rencontre en chair et en os avec quelque personne que ce soit du forum internet jusqu’à très récemment : début 2005, une personne que j’ai connue était décédée par suicide, et m’attacher un tant soit peu à de nouvelles personnes potentiellement dans ce cas de figure, m’était insupportable. En outre, il m’avait fallu au départ plusieurs mois d’une sorte d’apprentissage, progressif, avant de trouver un équilibre, de savoir ne plus répondre, me retirer d’un échange (d’autres peuvent répondre, puisque c’est un forum), afin de me respecter moi, de ne pas me faire de mal en assumant plus que ce que je pouvais. La situation d’entretien en face à face sur cette thématique, qu’elle soit à des fins anthropologiques ou non, me semblait ne me donner aucune de ces possibilités de retrait que j’avais apprises à utiliser sur le forum internet. C’est dans ce contexte que je m’inscris, début août 2007, pour participer au groupe de parole mensuel de l’association SOS inceste pour revivre Grenoble. Trois raisons à cela : premièrement, pour moi personnellement. Deuxièmement, pour entrer en relation avec des incesté/e/s : dès mes premiers contacts en avril 2007, j’ai senti confusément qu’il ne fallait pas que j’attende un stage en janvier dans cette association (qui n’a finalement jamais eu lieu) pour entrer en relation avec des personnes dans les différents et peu nombreux espaces qui m’y étaient accessibles. Troisièmement, et c’est une raison des plus importantes, pour m’habituer à entendre, via cet « espace d’échange et de partage, d’accoutumance à une parole difficile à dire et à entendre » [9] , des récits que j’avais à l’époque simplement pris l’habitude de lire sur l’écran du forum internet nantais : je me disais que comme il m’avait fallu un temps d’apprentissage pour me positionner sur le forum sans être dépassée, submergée ou « bouffée », j’aurais aussi besoin d’un apprentissage, d’un temps d’accoutumance, à l’écoute et au partage de la parole sur ce sujet avec des personnes là physiquement cette fois. Sur le premier point, les apports du groupe de parole ont été limités, car alors que je voulais (et m’imaginais) pouvoir m’exprimer comme toutes en tant que victime d’inceste, j’étais plutôt considérée, en réalité, comme une personne étrange par l’écoutante, sans que ce soit dit. Etrange car hybride anthropologue - victime ? Courant avril 2008, j’ai eu l’opportunité (et la force), en utilisant justement le cadre du groupe de parole, alors en très faible effectif, de poser l’essentiel de ce problème « sur la table ». J’ai enfin réussi à faire comprendre ma démarche à cette personne. Ceci d’ailleurs bien après avoir fini mon terrain pour cette année … Mais même limités de ce fait les apports du groupe de parole sur le plan personnel ont été importants sur un aspect pour moi : il est accessible uniquement aux personnes ayant été victimes d’inceste. M’y rendre, c’était donc aussi rendre plus palpable pour moi mon histoire, réaliser davantage que je faisais bien partie des victimes d’inceste : concrètement, j’ai passé la semaine suivant ma première participation à ce groupe à … dormir, assommée de fatigue et de cauchemars, assimilant ainsi un peu plus cette réalité inassimilable. Mais c’est sur les deuxième et troisième points que ce groupe de parole m’a apporté le plus. En effet, lors de la « journée de recherche » de l’association fin mars 2007 et ensuite, la rencontre avec des personnes présentes là en tant que victimes d’inceste me les faisait percevoir, à mon corps défendant, comme … souillées, salies, marquées, abîmées, ce alors même que moi aussi, j’étais dans ce cas de figure ! Ce sentiment m’était désagréable au possible, mais persistait obstinément. Entendre les récits de chacune via le groupe de parole, m’a permis de changer cela, de passer progressivement de ce sentiment de dégoût, de « bah, loin de moi ! », au sentiment de « oui, cette histoire est horrible, mais qu’est-ce qu’elle la raconte bien ». Via le groupe de parole, j’ai ainsi appris à aimer entendre chacune raconter à sa manière, singulière à chaque fois, avec sa voix et ses gestes bien à elle, son histoire. Je suis passée du dégoût à l’affection pour ces personnes (dont je fais partie). Cette transformation était précieuse pour pouvoir écouter en entretien, avec respect et estime pour elles, celles qui ont souhaité participer à mon travail universitaire … et pour mon regard sur moi aussi. Il a été étrange et déplaisant pour moi d’éprouver ces sentiments de répulsion, ressemblant d’ailleurs à ceux que j’ai perçus à mon égard et à l’égard de ce thème de recherche, de la part de personnes rencontrées pour mon mémoire, à l’université notamment. b. Ma seconde difficulté : autour de moi« L’inceste ? Ca produit du dégoût, un choc, quand on entend parler de ça » Explique une étudiante juste avant que j’intervienne sur mon sujet de recherche, à l’invitation d’une enseignante-chercheuse de Lyon 2, en avril 2008. Voilà qui résume assez bien la plupart des réactions que j’ai rencontrées, dès l’an dernier, lorsque j’ai commencé à parler de cette thématique pour un mémoire d’anthropologie. Les étudiant/e/s en anthropologie qui commençaient à se et me questionner sur nos idées de sujets de mémoire pour le master 1, répondaient par une mine ou un propos manifestant le dégoût, la répulsion, en entendant mon énoncé : « une anthropologie de l’inceste ». Ce, qu’ils/elles soient au courant de mon histoire personnelle ou non. Ainsi, même celles et ceux qui avaient réagi en condamnant sans ambiguïté les actes de mon agresseur, et sans aucun dégoût visible à mon encontre, participaient à ce rejet et à ce dégoût vis à vis de mon idée. Dans mon entourage [10] , les remises en causes ont été majoritaires : « tu es sûre que c’est une bonne idée pour toi Sophie ? », « tu ferais mieux de suivre une thérapie, car tout ce que tu risques de faire là, c’est de régler des comptes », etc. Seules les victimes d’inceste du forum internet, et un proche, m’ont soutenue, ce avec autant d’entrain que les précédent/e/s en mettaient à désapprouver mon idée. Les bénévoles associatifs qui s’occupent du forum internet sont resté/e/s silencieux/euses, et m’ont confié ensuite avoir pensé d’abord que c’était une mauvaise idée pour moi, avant de finalement se joindre aux encouragements. Enfin, au niveau des enseignant/e/s de l’université, les premières réactions ont été le rejet pur et simple : « vous ne voudriez pas plutôt étudier le viol dans l’espace public ? », ou encore « J’y suis défavorable, il faut prendre de la distance ! » (assorti d’une grimace que les propos de l’étudiante citée plus haut me semblent assez bien traduire en mots). L’incompréhension : certains croyaient (et croient encore) que je voulais étudier les règles de prohibition de l’inceste comme Claude Levi-Strauss ou Françoise Héritier. Un enseignant semblant échapper à ces écueils en discussion dans son bureau, devient gêné lorsque je viens discuter en amphithéatre d’une demande concernant ce mémoire. Ce qui n’a pas été sans me rappeler ma gêne à moi pour aborder un enseignant sur ce sujet, quelques mois auparavant, dans un amphithéatre également … Si la réalisation de ce mémoire est possible, c’est donc parce que certains enseignants ont su dépasser ces premières réactions. Je remarque par ailleurs une évolution chez les étudiant/e/s (et doctorant/e/s) notamment : alors qu’au départ, je rencontrais très rarement des interlocuteurs/trices trouvant mon thème intéressant et étais surtout en bute aux réactions de dégoût ou de rejet, le nombre de ceux/celles qui me répondent « c’est un sujet intéressant » quand je leur énonce simplement mon thème de recherche s’accroît de façon remarquable. Ici, il ne s’agit pas d’une évolution des personnes, mais d’évolution des premières réactions de personnes nouvellement rencontrées. Ceci me pose la question de l’impact possible de la manière dont je présente mon thème de recherche, du non-verbal que j’y associe dans la communication sans m’en rendre compte, et de son évolution dans le temps … sur mes interlocuteurs/trices, mais aussi la question des différences de public : l’an dernier, j’avais affaire à des étudiant/e/s de licence d’anthropologie, à des enseignants de sexe masculin et âgés de 40 ans ou plus. Cette année, mes directeurs de mémoire hormis, je parle surtout avec des doctorant/e/s et des étudiant/e/s de master, c’est à dire des personnes de ma génération, qui ont commencé à effectuer eux/elles-même des recherches, et semblent surtout sensibles à la difficulté du sujet et à son originalité. Enfin, j’ajoute que l’angoisse de mes interlocuteurs/trices rejetant/e/s m’a semblé souvent croître d’un niveau lorsqu’ils/elles apprenaient de plus que j’étais moi-même victime d’inceste. Aucune des nouvelles personnes avec qui j’ai discuté « à bâtons rompus » de mon mémoire cette année, n’a été en revanche au courant de mon histoire personnelle : par appréhension des réactions, j’ai eu tendance à me réfugier derrière cette « carte de visite » là, qui est devenue par moments presque un empêchement à ce dévoilement des grandes lignes de mon histoire à moi à certaines personnes. c. Ma troisième difficulté : des associations paradoxales, ou « l’anthropologue-victime d’inceste » comme étrangeté ?Par ordre chronologique, ma première prise de contact avec une association dans l’optique de réaliser ce mémoire sur l’inceste, a été via la « journée de recherche » sur le thème « créativité, art et processus de guérison », organisée fin mars 2007 par l’association SOS inceste pour revivre de Grenoble. Cette association est à la fois la plus ancienne association française sur ce terrain (créée en 1986, « par Eva Thomas », lit-on sur le site internet de l’association), et la plus proche géographiquement : en fait la seule en Rhône-Alpes. Ce jour-là, j’ai ressenti à travers les propos, attitudes, des personnes croisées, le sentiment d’une association un peu pestiférée du fait de sa thématique. Quant à mon idée de mémoire, lorsque je l’émettais dans les couloirs, mes interlocutrices croyaient qu’il s’agissait d’un mémoire de psychologie, n’entendant manifestement pas le terme « anthropologie ». Elles recevaient mon idée comme une information, et non une proposition qui pourrait les intéresser ou au contraire être rejetée. La journée était divisée en deux parties : le matin, intervention d’un art-thérapeute puis discussion ; l’après-midi, projection d’un film relatant le parcours de recherche de Jade, à qui ses véritables origines avaient été cachées par sa famille. Le matin, durant la discussion, je remarque le peu d’interventions de victimes : le débat me semble se faire plutôt entre professionnel/le/s. Puis quelques victimes posent des questions : je note la différence de ton, qui se fait souvent hésitant, peu audible. La journée se déroule dans un petit amphithéatre, avec intervenant/e/s à la tribune, et un micro qui circule dans la salle. C’est durant cette matinée que je demande la parole, sur une impulsion de colère, après avoir entendu l’art-thérapeute expliquer : « quand l’enfant avoue … ». Juste avant moi, une membre de l’association s’est inscrite dans le tour de parole, pour les mêmes raisons. C’est elle qui lui fait remarquer une première fois que le terme « avouer » est pour le moins mal choisi. Quant à moi, j’ajoute : « et encore faudrait-il que l’enfant sache ce qui lui arrive, parce que en réalité, souvent, on n’a même pas le droit de savoir, dans ces cas-là ! ». L’art-thérapeute a volontiers convenu qu’il avait mal choisi son mot, re-précisé le sens de son propos, puis fait des remarques notamment à propos de la suite de mon intervention, qui portait sur certains arts martiaux comme un moyen possible pour reprendre confiance en soi. Le film de l’après midi a suscité, à l’inverse, plus d’interventions et de questions de la part des victimes. Je remarque celles qui sont adressées à l’art-thérapeute, toujours présent mais dans le public. Ces incestées le positionnent en « savant », lui demandant « mais pourquoi est-ce comme ceci ? », « mais pourquoi est-ce comme cela ? », notamment, si je me souviens bien, concernant le « pourquoi » les agresseurs agressent. L’art-thérapeute leur répond alors par des : « je ne sais pas » répétés, refusant ainsi cette place de « savant ». A plusieurs reprises durant la journée, la personne intervenue juste avant moi me fait comprendre qu’elle tient à m’inviter chez elle. Les autres personnes font preuve d’une apparente indifférence à mon égard. A leur inverse, elle a bien compris qu’il s’agit d’un mémoire d’anthropologie et non de psychologie, et, chez elle, où je passerai finalement la nuit, elle m’explique notamment : « d’habitude, on se méfie des étrangers, mais je vais en parler aux autres ». Nous discutons également de l’idée d’un stage comme moyen possible pour moi de faire connaissance avec les autres et ainsi trouver parmi elles des personnes intéressées à participer à ma recherche. Mais durant l’été 2007, suite à mon inscription au groupe de parole de cette association, les écoutantes vues lors de l’entretien préalable, ainsi qu’ensuite celle du groupe de parole, me questionnent de façon récurrente en employant le mot « violence » : « vous arrive-t-il d’être violente ? Certaines victimes sont violentes », « ne crois-tu pas que parfois tu peux faire violence ? ». Toutes étaient présentes lors de la journée de recherche. De mon côté, j’ai l’impression, dores et déjà, d’une association « forteresse », méfiante, qui m’examine comme un danger potentiel … « d’habitude, on se méfie des étrangers » ... Comment mon intervention lors de la journée de recherche a-t-elle été perçue par celles qui posaient l’art-thérapeute en personne savant « pourquoi ? » quand elles ne le savaient pas elles-même ? Comme violente ? Durant cet été 2007, j’ai également pris contact, par courriel, avec l’association SOS inceste pour revivre de Nantes, créée en 1994. Ceci simplement pour leur demander conseil concernant les précautions à prendre dans la réalisation d’entretiens avec des incesté/e/s, qui ne me semblait pas simple puisque j’étais très peu sûre de moi, tenaillée par la peur qu’un entretien conduit maladroitement puisse conduire à ce qu’une personne fasse … « une connerie » ou se sente très mal. Je pensais que leur expérience d’entretiens d’écoute des incesté/e/s, pouvait m’apporter à cet égard, même si les objectifs de leurs entretiens (d’aide) et de mes entretiens (de recherche) étaient différents. Dans un premier courriel, il m’était simplement précisé « la nécessité de laisser la personne libre de dire ou non ce qu’elle peut et ce qu’elle veut », et que « cette parole doit être impérativement contenue par un cadre référent et rassurant comme celui d’un cabinet de psy ou d’une asso ». Après ma réponse à ce premier courriel, j’ai eu une proposition de prises de rendez-vous pour une série d’entretiens avec des victimes d’inceste, dans cette ville située à l’autre bout du pays. Ce alors que je n’avais encore formulé aucune demande de cet ordre ! Je n’y ai pas donné suite, d’une part parce que je n’imaginais aucunement les barrières finalement rencontrées de la part des associations plus proches géographiquement, mais surtout parce que j’avais du mal à m’imaginer faire des entretiens, de but en blanc, avec des incesté/e/s dont je ne connaissais rien du tout et qui ne connaissaient rien de moi. Et, qui plus est, du fait de l’éloignement géographique, des entretiens forcément enchaînés les uns aux autres sans que j’aie le temps de … respirer. Je n’avais encore jamais réalisé d’entretiens comme ceci, et ai donc joué la prudence pour moi aussi. Ce en quoi j’ai eu raison : ces entretiens ont effectivement été angoissants pour moi, surtout au début. D’où la nécessité d’un temps pour me préparer à chaque fois, en me rassurant via par exemple la réécoute de parties des entretiens précédents (« non, tu n’es pas nulle, Sophie, là tu vois, tu poses une bonne question, et là tu vois, elle se tait, tu n’insistes pas : donc tu n’as pas fait de mal … »). Et, pour chacun, j’ai eu effectivement ensuite besoin d’un temps de plusieurs jours pour assimiler, évacuer, respirer, tant les histoires de mes interlocutrices étaient lourdes et difficiles à entendre pour moi, tout comme elles le sont à vivre pour elles, et entraient parfois en résonance avec la mienne. Pourtant, j’avais aussi l’avantage de l’habitude : à chaque fois qu’il me revient en mémoire des pans oubliés de mon histoire à moi, ce sont en effet les mêmes ressentis, et en réponse les mêmes rituels, d’écriture notamment, que je mets en œuvre pour assimiler ce que je viens d’entendre. J’ai ainsi pris le même plaisir ensuite (c’est le mot exact) à mettre en ordre ces récits, que j’avais eu à le faire pour moi jusqu’alors. Plaisir contrebalancé et contredit par une envie adverse de … fuir tout cela par le sommeil, qui m’a longuement freinée dans la construction concrète de ce mémoire, et qui m’était également familière auparavant à mon propos personnel. La rédaction de ce mémoire a donc largement pris pour moi la forme d’une lutte entre moi et moi-même, parfois source d’une grande douleur, autre obstacle m’incitant à la fuite. L’association SOS inceste pour revivre de Grenoble, quant à elle, n’a fourni aucune réponse à mes courriers envoyés en septembre et novembre 2007, où je leur proposais de discuter ensemble afin qu’elles puissent dire si mon projet de recherche et ma demande de stage les intéressait. Je n’ai eu que des réponses individuelles de membres de l’association, divergentes : celle qui soutenait mon projet le soutenait toujours, l’écoutante du groupe de parole, seule autre personne à qui j’avais alors accès dans cette association, le jugeait « dangereux » et y était toujours farouchement opposée. Cette association fonctionne selon une division entre « permanences d’écoute » pour les victimes, et « permanences administratives » pour les personnes (chercheurs/euses, étudiant/e/s, professionnel/le/s …) en recherche d’information ou de collaboration. A l’issue du groupe de parole d’octobre 2007, alors que je demande à cette écoutante de me confirmer quels sont les horaires de la permanence administrative, elle me questionne, étonnée : pourquoi moi, aurais-je besoin de ces horaires ? Je lui explique que je vais faire un mémoire sur l’inceste, en anthropologie. Elle m’apprend alors que la plupart du temps, c’est elle-même qui tient la permanence administrative, puis me déclare (alors que je n’ai pas encore évoqué ma demande de stage) : « nous ne prenons pas de stagiaires », « nous croulons sous les demandes de ce type … nous avons même reçu une demande d’un historien ! ». Et si les personnes du groupe de parole devaient répondre à toutes ces demandes, « elles passeraient leur vie en entretiens », puis de conclure, en me montrant les livres de témoignages déjà publiés, présents dans la bibliothèque de l’association : « là, il y a de la matière pour ton mémoire ». Ceci allant néanmoins de pair avec des demandes d’avis (« qu’as-tu pensé de ce livre ? ») où il était sensible que mon statut d’anthropologue, d’universitaire, rendait ce point de vue important à ses yeux. Après un nouvel échange téléphonique avec mon autre interlocutrice, et orientée par ses conseils, j’ai rédigé mon deuxième courrier, cette fois à l’attention de la présidente. Ce courrier n’a jamais été discuté au C.A. de l’association. Et, en plus de n’avoir jamais eu un refus clair ou un accord de cette association, j’ai continué à recevoir des avis. Ainsi, à l’issue du groupe de parole de décembre 2007, j’entends, en aparté, que mon projet est « dangereux » pour moi, voire « kamikaze », et je reçois conseil de « plutôt passer mon temps à prendre soin de moi ». Excédée, je réponds alors à mon interlocutrice « ne me prends pas pour du sucre d’orge », et quelques jours plus tard, poste une annonce sur le forum internet de SOS inceste pour revivre Nantes, pour dire que je cherche des personnes intéressées à participer à mon mémoire de master 1 d’anthropologie … Un nouvel échange téléphonique me donnera d’ailleurs une autre version de la « dangerosité » de mon projet : c’est pour les victimes que « certaines personnes » le jugent « dangereux », car « il faut un cadre », m’est-il expliqué là. Par ailleurs, je fréquentais le forum internet d’entraide entre victimes d’inceste nantais depuis 2004 : j’avais envie et besoin de conserver intact un espace, cet espace, où je pouvais confier à d’autres, librement, ce qui n’allait pas pour moi. Que ce soit dans ma vie personnelle ou … relativement au mémoire d’anthropologie que j’étais en train de faire. Devoir quand même, finalement, recourir à cet espace pour mon mémoire, m’a mise dans une situation subjectivement très inconfortable. Après avoir vu ma demande rejetée car « dangereuse » pour Grenoble, est apparue la peur de perdre aussi ma place sur le forum, ou du moins qu’elle soit transformée d’une manière négative pour moi, du fait que je n’allais plus être simplement « victime », mais aussi … « anthropologue ». Ainsi, le changement de statut que je souhaitais, dont je ressentais le besoin, était aussi un changement qui devenait effrayant, redoutable pour moi. J’ai réagi en créant une sorte de « compartimentage », utilisant un pseudonyme que j’avais abandonné depuis quelques mois, et qui était donc connu comme mien sur le forum, pour faire mes demandes d’anthropologue concernant mon mémoire, et ai continué à parler de moi en tant que victime d’inceste sous mon pseudonyme habituel, différent du précédent. Pour moi, il était important de bien différencier mes deux « rôles », même si c’était, clairement pour tout le monde, la même personne dans chacun de ces statuts. Cela faisait à mes yeux du forum un espace où je pouvais continuer à parler de moi (et à répondre aux autres à égalité) … mais pas trop de mon mémoire sous certains aspects, tels mes moments de doute sur mes enseignants, puis tels le rejet par l’association que j’avais contactée localement, et qui est en lien (historique et de principes) avec celle qui gère le forum internet. Ainsi, le forum est resté un lieu où je pouvais discuter d’une partie de mes souffrances personnelles. En revanche, concernant celles, importantes alors, liées à mes peurs et aux rejets rencontrés en lien avec mon mémoire, à la fois par honte et pour ne pas me discréditer en tant qu’anthropologue (c’était le dernier lieu qui me restait pour faire mes demandes), je les ai tues [11] . Ce moment a été très inconfortable pour moi, car si contrairement à d’autres victimes d’inceste je ne parle pas de ce forum comme d’une « famille de cœur » (par opposition à la « morte famille », comme l’y formule l’une des personnes en parlant de sa famille d’origine), il reste clair qu’il a une importance assez similaire à mes yeux. C’est alors que j’ai également repris contact avec l’association nantaise en tant que telle, pour avoir alors là aussi une fin de non recevoir : on me renvoyait au travail que j’allais mettre en place avec l’association grenobloise, et on me souhaitait : « que cette année qui commence soit conforme à tes désirs les plus profonds », après m’avoir expliqué qu’il était possible que des « freins inconscients » s’installent au cours d’un travail sur un sujet aussi proche de soi. A ce stade, j’étais totalement démoralisée. Ceci, ironiquement, coexistait en moi avec mes souvenir de la « journée de recherche », ceux de personnes sur le forum internet (« on ne parle jamais de nous »), ainsi que ceux de mes conversations téléphoniques où l’on me relatait que l’association grenobloise avait eu déjà au moins quinze demandes d’étudiant/e/s au fil des années, qui n’avaient pu aboutir à cause de l’angoisse des … encadrant/e/s enseignants. Il est certain que, entre les difficultés rencontrées dans l’université, et celles rencontrées via des associations qui se « méfient des étrangers », tout concourt finalement à dissuader d’effectuer un travail de recherche sur cette thématique. Malgré tout, j’ai répondu au courriel. Après plusieurs échanges de mails, la véritable situation était rétablie : j’apprenais que l’association SOS inceste Grenoble était en réalité en crise, n’avait notamment quasiment plus d’écoutantes, en plus de s’être fait récemment retirer son local prêté par la municipalité depuis les années 80. Mon interlocutrice comprenait quant à elle que j’avais eu à effectuer un « vrai parcours du combattant », et m’apprenait que, à leur connaissance, j’étais : « la première à aborder le côté anthropologique, car nous avons aidé pour des mémoires d’éducateurs ou d’assistantes sociales, mais pas d’autres secteurs » (courriel du 04/02/2008). Cela fait écho avec mes déconvenues dans les associations lyonnaises où j’ai cherché, vainement, un stage en tant qu’étudiante en master d’anthropologie. Ainsi, une association s’occupant de lutter contre la maltraitance envers les enfants me demande ce que peut faire une anthropologue en tant que stagiaire. Je lui réponds en employant le mot « observer », ce qui semble avoir fait tourner court à toute vélléité de recrutement. Il m’a alors été signifié que « même les étudiant/e/s de master 2 en psychologie, nous les refusons comme stagiaires ». En revanche, lorsque j’ai glissé dans la conversation l’information selon laquelle j’avais été victime d’inceste pour expliquer mon point de vue personnel sur la prévention, l’entretien a tout de suite évolué, à l’initiative de mon interlocutrice, vers un entretien « d’aide à victime », avec interrogatoire serré (avez-vous des frères et sœurs ? Avez-vous porté plainte ? Etc). Malgré mes protestations, je me suis donc retrouvée dans le rôle (non souhaité) de la « victime à aider », alors que j’étais venue chercher un stage ! Une association de lutte contre les violences faites aux femmes, recontactée par téléphone après envoi d’un courrier, me demande : « vous étudiez dans quelle discipline ? », et suite à ma réponse, m’informe qu’elles ont déjà un stagiaire et ne peuvent en accueillir d’autres. Toutefois, lorsque je demande : « c’est ma filière d’étude qui ne vous enthousiasme pas ? », la réponse qui m’est donnée est « non ». Enfin, ma demande de stage au planning familial, pourtant communiquée via relation militante, est elle aussi rejetée : dans la réponse, il apparaît clairement que l’anthropologie ne leur semble pas faire partie des disciplines prioritaires pour l’accueil de stagiaires chez eux : « Nous avons pris connaissance de votre demande de stage dans le cadre de vos études en Master 1 d 'anthropologie à l'université Lyon 2. Malheureusement nous sommes submergées par les demandes de stages de diverses formation, notre calendrier d'accueil de stagiaires est complet pour le premier semestre 2008 et devant faire des choix nous privilégions les stages en lien avec les formations représentées au sein du planning : assistante sociale, infirmière, conseillère conjugale, médecins par exemple. ». Finalement, à ma grande surprise, les associations ont donc plutôt (à une exception) constitué un barrage qu’une aide à la mise en relation avec des personnes victimes d’inceste, ce alors même que leur discours habituel est fréquemment du type « on n’en parle pas assez dans la société, il faudrait en parler plus ». Sous le coup de ces échecs avec l’univers associatif, d’une part, et placée d’autre part devant la demande nouvelle de fournir une liste de questions précises à mon interlocutrice de SOS inceste Nantes pour en discuter avec elle avant toute rencontre avec des victimes, j’ai définitivement renoncé. J’ai répondu que cette discussion méthodologique s’effectuait entre moi et mes enseignants, et que suite aux traitements douloureux pour moi de la part de la sphère associative, je préférais contacter directement les victimes sans passer par l’intermédiaire d’associations. d. Une dernière difficulté : la mise au secret des incesté/e/s par leurs prochesJ’ai donc tenté de passer par d’autres biais : en plus du forum internet qui me permettait de communiquer directement ma demande à d’autres victimes qui me connaissaient déjà, j’ai eu recours à des proches de victimes. Seul l’un d’entre eux/elles, un ami étudiant qui me connaît bien depuis plusieurs années, a transmis ma demande à une personne qu’il connaissait, et avec qui j’ai eu ensuite un entretien. Une étudiante en anthropologie rencontrée à la sortie d’un colloque m’a informée qu’elle avait une copine concernée, mais elle ne savait pas si cela rentrait « dans mon sujet », car c’était par un oncle (je lui réponds oui, c’est de l’inceste). Puis, lorsque nous nous revoyons peu après, elle s’enquiert, inquiète, de la qualité et du sérieux de mon encadrement, « est-ce que tu as vu avec ton directeur de mémoire pour les entretiens concrètement ? ». Malgré un « oui » en réponse, je n’ai jamais eu aucun retour de cette personne ensuite. Une doctorante en sciences sociales, qui a répondu à mon annonce « recherche victimes d’inceste pour mémoire d’anthropologie », passée sur la liste de diffusion d’études de genres EFIGIES, m’a donné les coordonnées du collectif féministe contre le viol à Paris, que je n’ai finalement pas eues à utiliser, et m’a expliqué que, « au cas où », elle connaissait des victimes elle-même, mais qu’elle préférait ne leur parler de ma demande qu’en dernier recours car ces dernières étaient réticentes. Suite à ma demande de précision concernant ces réticences, elle m’explique : « Pour mes amies/connaissances, la réticence est aussi mienne, elles m’ont fait partager leur secret et il y a une sorte d’accord tacite entre nous autour de ça » (courriel du 08/01/2008). Le secret apparaît finalement ici comme utilisé à l’insu même des victimes. Cela me paraît ressembler beaucoup aux barrières rencontrées de la part des associations, d’autant qu’ensuite, mon interlocutrice ajoute : « Sinon, je pense vraiment que tu peux faire déjà beaucoup avec les témoignages publiés », on en revient donc aux, sempiternels, livres de témoignages, il est vrai en nombre important aujourd’hui. Ces barrières, individuelles ou associatives, reviennent en fait à « protéger » les victimes à leur insu, sans s’enquérir de ce qu’elles en pensent, en ne leur transmettant pas une demande, que ce soit pour des raisons de secret tacite, ou de dangerosité supposée de la démarche. Elles reviennent finalement, de fait, à les maintenir « au secret ». Pour le bien de qui ? 2) Présentation des personnes avec qui j’ai eu des entretiensCe sont au final principalement mes possibilités de relations directes avec des victimes d’inceste car victime moi-même, qui m’ont permis de contourner ces barrages. Sur quatre personnes du forum m’ayant répondu être intéressées, j’ai eu deux entretiens. L’un avec une personne avec qui je n’avais jamais échangé auparavant, et qui intervenait quasi-uniquement pour aider les autres personnes sur le forum. L’autre avec une personne dont je me souvenais mieux, malgré que j’aie eu également assez peu d’échanges avec elle jusque là : elle avait laissé beaucoup plus de bouts de son histoire dans ses posts. Une troisième personne pensait passer par Lyon, mais en avril, et à cette date j’avais déjà suffisamment d’entretiens. Elle m’avait précisé m’avoir répondu quant à elle car elle me connaissait déjà via le forum. Enfin, de la quatrième personne qui m’a répondue par ce média, je savais qu’elle résidait en région lyonnaise, encore au domicile d’un de ses abuseurs (un frère), qu’elle était jeune majeure, avait écrit peu de temps auparavant à propos du mal qu’elle s’était encore fait avec son compas, et n’avait encore confié à personne de fiable, hors du forum, le mal qui lui a été fait à elle. Je ne sais pas bien laquelle de nous deux était la plus effrayée à l’idée d’un entretien ensemble pour un mémoire universitaire. Je sais juste que de mon côté, je ne me sentais pas très rassurée. Je lui ai donc proposé plusieurs choix possibles : cet entretien là, pour mon mémoire, ou bien parler ensemble simplement pour qu’elle puisse se confier à quelqu’un une première fois, ou bien l’accompagner à l’association « La Porte Ouverte » ce dont nous avions déjà parlé auparavant, et boire un coup ensemble ensuite, les trois options pouvant aussi se succéder dans le temps. C’était bien l’entretien pour le mémoire qui l’intéressait, mais elle avait peur de ses réactions (de pleurer, de ne pas parvenir à parler, etc), et je dois dire que ces peurs faisaient alors écho aux miennes (avec le spectre du compas). Puis un nouvel événement de sa vie a fait qu’elle n’a, une fois de plus, pas réapparu durant plusieurs mois sur le forum. Par ailleurs, une personne qui participait au groupe de parole grenoblois et avec qui je discutais beaucoup m’avait dit, et répété, être intéressée. J’ai donc eu un entretien avec elle, ainsi qu’ensuite avec la personne de l’association qui soutenait ma demande, et qui devant mes difficultés avec le milieu associatif, après m’avoir gratifiée, lors de cette énième conversation téléphonique, d’un : « je ne te l’ai pas dit tout de suite pour ne pas te décourager, mais c’est extrêmement difficile d’obtenir des témoignages de victimes », m’a proposé son témoignage à elle. Enfin, j’ai eu un entretien avec une dernière victime, Danielle, contactée hors réseau associatif, via mon ami étudiant. Elle n’était pas sûre de rentrer dans la case « inceste », parce que c’était « le grand-père par alliance de son cousin ». Cet entretien est le seul à s’être déroulé à mon domicile à moi. La personne avait mon âge, un peu plus de trente ans, ce qui était assez étrange pour moi lorsqu’elle citait des dates passées par exemple. Après avoir été étudiante en sciences humaines, elle travaille dans le secteur du théâtre en tant qu’intermittente. Je sépare la présentation de chacune des autres personnes du média par lequel j’ai pu les contacter, ceci pour des raisons d’anonymisation. De même, les noms ont bien sûr tous été modifiés. J’ai réalisé mon premier entretien avec Aurélie, qui a environ 50 ans aujourd’hui, est actuellement sans emploi, et a été abusée par son demi-frère à partir de l’âge de 5 ans au moins. L’entretien a eu lieu dans une chambre d’un hôtel lyonnais de banlieue où elle était de passage, début janvier. Ensuite, j’ai eu un entretien avec Agnès, que je connaissais comme agressée par son père, et qui m’a appris lors de l’entretien l’avoir été également par certains de ses frères. Cet entretien a eu lieu chez elle. Elle est sans emploi suite à de gros problèmes de harcèlement de la part de son employeur, et âgée d’environ 50 ans aujourd’hui. Puis j’ai eu également un entretien avec Paulette, qui n’était pas sûre de rentrer dans mon sujet : « parce que moi, tu comprends, c’était dans une famille d’accueil ». L’entretien s’est également déroulé chez elle, et il s’avère qu’en plus de ce qui lui est arrivé dans cette famille d’accueil pendant la guerre, au bout d’un certain temps d’entretien, elle m’explique avoir aussi été agressée par un cousin. Elle a été enseignante-chercheuse dans un pays anglo-saxon, puis en France. Etant née peu avant la seconde guerre mondiale, elle est aujourd’hui retraitée. Elle avait environ 8 ans lors des abus dans sa famille d’accueil. Ensuite, j’ai été voir Lydia, qui était manifestement, suite au procès de son agresseur, dans une démarche de témoignage : elle avait déjà témoigné pour un journal, m’a répondu être intéressée, et a depuis de nouveau témoigné devant des journalistes, ce qui déplaît d’ailleurs à sa famille. Faudrait-il qu’elle se taise encore sur ceci : elle a été violée par son père de ses 11 ans à son départ du domicile, peu avant ses 18 ans ? L’entretien a eu lieu dans l’appartement où elle est logée en tant que gardienne d’immeuble. Sur la table, à mon arrivée et durant tout l’entretien, un gros dossier : les papiers du procès et les articles de presse associés. Lydia a un peu moins de 30 ans aujourd’hui. Finalement, alors que les témoignages écrits et publiés auxquels me renvoyaient les associations et certains proches concernent quasi exclusivement des viols par le père, j’ai donc eu accès à des cas de figure très variés, de personnes qui n’ont de surcroît pas forcément accès au réseau éditorial ou envie ou possibilité d’écrire, et qui n’auraient pas forcément témoigné autrement. L’attitude des associations envers mes demandes, plus ce constat, m’ont conduite à une remise en question de mes croyances concernant la démarche de témoignage public, que je croyais très courante d’après ce que je lisais sur le forum internet, les nécessités de mise sur la place publique que j’avais ressentie moi-même concernant mon histoire, et les contenus des témoignages publiés existants. Si je m’étais limitée, comme on me le suggérait avec insistance, à ces écrits, je n’aurais rien découvert que je ne savais déjà. 3) Le cadre et ses garant/e/s légitimesMes difficultés avec le monde associatif, mes propres doutes sur moi, ainsi que par exemple la question d’une enseignante en anthropologie lors d’une présentation de nos thèmes de recherche : « avez-vous une formation en psychologie ? », posent aussi la question de la légitimité d’une approche « hors psy » et sans « psy » dans les environs, de ce sujet, avec des victimes d’inceste en chair et en os. Par exemple, les ateliers de recherche de l’association AREVI étaient modérés par un psychologue, jusqu’à récemment. Cette formule a été abandonnée car cela transformait les ateliers en « groupe de parole thérapeutique bis ». La décision d’AREVI a été que désormais, le cadre, ce serait simplement le thème de l’atelier, connu à l’avance, et le magnétophone. Moi-même, la présence d’un psychologue comme modérateur d’un atelier de recherche-action ne m’avait jusque là ni frappée ni intriguée. Mais finalement, pourquoi l’anthropologue a-t-il/elle besoin du/de la psychologue pour créer un cadre permettant le récit de façon qui ne refasse pas traumatisme ? Où se situe le danger ? Dans mon cas, le premier entretien a débuté comme une discussion sur nos histoires respectives, par défaut de question initiale clairement formulée de ma part. C’est cette discussion et l’évocation du lieu où nous nous sommes rencontrées via l’association, qui ont permis à l’entretien de commencer, malgré le trac intense que nous partagions l’une et l’autre et nous sommes mutuellement avouées … après l’entretien enregistré. Je me suis rendue compte que le fait d’avoir un gros magnétophone à cassettes était une bonne chose (pour moi pour commencer) : cela me permettait des pauses dans l’écoute (pour retourner la cassette), de visibiliser clairement qu’il ne s’agissait pas d’une discussion « entre soi » mais d’un récit qui avait une dimension publique, et aussi d’avoir, avec les cassettes qui défilent, la notion du temps qui passe. Car passés l’appréhension et les silences du début, les entretiens donnaient l’impression de pouvoir continuer indéfiniment. Voilà comment s’est constitué mon cadre d’entretien à moi : un matériel désormais volontairement très visible ; et puisque c’était l’évocation d’un lieu commun clairement identifié comme à destination des victimes d’inceste qui avait permis à mon interlocutrice de se sentir en confiance, la question de début d’entretien allait être du type : « on s’est rencontrées via (le forum, le groupe de parole, etc) de l’association SOS inceste pour revivre. Comment es-tu arrivée jusqu’à cette association ? Peux-tu me raconter ? ». Finalement, en général, et malgré le nombre important de cassettes emporté, il n’y avait souvent pas assez de cassettes (j’emportais pour 4h d’enregistrement à chaque fois). La discussion a généralement continué ensuite, nous avons fait connaissance, j’ai plusieurs fois été invitée à manger, voire été hébergée pour la nuit. C’est ainsi que je suis souvent partie après un long temps passé avec les personnes, qui faisait suite aux trois à quatre heures d’entretien pour mon travail universitaire. J’ai eu peu de silences, durant et après les entretiens. Il m’a souvent été dit par mes interlocutrices que ma situation de victime d’inceste moi aussi, rend(r)ait plus facile de parler malgré le fait d’avoir à s’habituer au magnétophone, voire que « seule une victime peut comprendre une victime » (sous-entendu « victime d’inceste ») : ici, « anthropologue-victime d’inceste », ce n’est pas une étrangeté inquiétante, c’est un caractère hybride rassurant. Enfin, les retours que j’ai eus ensuite, quand j’ai pu en avoir, ont été positifs, ce qui m’a rassurée moi (par rapport à mes craintes). Un échange par SMS m’apprend ainsi que j’ai été « très attentive, rien que ça vaut un coup de pompe. Quel travail tu fais. Merci pour nous. ». Par intermédiaire, j’apprends qu’une autre des personnes a apprécié de pouvoir parler ainsi de son histoire, précisément parce qu’elle ne peut pas, pour l’instant, envisager d’en parler avec un/e « psy ». Ces entretiens ont donc constitué un cadre différent de ceux plus habituellement proposés aux victimes d’inceste, mais positif pour les personnes (moi incluse), en plus de contribuer à la réalisation de mon mémoire : alors que j’avais peur de faire du mal, peur renforcée par celles, apparemment identiques, d’associations, il semblerait que finalement, j’ai surtout contribué à permettre à des personnes de se sentir écoutées, en prenant le temps pour cela, dans un cadre, clairement explicité, qui leur convenait à elles. 4) Mais au fait … une étude non psychologique de l’inceste est-elle pertinente ?Au-delà de ces questions de cadre, les violences sexuelles incestueuses semblent, néanmoins, à priori relever de la pathologie mentale, et constituer par suite un objet d’étude qui concerne surtout la psychologie. Dès lors, il peut être difficile de concevoir une approche de ces phénomènes via les sciences sociales, tout comme concernant par exemple la sorcellerie en Normandie : « l’idée d’une enquête sociologique sur les sorts paraissait inintelligible : les sorts, cela ne concerne jamais que des individus » (Jeanne Favret-Saada, 2005, p. 70 note n°10). Pourtant, via ma participation au forum internet évoqué plus haut, j’avais été frappée par ce phénomène de vécu collectif par delà les histoires et manières de réagir singulières … et cela n’a pas été alors sans me rappeler l’apport des « groupes de prise de conscience » féministes des années 1970, dont l’histoire m’a été transmise par des militantes de cette époque il y a quelques années, et qui ont fait se rendre compte à des femmes que des violences qu’elles croyaient individuelles, étaient en fait, bien sûr, également un phénomène pleinement social. Cela leur a permis par la suite de poser le problème du viol, de l’analyser non plus comme l’œuvre de malades mentaux isolés, mais comme un crime contre les femmes s’inscrivant au service d’un système de domination nommé patriarcat (Susan Brownmiller, 1978). Cette nouvelle manière de percevoir le viol, portée par un vaste mouvement social, a permis ensuite des évolutions importantes à ce sujet, notamment sur le plan juridique (Georges Vigarello, 1998). Dès lors, je m’étais posée la question d’analyser les violences sexuelles incestueuses non plus sous l’angle de la psychologie, mais d’une science de la société. Pour autant, il me faut observer ici que les analyses en termes de « crime contre les femmes », pour reprendre cet exemple, semblent ici rapidement insuffisantes. En effet, intervient également, de manière fondamentale la façon dont est considéré l’enfant dans sa famille ainsi que par la société entière. L’enfant de sexe féminin mais aussi, même si je n’ai pas eu d’hommes en entretien, celui de sexe masculin. Il y a des garçons incestés, qui constituent par exemple un peu moins d’une dizaine de personnes intervenant sur un forum internet comptant quelques centaines de personnes inscrites. Il existe également des femmes incesteuses, notamment des mères, ce qui constitue un tabou dans le tabou, comme le relate par exemple la journaliste Anne Poiret : « Je pense qu’un tel sujet ne peut que passionner mes interlocuteurs : le sujet n’a jamais été traité. Je crois qu’il va falloir faire vite pour éviter qu’un confrère me devance : l’article [qu’elle a vu en 2001 dans le magazine Marie-Claire, et qui lui a donné l’idée de réaliser ce reportage sur les mères incesteuses] date déjà de quelques semaines. Je ne sais pas encore qu’il va me falloir près de deux ans et demi pour voir ce projet aboutir. (…) « Le sujet n’existe pas », « phénomène trop marginal ! » « et pourquoi pas des nains zoophiles ! » « trop dérangeant ! On fait de la télévision tout de même ! » Sur tous les tons, toujours la même réponse de la part des producteurs : « Non ! ».» (A. Poiret, 2006, p. 10-11). Ces mères représenteraient un pourcentage très faible des incestes, néanmoins, elles existent elles aussi, renvoyant, en sus de la problématique de genre (le viol, agression d’homme sur une femme), et en articulation avec elle, à la hiérarchie adulte/enfant. Enfin, les incestes entre enfants, renvoient eux, en sus, à la place de chacun/e dans la fratrie, c’est à dire à la hiérarchie aîné/e/s / cadet/te/s notamment. Dès lors, il ne s’agit pas de calquer aveuglément une analyse féministe du viol sur la problématique de l’inceste, « féministe » étant entendu ici dans le sens scientifique (« gender studies ») et non proprement militant. En revanche, expliquer les violences sexuelles incestueuses uniquement via le cadre de référence de la psychologie comme c’était le cas jusqu’à récemment (2004), est en réalité insuffisant. En effet, « si un phénomène admet une explication, il admettra aussi un certain nombre d’autres explications, tout aussi capables que la première d’élucider la nature du phénomène en question », et, en particulier, « dans l’étude de l’Homme (mais non seulement dans l’étude de l’Homme), il est non seulement possible, mais obligatoire d’expliquer un comportement, déjà expliqué d’une manière, aussi d’une autre manière – c’est à dire dans le cadre d’un autre système de référence. (…) Le fait est qu’un phénomène humain qui n’est expliqué que d’une seule manière n’est pour ainsi dire pas expliqué du tout … et cela même et surtout si sa première explication le rend parfaitement compréhensible, contrôlable et prévisible dans le cadre de référence qui lui appartient en propre. » (Georges Devereux, 1985, p. 13). C’est ainsi que, loin de se contredire ou de s’opposer « en tant qu’appropriations respectives de « territoires » » (François Laplantine, 2007, p. 61), c’est à dire d’appropriation d’objets d’étude par l’une ou par l’autre, l’explication anthropologique et l’explication psychologique du phénomène sont, au contraire, un moyen d’avoir plusieurs points de vue différents et complémentaires sur un même objet, permettant de mieux le connaître : « lorsqu’un effort explicatif supplémentaire fourni par le psychologue cesse de produire un rendement supplémentaire proportionnel à son effort supplémentaire, bref, lorsqu’il cesse d’être rentable, il est temps de faire appel aux explications sociologiques [ou anthropologiques] … et inversement » (Georges Devereux, 1985, p. 17). C’est à la construction
d’une telle compréhension anthropologique que je vais maintenant
apporter ma contribution.
IV-Décrire la démolition … et ses suites Précision : lorsqu’il est noté « Hmmhmm » dans les retranscriptions, il faut s’imaginer un mouvement d’acquiescement, de la tête, ponctué d’un son – noté « Hmmhmm », difficilement transcriptible par écrit. J’ai par ailleurs ôté la plupart des « heu » et autres manières propres à l’oral, en ne laissant que les plus marquées, afin de faciliter la lecture. 1) La vie de famille : ouvrons la porte et allumons la lumièrea. « Hitler, je l'avais à la maison »« Hitler, je l’avais à la maison », m’explique Lydia. La porte ainsi ouverte sur la vie de famille est bien particulière, c’est un monde qui peut sembler incroyable, bien éloigné en tout cas des représentations communes sur la famille, ce lieu dont on attendrait entraide, protection, voire affection. L’on peut effectivement s’imaginer « Hitler à la maison », ou bien comme Eva Thomas dans ses ouvrages, faire un parallèle avec les camps nazi. Un mini-ordre nazi dans la famille ? Eva Thomas est née en 1942, et a été anorexique suite au viol par son père. En l’absence de parole publique sur l’inceste, s’est-elle reconnue dans l’expérience de démolition vécue par ces rescapé/e/s des camps si amaigri/e/s ? La seconde guerre mondiale et en particulier le nazisme ont été quant à eux l’objet de descriptions publiques, à l’école, à la télévision … et sont synonymes de l’horreur la plus extrême. « Hitler » (Lydia) ou bien « SS » (Agnès) sont également des termes assez clairs. Les violences incestueuses sont
alors synonymes de l’horreur la plus extrême dans la famille,
et non dans un camp nazi. C’est une violence impensée et non
dite, parfois qualifiée d’impensable et d’indicible, quand elle
n’est pas simplement minimisée ou niée. Pourtant, un objet majeur
de ce mémoire est de la penser, de la dire et de la décrire. De
la montrer. Car, comme l’explique Alice Verstraeten, « L’indicible
et l’impensable sont, bien sûr, des pièges de la pensée. Le crime
ne peut être totalement impensable, dans le sens où il a été pensé
pour être mis en place. En le rendant intouchable, on rend également
le crime perpétuellement valable, toujours en action, victorieux »
(Alice Verstraeten, 2005, p. 4). Ici aussi, il faut comprendre
que le crime a été pensé, et non commis dans un état altéré de
conscience : un seul des incesteurs relatés dans mes entretiens
est alcoolique. « Moi-Ce qui veut dire que quand il vous incestait, c’était à jeun, quoi, entre guillemets ? Agnès-Ouais, ouais. C’étaient des pulsions, comme ça, un petit effet fébrile, d’excitation, quand il ouvrait la porte de la chambre avec ses yeux, on sentait qu’il avait un plaisir, il savait qu’il pouvait surprendre en train de nous déshabiller, des choses comme ça. M-Hmmhmm A-Je veux dire, moi, le jour où il a fait des attouchements, bon, ben c’était un jour où il était calme, on avait fait le trajet en voiture jusqu’au lac, je m’ennuyais, j’avais froid, je suis rentrée dans la voiture, puis euh, il est passé d’un état de concentration et d’absence, il ne s’occupait pas de moi en train de pêcher, moi ça a été la surprise totale quand il est rentré dans la voiture et puis(…). Avec un regard et puis une excitation quel, quelque chose de, de particulier, que je lui connaissais pas, il avait pas d’alcool avec lui. M-Oui oui oui, donc c’était totalement, en plus vous étiez seuls à pêcher euh, enfin… A-Ouais, ouais en plus il faisait un peu froid [inaudible] : un jour où y’avait pas trop de pêcheurs, donc euh, y’avait pas grand monde, donc euh, ça, ça pouvait se passer … (Soupir chargé) Ca fait longtemps que j’avais pas parlé de tout ça en un seul bloc, Fiouuu… » « Agnès-mon père était toujours à faire des propos très douteux sur la sexualité, sur les femmes, très vulgaire et très rabaissant pour les femmes (…). M-T’as des souvenirs, t’as des souvenirs de ce genre de propos ? A-(Silence) Qu’est-ce qu’il di…qu’est-ce qu’il pouvait dire ? Euh, « les femmes sont toutes des salopes », euh, « de toute façon, c’est nous qui avons le travail le plus difficile parce que », en parlant de la sexualité, en faisant une métaphore il disait : « la femme elle a qu’à ouvrir la bouche c’est facile, nous il faut qu’on tende le bras », tu vois un petit peu ce… M-Donc euh, devant ses enfants et … en parlant à tout le monde ? A-Ah oui oui, à table : en général c’était le moment où tout le monde était groupé, et où on était obligés d’être là [mère, enfants et grand-mère maternelle] (…) le repas familial, c’était une obligation : qu’on soit à l’heure au repas et qu’on mange ensemble. (…) Et en général il y avait, on était obligés de rester à table, il y avait, après la télévision, donc tout le monde restait là et puis le départ c’était aller se coucher. (…) Alors aller se coucher, ça voulait pas dire le début de la tranquillité, ça voulait dire aussi que mon père souvent, il déboulait dans les chambres, sournoisement il ouvrait brutalement la porte à des moments où on pouvait être en train de se déshabiller, des choses comme ça. Donc il y avait tout un rituel de protection pour se coucher sans être euh, surpris. Mais déjà, rien de très sécurisant hein. M-Oui ! Euh … ça tu t’en es toujours souvenue ? A-Ah oui ben c’est frappant comme souvenir, bien sûr. Oui oui, oui oui. [C’est en fait du, ou des viols nocturnes, probablement par son grand frère, qu’Agnès a été amnésique durant longtemps] (…) y’a pas eu de viol paternel, mais y’a eu (…) comportements incestueux, regards incestueux, paroles, attentions incestueuses si tu veux, ça revient un peu au même au niveau ressenti. Y’a eu ces, ces intrusions euh, dans ma chambre à des moments M-Tous les soirs ? A-Pas tous les soirs, parce que sinon euh, il nous surprenait pas. Il était malin. (…) M-Donc des soirs par surprise, et pendant des années et des années ? A-Ouais. Ben oui, jusqu’à ce que je quitte la maison. » L’irrégularité, l’imprévisibilité, apparaît ici centrale, tant dans les abus (attouchements et voyeurisme), qu’au quotidien, où Agnès ne demande jamais rien car « Agnès-Il interprétait il déformait mes propos et ça devenait une sorte d’agression pour lui et puis je me prenais des roustes [inaudible] et j’en passe des détails. Donc euh, puis même des fois sans bouger, il suffisait qu’on fasse tomber quelque chose comme ça [elle laisse tomber un petit objet sur la table], ça le faisait sursauter et vlan, chtak, [suite inaudible]. » Pourtant, le père d’Agnès sait aussi se montrer très prévisible « Agnès-Et alors, recta hein. Tous les matins debout à l’heure, toujours au boulot, jamais malade, toujours le même rythme, la même manière d’être : rentrer à telle heure, comme un rituel, c’était vraiment … voilà. Non mais c’était quelque chose. M-Fhm ! Un pré-militaire ? Un petit peu réglé euh … A-On ne peut plus militaire, oui, c’était plus que militaire, je dirais, c’était heu, plutôt du genre euh, (silence) je veux pas dire SS, mais pas loin quoi. M-Fhm ! Hmmhmm. A-C’était quand même l’Inquisition. C’est à dire que, il était à l’écoute de tout ce qu’on disait, on pouvait pas parler. Faire des confidences à notre maman, ben, il déboulait dans la pièce très vite pour venir écouter, puis il nous forçait à dire ce qu’on était en train de dire. Ca c’est son côté un peu parano heu, entre l’alcool et tout ça, il avait toujours l’impression qu’on parlait de lui, enfin donc ce qu’il faisait … » Ce qui peut, d’une part, faire penser à l’univers de la torture : « L’univers de la torture est construit autour de la figure du paradoxe. C’est ainsi que l’imprévisibilité la plus totale coexiste avec un code obsessionnel, rigoureux, net et pensé dans ses moindres détails. » (Françoise Sironi, 1999, p. 29), et d’autre part, il faut noter l’importance du contrôle relationnel : c’était « l’Inquisition », qu’Agnès explique ici par un caractère « parano » et « l’alcool ». L’alcool ? Parlons-en : « Agnès-l’alcool, bon c’était jamais quand il travaillait. (…) A l’extérieur, il fallait qu’il se tienne bien hein, il avait toujours une position heu M-Ouais. Donc c’était quand qu’il buvait ? A-Il buvait en général un peu le soir avant d’aller se coucher, et le week-end. Il passait ses week-end devant la télé, à jouer aux cartes avec ma mère, à lui imposer des heures et des heures de jeu de cartes (...) Et il avait toujours ses bières [de 75 cl] à côté de lui, son tas de cacahuètes, ses week-end se passaient comme ça. » Ce contrôle des relations et des activités est en fait omniprésent dans l’espace domestique : « Agnès-Avec mon frère Nicolas je m’entendais hyperbien. (…) C’était un garçon très doux et très sensible, mais jusqu’à un certain point. Après, relationnellement dans la famille j’ai pas pu faire plus, parce que mon père ne voulait surtout pas que je rentre dans la chambre de mon frère : on sait jamais ce qui pouvait se passer. (…) Donc, intérieurement à la famille, il a un peu mis des freins à la relation. De toute façon, c’est lui qui décidait de tout, qui mettait les limites qu’il voulait (…). Mais toujours avec son, son, son rapport déformé à la relation. » Il me semble possible de mettre en lien ce contrôle omniprésent et, comme sa résultante, ce que m’explique Agnès à un autre moment de l’entretien concernant les relations intrafamiliales : « Agnès-Donc on s’élevait, on était en famille, famille nombreuse, un peu repliés sur nous, y’avait pas de communication à l’intérieur, et on trouvait euh [inaudible] à l’extérieur. M-Vous étiez … finalement, les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres. A-Ouais. Ouais, tout à fait c’est ça. » Stéphane La Branche relève : « L’isolement est donc, plus qu’une simple technique carcérale, un effet recherché dans la société toute entière par le système de torture. Or, on retrouve également cette atomisation de l’individu dans les familles incestueuses car les membres de celles-ci ne partagent pas les angoisses qu’ils subissent. Ils ne savent pas ce que les autres ressentent et en viennent ainsi à douter de la légitimité de leurs propres expériences. » (Stéphane La Branche, 2003, p. 31). Et à force, plus besoin de contrôle : comme dans le panoptique décrit par Michel Foucault (2004), « par peur des conséquences, et bien qu’ils ne sachent pas s’ils sont observés, les prisonniers [du panoptique] finissent par agir comme si la surveillance était constante. Ils en viennent à se surveiller eux-même et deviennent leurs propres gardiens. En d’autres termes, ils se disciplinent eux-mêmes. » (Stéphane La Branche, 2003, pp 19-20). C’est du moins une manière d’interpréter ce que nous décrit Agnès sur le comportement maternel (et le sien), quelques décennies plus tard : « Agnès-Oui oui non je pense que ma mère on n’aurait jamais pu en parler comme ça [si l’incesteur était encore en vie] parce que d’une elle répétait tout à mon père et que ça serait retombé ou sur sa tête ou sur la mienne » Ce contrôle a donc pour effet d’isoler chacun/e face au père/incesteur, dans un climat de délation et de peur de la rouste. Mais ce contrôle s’effectue aussi aux frontières : si Agnès peut rester dehors à jouer sur le palier avec ses copines, en revanche, la porte doit rester bien fermée sur l’espace familial, sous le contrôle de ce père incesteur « Agnès-y’avait pas d’ouverture vers l’extérieur. Interdiction d’amener des amies à la maison : on sait jamais parce que les amies à la maison des fois elles pourraient voler quelque chose quand on a le dos tourné. M-Hmmhmm A-Tu vois c’est vraiment le genre de choses euh (…) M-Et, et eux ils, ça leur arrivait d’inviter des gens ou d’aller chez des gens, d’avoir des amis de famille ? A-Très rarement, très rarement. M-Ca leur arrivait quand même ? A-C’est … arrivé … heu … (silence) si c’est arrivé une fois dans l’année c’était beaucoup. M-Hmmhmm A-Tu vois un peu le truc. M-Et c’étaient toujours les mêmes personnes, qu’ils invitaient ? A-Non. M-Non, ils avaient pas vraiment de, d’amis de famille en fait ? A-Non. Pour rentrer à la maison, c’était très difficile. Des amis, c’était que, relations de travail(…) M-Hmm. Et quand il y avait des invités à la maison, c’étaient des relations de travail, qui faisaient que passer et, et qui discutaient avec les adultes ? A-Non, avec nous y’avait pas de discussion. (…) C’était, de toute façon, mon père avait le monopole de la discussion. (…) C’était lui le meilleur M-Donc invités par ton père je suppose ? A-C’était invités par mon père, tout à fait : ma mère n’avait pas d’amis M-Jamais par ta mère ? A-Non non, elle n’avait pas de vie sociale du tout. » [elle était de plus mère au foyer] Et dans cet univers fermé avec soin, tout devient possible « Agnès-L’ambiance familiale m’a donné raison puisque ben j’ai assisté aux scènes entre mon père et puis sa belle-fille [de même mère qu’Agnès], y’a eu des cris, des scènes, des choses pas …(…) Pas du tout normales et euh M-Donc en plus dans ta famille, entre guillemets à l’intérieur ça se savait, ce qu’il faisait ? A-Oui. (…) Mais bon à l’époque ils avaient certainement pas conscience du mal qui était fait puis il fallait sauver la face à l’extérieur. Ca se passait à la maison donc une fois sortis, une fois à l’extérieur, c’étaient plus les mêmes, y’avait la façade (…) sociale, la carapace sociale, qui faisait que ça s’ébruitait pas dehors. On n’en parlait pas à la maison encore surtout il fallait pas, mon père a dit si jamais quelqu’un parle de quoi que ce soit de ce qui se passe à la maison à l’extérieur euh, ben il va recevoir. Y’avait interdiction de communiquer avec l’extérieur M-Moui oui oui A-interdiction aux gens de l’extérieur de rentrer à la maison M-Hmm hmm. A-Tu vois c’est M-Oui oui, je vois bien oui. A-C’est un circuit fermé » Circuit qui pourrait aussi bien être résumé ainsi : « La déshumanisation (…) se fabrique par tripotage sexuel toujours accompagné de quolibets obscènes. Dans cet univers clos, on viole comme on respire : « De toute façon, tu n’es qu’un tas de chair ». » (Françoise Sironi, 1999, p. 30). L’univers clos évoqué par Françoise Sironi est pourtant bien différent : il s’agit de geôles où l’on torture, et les propos qu’elle cite sont ceux d’un tortionnaire rapportés par une de ses victimes. Bien différent, mais néanmoins ressemblant : le prisme permettant le mieux d’appréhender les abus incestueux, ce n’est donc pas la « caresse paternelle » évoquée par Robert Deliège, ce sont le toucher et les techniques de démolition du tortionnaire. Tortionnaire qui dans le cas précis évoqué ici s’appelle « papa » [12] . Agnès a été beaucoup frappée par son père, la violence physique tenait une place importante dans la création du climat de peur : de terreur, pour reprendre son mot. Pourtant, elle n’est pas la seule stratégie possible pour ce faire. Le père de Lydia (que Lydia nomme « l’ex-mari de ma mère » ou bien « lui »), ressemble sur bien des points à celui d’Agnès, bien qu’il ne consomme pas, quant à lui, une goutte d’alcool. C’est aussi lui qui décide de tout dans la maison. Elle a pu constater, de même, que sa mère et sa sœur aînée Elise répétaient tout à cet incesteur. Les attouchements, puis les viols que subit Lydia de 11 ans à 18 ans, c’est le soir, avec la même imprévisibilité que les irruptions du père d’Agnès dans les chambres. En revanche, première nuance, le contrôle semble différencié selon les frères et sœurs : sur Lydia, il est très strict. Interdiction d’inviter des copines, mais aussi de sortir, notamment si elle tente de résister à un des viols infligés par son incesteur. Pourtant, la violence physique en est quasiment absente : en fait, ici, le regard suffit. « Lydia-Un regard et je me pissais dessus de peur. Même un jour, c’était au pavillon, je devais avoir peut être une dizaine d’années, je sais même pas. J’avais un (c’est un souvenir que j’avais, hein), j’avais un pèse personne dans les mains, le téléphone sonne, de peur, j’ai lâché le pèse personne, de peur de la réaction de lui je me suis pissée dessus. Pour dire à quel point je le craignais. Euh, les gens ne se rendent pas compte à l’heure actuelle qu’on puisse craindre, qu’une fille puisse craindre son père comme ça. J’en étais pétrifiée de peur. » Cela est peut-être le fruit d’un conditionnement précoce, d’un travail de sape préalable : « Lydia-ma marraine m’a expliqué quand je suis venue vivre chez elle, elle m’a dit : « mais quand t’étais petite » (donc je parlais quasiment à peine hein) « il te faisait les gros yeux et tu te mettais à pleurer ». (…) Et c’était un JEU pour lui. Parce que moi, j’en étais pétrifiée de peur, donc je pense maintenant avec le recul, et à force de fréquenter des psys, je pense qu’il a fait son travail de sape dès que je suis née. (…) Dès toute petite il a fait son travail de sape, ça, plus ça va plus j’en suis persuadée. C’est … parce que, pourquoi, quel a été l’intérêt, quand j’étais toute petite, que je parlais à peine, qu’il ait fait en sorte que je le craigne à ce point, au point qu’un regard et je me mettais sous la table à chialer ? Je me pissais dessus de peur. » De plus, cet homme possède des armes, un pistolet et une carabine, avec lesquelles il a tué un chien sur demande du maître. Ces armes ne sont jamais montrées, mais Et on sait qu’il peut tuer : le chien de la famille aurait également été tué par ses soins, ce que Lydia apprend par la presse que lui lit sa marraine au téléphone « Lydia-Voilà. Suspendu, euh, étranglé, voilà. (…) il était assez âgé hein. Donc, oui oui, c’était la fin, mais au lieu de le faire piquer, je pense, puisque bon, c’est payant, machin, le vétérinaire, bon je pense que voilà. » C’est d’ailleurs suite à des menaces de la tuer elle, qu’elle s’enfuit, paniquée, du domicile, deux mois avant ses 18 ans, et rejoint enfin cette marraine après avoir eu confirmation par la police, qui croyait à une banale dispute père/fille et ne voulait donc pas intervenir, qu’elle pouvait, à deux mois près, se considérer majeure. Mais « On sait maintenant que la menace de violence détruit la résistance plus efficacement que la coercition elle-même » (Stéphane La Branche, 2003, p. 24). Ainsi, la violence physique est une des modalités possible, mais pas forcément nécessaire, pour entretenir l’obéissance à l’incesteur. Obéissance qui peut atteindre des degrés surprenants, vu de l’extérieur, et lourds de culpabilisation pour celle qui a obéi : « Lydia-Comme le jour où elle a failli nous surprendre [sa mère] (…) En fait il était en train de me violer sur cette fameuse table dans le salon (…) Elle s’est levée. Donc lui bien sûr voulait pas que, voilà. Donc lui s’est caché, moi aussi. » Lydia s’est cachée … et sa mère a failli non pas LE surprendre, mais LES surprendre, dit-elle. De même, il faut noter son vocabulaire récurrent : elle ne cesse de répéter « quand je l’ai avoué », à chaque fois qu’elle évoque les viols incestueux qu’elle a subis. En effet, « Le codépendant [ici l’incesté/e] « collabore » avec l’abuseur (…) accepte le problème de l’abuseur comme étant le sien et finit par le protéger. L’abuseur prend, bien entendu, une part active dans ce processus en exerçant constamment une pression émotionnelle et psychologique de chantage, de dévalorisation, d’humiliation et de négation de l’identité de l’enfant. [Exemple] S’il est « gentil », l’alcoolique ne dit rien. Et un jour, l’enfant lui achète lui-même de l’alcool » (Stéphane La Branche, 2003, p. 32), ou se cache pour ne pas que l’abuseur soit pris sur le fait, et échapper ainsi à ses représailles. Lydia nous raconte ce qui s’est passé ensuite « Lydia- Elle a vu que son mari était pas au lit, elle a été aux toilettes, qui étaient juste là. Tout était fermé. Elle est retournée au lit, elle a dormi. Merci maman ce jour-là ça s’est terminé plus tôt que prévu. Mais jamais elle s’est posé la question cette nuit-là « mais il est où mon mari ? Il est pas dans le lit, tout est noir là-dedans, tout le monde dort, il est où ? ». M-Hmm. Hmm. Hmm. L-Voilà. Donc, c’est tout ces petits trucs qui font que je pense que ma mère était au courant, qu’elle n’avouera jamais. » Une autre différence, importante, de la famille de Lydia, est la présence d’amis de la famille : ici, il existe des liens extra-familiaux, des ouvertures. Les parrains et marraines des enfants sont choisis parmi ces ami/e/s, connus jadis dans un café me dit Lydia. Mais leur présence fréquente à la maison ne constitue pas automatiquement un recours. « Lydia-[Elise, la sœur aînée de Lydia : ] Elle était adulte, qu’il la tripatouillait devant tout le monde. Devant les amis, devant tout le monde (…) il la touchait, et elle le touchait. Elle lui touchait les parties, euh, c’est, c’était de la vie de tous les jours (…) et ça se faisait devant les amis aussi. M-Devant les amis de la famille ? L-Voilà (…) et y’en a même une que ben lui il tripatouill… enfin, il lui arrivait de lui toucher les seins. M-Une amie de la famille tu veux dire ? L-Ouais, ouais. M-C’est, enfin, quand tu dis amis de la famille, c’est qui qui les invitait, c’était ? L-Boh c’étaient les deux hein. Parce que, mes parents recevaient quand même, ils étaient assez bons vivants. (…) Je sais qu’ils venaient souvent à la maison, et moi j’aimais bien quand ils venaient à la maison. Parce que quand ils venaient à la maison, [inaudible], ça se passait pas. (…) Sauf une fois, où lui avait trouvé l’astuce, ce jour-là il a été très fort, euh, ma sœur [Elise] avait un appartement auquel elle n’habitait pas hein, donc lui avait convenu que les amis dormiraient dans la chambre de mes parents (…) Ma sœur machin dormait là. Que moi et lui, on dormirait dans l’appartement de ma frangine. (…) Personne a trouvé bizarre qu’il y ait qu’un lit, de 2 personnes, et que je doive dormir avec lui. » Il n’y avait d’ailleurs pas qu’Elise que l’incesteur « tripatouillait » « Moi-donc y’avait des choses qui étaient cachées et d’autres choses qui par contre étaient visibles ? Donc, parmi les choses visibles y’avait le tripotage entre ta sœur aînée et lui ? Lydia-Ouais. Même ma sœur Pascale, sauf que ma sœur Pascale elle gueulait. M-Hmmhmm L-Et c’est bizarre moi il me disait « t’es comme ta sœur Pascale » (…) Parce que quand il me tripatouillait devant les autres, je me sentais la force de …[pause impromptue] » Enfin, les familles de Lydia et Agnès sont particulièrement nombreuses. A cela, une explication simple : la place de leur mère, comparable, malgré une génération d'écart. « Moi-Ta mère avait pas le droit d’avoir des pilules, donc c’était lui qui décidait de tout là aussi ? Lydia-Oui. (…) en fait, ma marraine habitait sur le même palier. Donc ses enfants, donc Marion avait 17 ans à l’époque, elle était la meilleure amie de ma mère (…) et donc elle l’a vue, donc maintenant elle s’en rappelle, que il l’appelait, « tiens toi prête à telle heure », donc à telle heure fallait qu’elle soit dans la chambre les jambes écartées. Enfin bon c’est un peu exagéré mais c’était ça. (…) M-Mouais. Et, du coup, ça fait une question derrière : les enfants c’est qui qui a décidé de les faire ? L-Ah mais c’est lui hein. Même maman je lui ai dit, mais est-ce que au moins t’as voulu tes enfants est-ce que tu les as aimés ? » [années 1980-1990] « Moi-Ils se sont mariés avec ces enfants, et après ils en ont fait d’autres euh tu ? Agnès-Les cinq derrière. (rire) M-On dirait que ça fait cinq d’un coup tu sais. (rire) A-Non non, les cinq à la suite. M-(rire : ) Quand même ! A-Ben y’avait pas de gros écarts entre nous, y’avait maximum deux ans d’écart. M-Ouais, ouais. Et, toi tu sais comment ta mère s’est retrouvée à faire plein de gamins sans en avoir envie finalement puisque …enfin c’est ? A-Ben comment ? Parce que à l’époque euh y’avait pas de moyens de contraception (…) que mon père était un chaud lapin. » [années 1960] Ce sont de tels univers qui ont conduit des psychologues tel/le/s les auteur/e/s de La violence impensable, à conceptualiser les familles incestueuses comme constituant des « dictatures familiales ». Mais si les techniques de terreur et de démolition des personnes commencent à être bien étudiées concernant les violences politiques et les régimes autoritaires, celles utilisées dans l’espace familial n’y sont assimilables que par un (réel tout de même) … air de famille. Dans le camp nazi, le SS n’est pas un/e apparenté/e des détenu/e/s. Dans la geôle où le bourreau torture, il n’est généralement pas non plus apparenté à ses victimes. Autre schème possible d’explication : l’attaque sorcière. Si la sorcellerie étudiée dans le bocage normand par Jeanne Favret Saada comporte beaucoup de similitudes avec les relations incestée(é) / incesteur, notamment via l’impact du regard et des intentions malfaisantes, elle a également ses limites. Les mêmes : le sorcier n’est, précisément, jamais un membre de la famille de l’ensorcelé/e. Finalement, ce qui est impensé, c’est bien cette démolition « at home » [13] , cette démolition qui vient du dedans : pas du nazi, pas du sbire de Pinochet, pas du sorcier, mais de cette personne qu’on appelle « papa », « maman », « mon frère », « ma soeur », « mon cousin », « papinou », etc. Ou bien parfois « lui », « mon géniteur », « elle », « ma génitrice », « le frère », « le cousin », comme je l’ai lu sur le forum internet. Comme pour marquer, quand même, une brisure. La conceptualisation en termes de dictature familiale me semble à l’examen un peu légère, facile, et peu référencée dans l’ouvrage. La dictature, c’est répulsif par opposition à la démocratie : le mot est un bon moyen de faire comprendre ce que sont ces familles pour leurs membres. Mais s’agit-il de dictatures ou de régimes totalitaires ? Et inversement quelles familles peuvent être qualifiées de « démocratiques » ? Il ne s’agit pas de jeter l’analogie à la poubelle, mais de souligner ses limites et son caractère peut-être approximatif. Sans doute faut-il regarder dans d’autres directions, moins explorées. L’une d’entre elles pourraient être certaines formes d’esclavagisme, comme la famille esclavagiste brésilienne décrite (en des termes souvent très policés) par Gilberto Freyre, et qui a existé jusqu’à la fin du 19e siècle. Famille marquée par l’omniprésence des viols et de la violence : « La maison de maître faisait monter des habitations d’esclaves, pour les services les plus intimes et les plus délicats des seigneurs, un certain nombre d’individus – nourrices, femmes de chambres, gamins pour jouer avec les petits blancs. Individus dont la place dans la famille était moins d’esclaves que de membres. Des espèces de parents pauvres des familles européennes. Un tas de petits mulâtres s’asseyaient à la table patriarcale comme s’ils étaient de la maison. » (Gilberto Freyre, 1974, p. 339). Il ne s’agissait pas d’une dictature d’un leader sur une masse, comme on peut se représenter couramment la dictature, mais d’un système où presque chacun/e peut faire preuve de sadisme à son niveau, pour reprendre le mot de Gilberto Freyre. Le niveau le plus élevé étant celui du maître de maison. Ainsi, « l’isolement arabe dans lequel vivaient les anciennes maîtresses de maison (…), avec la seule compagnie des esclaves passives ; leur soumission musulmane aux maris, auxquelles elles ne parlaient qu’en tremblant, les traitant de « Monsieur », sont peut-être la cause de ce sadisme, qui se déchargeait sur les femmes de chambre et les négrillonnes en crises hystériques. Mais les premiers sadiques, c’étaient les maris en relation avec leurs femmes. » (Gilberto Freyre, 1974, p. 325). De plus, « Aucune maison de maître du temps de l’esclavage n’acceptait la gloire d’avoir, dans ses murs, des garçons vierges et innocents (…). Ce que l’on appréciait, c’était le gamin qui courait vite après les filles. Un coureur de jupons, comme on dit aujourd’hui. Un « déflorateur » de fillettes. Et qui ne tardait pas à engrosser des négresses, augmentant le troupeau et le capital paternels » (Gilberto Freyre, 1974, p. 362). Et en outre, « Ce délice à faire souffrir les inférieurs et les animaux est bien notre ; c’est celui du tout petit brésilien atteint par l’influence du système esclavagiste » (Gilberto Freyre, 1974, p. 360), ce qui est encouragé par des coutumes telles celle-ci : « Dès que l’enfant quitte le berceau, on lui donne un esclave de son sexe et de son âge pour camarade ou mieux pour jouer. Ils grandissent ensemble et le blanc passe tous ses caprices sur l’esclave » (Gilberto Freyre, 1974, p. 322). Ce parallèle permet davantage, pour commencer, de penser le rôle des autres membres de la famille, mères et germains, dans un fonctionnement bel et bien patriarcal, où ils/elle peuvent être tour à tour victimes (mères, enfants), complices (cas essentiellement des mères), et dans certains cas sadiques (certains frères ici). Enfin, le schéma de la « dictature familiale » ne reflète pas tous les possibles. Ainsi, Danielle, abusée par Mr Tromosh, qui se fait appeler « papinou ». « Papinou » n’a aucune des possibilités de conditionnement précoce des incesteurs évoqués ci-dessus : il entre dans sa vie alors qu’elle a 5 ans. Il n’est pas omniprésent dans l’espace domestique par son contrôle : Danielle a résidé chez lui uniquement à certaines périodes, essentiellement des vacances scolaires. Il est omniprésent d’une autre manière, avec sa compagne : par l’argent. « Danielle- Je pense que c’est … c’est parce qu’ils avaient, c’est parce qu’ils avaient de l’argent. En plus c’est vrai que, vu qu’ils ont aidé ma mère pour ses études d’infirmière, [passage inaudible]A partir de ce moment-là ils ont toujours été euh … omniprésents tout le temps. M-Omniprésents ? D-Ben, ffff, (long silence) tous les anniversaires, toutes les vacances, (long silence) » Mais aussi omniprésent par la pensée « Danielle-Et puis y’avait aussi autre chose, qui m’est énormément resté et, mais qui fait partie des trucs que je rationnalise difficilement malgré que je sois très athée et très rationnelle, c’est, il disait qu’il était capable d’entrer en communication par la pensée avec moi, et donc qu’il me réveillait le matin en pensant à moi. A 6 heures du matin quand il se réveillait. Et c’est un truc qui m’est resté, j’ai peur de ça, en fait, j’ai toujours peur de ça alors que je sais très bien que rationnellement c’est pas possible.(…) En fait. Et, je me réveille, régulièrement, surtout quand je suis pas bien, entre trois et cinq heures du mat’, et j’arrive plus à m’endormir. Ca, c’est un truc j’arrive pas, j’arrive pas à m’en défaire. » Ici non plus, pas de violence physique (si l’on met à part, bien sûr, les violences sexuelles, qui sont des violences physiques particulières). Pas même de menaces. La stratégie de l’incesteur est encore différente : en plus de la réveiller par la pensée, il s’agit de « mouiller » sa victime « Danielle-Y’avait un énorme chantage avec Tromosh en fait, parce que il disait que si j’en parlais, il aurait plus qu’à se flinguer. M-Ah, donc il lui arrivait de parler ? D-Ah oui, oui, oui, même M-Donc il disait ça, il disait quoi d’autre ? D-Il me parlait même beaucoup. Il me mettait dans ses confidences. M-Dans ses confidences ? D-Ben … un truc sur lequel je m’en veux beaucoup, que, j’aurais du, rien que pour ça j’aurais du en parler plus tôt, heu il me disait qu’il m’aimait, et il me disait que … qu’est-ce qu’il pouvait me parler. Il me disait que moi il m’aimait mais que, en gros, ma petite cousine, Eloïse, qui est la fille de [nom du frère cadet de la mère de Danielle]. M-Du frère cadet, d’accord, de ta mère. D-Me ressemblait beaucoup, et que c’était dommage qu’il la voyait pas beaucoup, et (…) qu’il l’aimait, que c’était Aurore bis [il surnommait Danielle « Aurore »] M-Fhm ! D-Ou Aurore 2, je sais plus. M-D’accord. D-C’est un truc qui m’a, qui me reste en travers de là. Parce que, parce que je pense que c’est LE truc qui me mettait le plus en colère vis à vis de lui, en fait, à l’époque. M-A l’époque ? D-Déjà. C’est à dire que, l’idée qu’il touche à ma petite cousine, ça me mettait en colère, alors que ça me (…) venait pas à l’idée que moi c’était grave. C’est, c’était pas grave de toute façon. (silence) Puis, je pense que c’est, enfin, y’avait aussi vachement de, ben, j’arrive à la fois pas à le voir comme calculateur et à la fois, il me faisait des cadeaux en permanence, il me donnait de l’argent, beaucoup d’argent. J’ai eu des sommes … faramineuses.(…) Je pense que justement, le fait qu’il m’en parle, ça faisait que je … heu … c’était pas suffisamment à moi pour que je puisse le dire à quelqu’un d’autre. Je sais pas comment … en fait, en m’en parlant, il faisait en sorte de me culpabiliser, de m’impliquer dedans. » b. Les rôles de l’argentDanielle signale ici les multiples cadeaux et dons faits par son incesteur. L’utilisation de l’argent par les incesteurs se fait selon des modalités très diverses. A ma grande surprise, j’ai découvert qu’il n’y avait pas que dans ma famille qu’il constituait ainsi un nerf important de la démolition. Dans le cas de Danielle, pour « l’acheter » elle et sa famille, comme elle vient de le décrire. Dans la famille de Lydia, en y interdisant l’accès. Lydia explique par leur pauvreté et le nombre important d’enfants de la fratrie le fait qu’ils/elles n’aient jamais eu accès au moindre franc. Pourtant, son incesteur est tout à fait capable d’effectuer des dépenses importantes, dans des circonstances bien particulières : « Moi-Et pas d’accès à l’argent de poche ? Lydia-Ah non non, ça c’est … M-Rien du tout ? L-Non. Je me souviens qu’une fois après un viol il m’a filé 50 F, mais ça reste UN souvenir. Et non, j’avais pas d’argent de poche, rien. » [50F est une somme alors énorme à ses yeux] Or, « Si l’abuseur cherche à monnayer le plaisir qu’il prend avec sa victime, ce n’est pas seulement pour tenter l’enfant et le faire céder, mais aussi pour sceller un pacte de silence. Recevoir de l’argent ou un cadeau transforme l’enfant en complice et coupable, dans la mesure où il a accepté qu’on le dédommage de façon dérisoire pour le sacrifice dont il est l’objet. (…) « Dix francs la passe, ce n’était pas cher payé », dit un homme abusé pendant de longues années par son oncle, à partir de l’âge de huit ans. Cet homme n’est pas devenu prostitué, mais son rapport à l’argent a été si perturbé qu’il est toujours dans l’incapacité, trente ans après les faits, de gagner sa vie. » (Gruyer-Nisse-Sabourin, 2004, p. 26). Lydia m’a par ailleurs expliqué son caractère à la fois très dépensier, et ses difficultés simultanées à financer sa psychothérapie, qu’elle explique par … sa pauvreté. La rétention monétaire par l’incesteur peut être quasiment sans failles, comme c’est le cas également dans la famille d’Agnès, et ainsi accroître l’isolement des enfants … et leur sentiment de ne « rien valoir ». En effet, la famille déménage environ tous les quatre ans, mais Agnès ne peut maintenir de liens avec ses anciennes copines, car il n’y a pas le téléphone à la maison. Quant à réclamer un ticket de bus pour aller les voir, ce n’est même pas pensable, l’anecdote suivante aide à le comprendre : « Agnès-je pouvais essayer de relire le soir après le souper. Mais ce qu’il y a c’est que le soir, il fallait la lumière, donc qui dit lumière dit payer les factures, (…) donc pas question de lire le soir. Alors j’avais trouvé une astuce c’est que j’avais une lampe de poche que je mettais sous le drap, comme ça. Donc j’arrivais à détourner le truc, donc, de temps en temps. Là j’ai bénéficié d’une petite complicité de ma maman, parce que c’est elle qui achetait les piles. M--Oui, c’est, c’était la question que j’allais te poser [une pile coûte de l’argent !]. A-Voilà. (rires simultanés) Donc, je disais oui oui mais tu sais, j’ai besoin d’une pile, c’est si je me lève la nuit, faut pas allumer, ça va réveiller tout le monde. Y’avait quand même des astuces hein, c’était pas direct la demande de piles, c’était pas forcément juste pour moi. » Le premier accès d’Agnès à l’argent, ce sera donc via son premier travail. Mais, contrairement à la famille de Lydia où le père s’arrange pour faire partir, quitte à le mettre dehors, chacun de ses enfants à ses 18 ans (« parce qu’un enfant ça coûte cher », m’explique Lydia), le père d’Agnès a trouvé une autre méthode, qu’il emploie avec toute sa progéniture : « Agnès-C’était mes premières vraies paies, il m’a piqué 90 % de ce que je gagnais,(…). Moi-ton père, ta paie il faisait comment pour te la piquer ? A-Ah ben il me la piquait pas, il me disait, il était hypocrite, parce que c’était pas pour lui. Il disait « tu paies à ta mère, tu vois avec ta mère ce qu’il faut », et la complicité était, la discussion était déjà établie entre eux. Il savait déjà combien. (…) Et à ma mère, je pouvais pas refuser, il savait que j’avais un lien avec ma mère et que je pouvais pas refuser. M-hmmhmm. Donc c’était tout à l’affectif en fait ? A-Ouais. Ouais ouais. C’était tout du chantage, c’était, de la manipulation, c’était du contournement, c’était, rien de direct. M-Hmmhmm. Donc ta mère, euh, ces procédés pour euh que tu lui donnes ? A-Ben … tout simplement elle m’a dit « ben il faudrait ça », et je lui dis « oui mais ça me laisse pas beaucoup », elle me dit « si je te demande pas ça, ton père il va me taper dessus ». (…) J’avais pas le choix. » Agnès et Lydia portent par ailleurs toutes deux des vêtements assez particuliers : dans leurs familles, en effet, la majorité des vêtements sont portés d’abord par les aînés, puis transmis à leurs cadets. Si le prélèvement de pensions semble avoir fait partie de la norme dans certains milieux sociaux au cours du 20e siècle, ce n’était pas dans de telles proportions (90 % des revenus) ni avec de telles méthodes [14] . Quant à cette manière de transmettre les vêtements, je ne peux qu’en faire état, et noter qu’elle accroît l’isolement des enfants, qui sont en décalage avec la mode à l’école : je ne dispose d’aucune autre information sur son occurrence ailleurs. Enfin, comme dans la famille d’Aurélie, l’argent peut servir à discriminer. Ici, c’est la mère qui contrôle et gère tout, notamment les finances du ménage, apportées par le salaire du mari. On retrouve la question globale du coût, comme pour Agnès et Lydia : « Aurélie-Les autres [à l’école] étaient mieux habillés que moi, faisaient des anniversaires entre eux. Moi j’avais pas le droit d’aller aux anniversaires parce que fallait faire des cadeaux ça coûtait. M-Fhm ! A-Puis ben on les invitait pas parce que on pouvait pas, heu … M-Parce qu’on pouvait pas rendre ? A-On pouvait, on rendait pas [inaudible] M-Parce que on n’invitait pas chez toi ? Pour des raisons ou c’est juste que ça se faisait pas et point ? A-Tout coûtait hein, tout coûtait, [inaudible : exemple de « coût », acheter à boire]. » Mais là, l’incesteur, qui est l’aîné de la fratrie, de père inconnu donc demi-frère des suivant/e/s, connaît un traitement un peu différent : « Moi-Hmmhmm. C’était, c’était le seul, parmi ses frères et sœurs, à être traité comme ça ? Vraiment ce traitement ? Aurélie-Voilà. Lui, qui avait droit … M-Qui était gâté financièrement, par rapport aux autres ? A-Enfin, financièrement, pas de trop, mais par rapport à nous [inaudible], moi j’aurais aimé faire un peu de piscine, ça m’intéressait de faire des compétitions, des choses comme ça, j’adorais ça, eh ben non, fallait payer [inaudible], alors que lui il a fait du judo » Et cependant qu’Aurélie et ses frères et sœurs entrent en apprentissage (Aurélie parce que, au moins, l’apprentissage, « c’est payé »), lui deviendra militaire de carrière, comme son grand père maternel. c. Les rôles des mères : absence de recours et efficacité de la honteAurélie explique que, de façon plus globale, son incesteur a été « surprotégé », c’est le mot qu’elle emploie. Tout cela, c’est sa mère qui en décide, le met en oeuvre. Dans cette famille, le père apparaît comme apportant les revenus à la maison (son épouse est femme au foyer), mais prenant assez peu de décisions et d’initiatives. Ainsi, c’est la mère qui punit les enfants habituellement. Sauf ce jour où, à huit ans, Aurélie explique à ses parents ce que lui fait son demi-frère : « Aurélie-[inaudible, elle parle du jour où elle l’a dit à ses parents] et là ma mère elle a été [inaudible : en gros, elle est restée sans aucune réaction], et mon père, sans rien demander parce que d’habitude il demandait tout hein, c’était pas lui qui commandait à la maison, donc, sans rien demander, il a retiré son ceinturon, il a dit « toi, [suite inaudible : il emmène le demi-frère pour le corriger avec le ceinturon]. Et après, on n’en a plus jamais reparlé, moi on m’a jamais demandé [suite inaudible]. Bon, ils ont été un peu embêtés quand ils sortaient, [suite inaudible]. » Demi-frère qui a continué à tenter de l’abuser ensuite, en changeant simplement de méthode : au lieu de s’en prendre à elle quand ses parents étaient absents, il vient se cacher sous son lit « Aurélie-Ca a continué différemment après [inaudible], il était toutes les nuits sous le lit, il se mettait sous mon lit et puis il me tripotait, jusqu’à ce que je me réveille. » Elle le menaçait alors de parler de nouveau à ses parents, ce qui le faisait cesser jusqu’à … la nuit suivante. Cela a duré jusqu’au départ du demi-frère du domicile familial. Aurélie en veut beaucoup à sa mère, dont le silence, l’absence de réaction et les attitudes pèsent lourd : « Aurélie-en fait, moi ce que j’ai subi c’est … un petit poids par rapport à ce que ma mère prend comme place M-Euh, tu veux dire, l’inceste que t’as subi de ton frère ? A-Voilà. » Ici, la réaction des parents prive Aurélie de tout recours : lorsque je lui demande si elle a pensé en parler à l’extérieur, elle me répond que non, car si ses parents n’ont rien fait, quels autres adultes auraient fait quelque chose ? Elle relate d’ailleurs qu’elle avait du mal à appeler sa mère « maman », ceci sans savoir pourquoi à l’époque. Ultérieurement, cette mère fera tout son possible pour qu’Aurélie maintienne des relations avec ce demi-frère. De plus, lorsque Aurélie, adulte, lui téléphone, ce qui est rare, leur relation étant très distendue, elle se rend compte que le demi-frère écoute via l’écouteur du téléphone : ici aussi, tout est transmis à l’incesteur par la mère, qui constitue de fait un rouage bien huilé de l’ordre incestueux et de son maintien, voire un levier. Levier de surcroît amnésique, à la stupeur d’Aurélie, qui constate lors d’un appel en 2002 que sa mère n’a aucun souvenir des révélations qu’elle lui avait faites à huit ans. Dans la famille de Paulette, la mère est également celle qui dirige, contrôle, tisse sa toile : « Paulette-c’était vraiment un désir profond d’échapper à cette espèce de toile d’araignée qui m’enserrait et qui n’avait pas su me protéger. M-Toile d’araignée ? P-De toile d’araignée que fabriquait ma mère pour tenir tout le monde emprisonné autour d’elle. (…) c’était vraiment très très possessif, euh, elle euh, un petit détail. On n’avait pas le droit, quand on a été plus âgés, et qu’on n’était plus à la maison, on n’avait pas le droit de communiquer entre nous, mon frère ma sœur et moi. Il fallait toujours que ça passe par ma mère qui allait le dire aux autres. (…) On n’avait pas le droit de se retrouver en-dehors de chez elle, enfin c’est des trucs de ce genre. C’est à dire un vrai, un véritable étouffement. » Elle est mère au foyer depuis la guerre. Elle n’a jamais entendu ni protégé Paulette concernant les abus sexuels subis. En revanche, elle est persuadée que Paulette « ne pense qu’à ça » : « Moi-Donc tu pensais que t’avais participé en fait ? Paulette-Ah ben oui, j’étais sûre que j’avais participé [aux abus], puisque j’avais pas réussi à l’empêcher. (…) J’étais persuadée que j’étais souillée, vraiment. ( …) Et alors quand on me disait, quand ma mère me disait : « t’es une affreuse, tu penses qu’à ça » M-Ah, oui … P-Ah ben, je me disais ben oui, je suis bien une affreuse mais c’est pas ce que tu penses mais, moi je pense pas qu’à ça, au contraire j’essaie d’oublier ça. Mais, non c’était vraiment très compliqué hein. Le sentiment de, tu prends la culpabilité sur toi, tu prends le, euh, et puis tu, de toute façon, tu prends l’opprobre. (silence) » Et finalement, ici, la honte et le sentiment d’avoir participé s’avèrent aussi efficaces que des menaces de violence pour faire taire Paulette : la première fois qu’elle en parlera, c’est à 35 ans environ, à une amie, bien qu’elle n’ait jamais oublié les abus dont elle a été victime. « Paulette-Et puis une autre fois, y’a une petite fille qu’était morte, dans un hameau pas très loin, et, ben on était tous allés, les uns après les autres, alors tu vois, dans un chemin, entre des grandes herbes, et on arrive, et y’avait [inaudible], et ça te donne envie de, de t’évanouir, et tu vois le petit cadavre tout blanc, et il faut t’approcher, et embrasser ce, ce, et, et, et moi je me disais : « c’est bien ce qui va m’arriver hein, parce que, quand on fait des choses comme ça, on va mourir hein. ». Et alors après, pendant des années, je m’endormais les mains croisées, comme ça si je mourais pendant la nuit, j’aurais déjà les mains croisées. » En effet, Paulette pense en fait avoir participé à commettre un péché mortel. « Paulette-La sécurité c’était vraiment de me taire. Et puis, dire ça au curé … (silence) … alors, tout le temps je me disais ben, je peux plus aller communier parce que, de toute façon j’ai fait un péché mortel hein [inaudible]. Je me suis pas confessée, puis comme je suis allée me confesser, mais que j’en n’ai pas parlé (…) Ben … c’est encore pire. Alors, je faisais semblant d’aller communier. » Quant à se confier à son père, rétrospectivement, elle pense que cela aurait été possible, mais « Paulette-je pense qu’il aurait écouté, mais en même temps qu’il aurait été bien emmerdé, parce que il aurait dit « mais faut le dire à maman », et puis quoi ? Et alors ELLE, je pense que y’aurait, c’aurait été du genre il faut aller à l’église, et puis il faut parler aux sœurs, et puis il faut, tu vois, de me donner des bons conseils, de me faire faire des prières, de, c’aurait été de la bondieuserie à n’en plus finir. (…) Je pense pas que c’aurait été une aide pour moi. Je pense que j’avais, par instinct, fait ce qu’il fallait, c’est à dire la fermer. » Dans le cas de Danielle, la répartition des rôles parentaux est quasiment inversée par rapport à la famille de Paulette car lorsqu’elle en parle à sa mère, cette dernière le répète au beau-père de Danielle, qui lui, décide de ce qu’il faudrait entreprendre : porter plainte. En creux, cela souligne l’asymétrie des rôles parentaux dans les familles d’Aurélie et Paulette : ce sont les mères qui y sont principalement chargées de s’occuper des enfants, elles à qui l’enfant pense à s’adresser, elles qui sont donc fautives de n’avoir rien fait, rien entendu. Les pères n’ont pas été beaucoup plus actifs. Ils bénéficient pourtant d’une meilleure image : la relation avec eux n’est pas du type « toile d’araignée », et ils constituent peut-être une forme de ressource identitaire, en tant que parent préservé. Ainsi, Aurélie tire les cartes, ce que son père faisait aussi, et Paulette s’appuie sur le désir inassouvi de son père vis à vis des études longues pour en entreprendre elle. Enfin, cependant que Danielle me résumait l’attitude de sa mère par un « elle a fait ce qu’elle a pu », Lydia précise concernant la sienne, parfois amnésique à l’instar de celle d’Aurélie : « Lydia-J’en n’ai jamais parlé. Sauf une fois, où j’ai essayé de faire comprendre à ma mère ce qui se passait, je devais avoir 17 ans. (…) Et elle m’a dit « qu’est-ce qu’il y a Lydia, ton père te viole ? », en rigolant. M-Hmmhmm L-Voilà. Donc j’essaie, j’ai essayé de rappeler ce fait à ma mère elle m’a dit mais moi je m’en rappelle pas. Je lui ai dit ça m’étonne pas, tu te rappelles pas de grand chose. » Cette mère évolue après son divorce, et, lors d’une confrontation où elle accompagne Lydia : « Lydia-à un moment j’entends ma mère hurler, mais HURLER « espèce de monstre ! », parce qu’en fait, ce qu’il faut savoir, c’est que il voit ma mère, donc qu’est-ce qu’il fait, son ex-femme, ben « oh ben tiens, je te fais la bise ». Sauf que bon ben ma mère voilà, (…) c’était plus la femme qu’il a connue » Quant à Agnès, aujourd’hui, elle peut discuter du passé avec sa mère, mais cela a des limites : « Agnès-ma mère discute, mais c’est pas pour autant qu’elle me reconnaît, qu’elle compatit à ma souffrance (…) Elle est toujours dans son … M-C’est, une source d’informations en fait un petit peu peut-être ? A-Ouais, voilà. Donc j’ai gardé le dialogue, pour en savoir un maximum sur l’histoire de la famille » Ce qui n’empêche aucunement un auto-satisfecit, bien étrange, de cette mère : « Agnès-Pour elle, elle était une mère admirable, elle a toujours tout fait pour ses enfants, la seule chose qu’elle ait pas faite c’est de quitter cet homme qui nous martyrisait alors qu’on était chacune de notre côté ma sœur et moi en demande qu’on s’en aille. On sentait bien que c’était l’enfer et qu’on pouvait toujours mieux se débrouiller sans lui, même misérablement, plutôt que de vivre ça. (…) Et mais elle a jamais voulu parce qu’elle avait peur et que elle se disait qu’elle était capable, pas capable de quoi que ce soit.» Cela nous amène à la question du mariage. Plusieurs familles relatées dans mes entretiens sont composées d’enfants de parents différents. Ce ne sont pas pour autant des familles recomposées à l’instar de celle de Danielle, la logique de leur constitution n’est en effet pas le choix d’un nouveau conjoint, mais plus souvent le devoir d’avoir un père pour ces enfants. « Agnès-En fait ils avaient chacun un enfant de leur côté. Donc un mariage qui a échoué. Donc ils se sont réunis pour dire de caser, d’avoir euh, faire monter une famille … mon père sûrement pour quelqu’un qui élève son fils, puis ma mère pour que sa fille ait un père. (…) M-Euh, la fille de ta mère, c’était de père inconnu ? A-Divorce aussi [comme le fils du père] M-Divorce aussi ? Donc … A-Des circonstances particulières, un mariage qu’a pas duré longtemps, elle s’est fait berner, par un mec qui s’est fait passer pour un autre. Elle est tombée enceinte, donc sa mère lui a dit « tu dois te marier, une fille-mère ça n’existe pas chez nous (…) une fille avec un enfant, ça doit être mariée ». » La mère d’Aurélie se marie quant à elle alors qu’elle est enceinte de six mois d’un enfant métis de père dont elle seule connaît l’identité (Aurélie se demande s’il ne s’agit pas d’un enfant issu d’un viol). Cet enfant aura pour père légal le mari d’Aurélie, qui le reconnaît officiellement. Puis il deviendra l’incesteur de ses cadet/te/s et d’au moins l’une de ses filles. Quant à Lydia, elle se demande comment sa mère a fait pour se marier avec son incesteur … 2) Les incestées et les hommes … mais aussi les femmes, et les ami/e/sCe qui m’amène à questionner la manière dont les incestées se sont, elles, mises en couple (pour celles qui le sont), et comment cela s’est-il alors passé. « Paulette-à l’époque, je me disais ben, oui, de toute façon un jour, ben, si je veux des enfants faudra bien que je me marie, donc il faudra bien que … Et c’est pour ça que j’ai choisi le mec que j’ai choisi. Parce que M-Comment ça ? P-moi j’étais persuadée que, de toute façon si j’avais accepté Francis, il était tellement bien et moi j’étais tellement affreuse et tellement ne valant rien, que il serait parti, il m’aurait abandonnée (…) Et tous les garçons, ils m’abandonneraient. Donc il fallait que j’en choisisse un qui ne m’abandonnerait pas. Et celui-là, ça j’étais sûre qu’il m’abandonnerait pas, parce qu’il était tellement maladroit dans le monde, (…) et il voulait rien faire, mais moi je m’en foutais de, tout faire, de faire le ménage, de faire les courses, de faire la cuisine, de m’occuper de tout (…). Et ça correspondait bien pour moi, parce que j’en avais assez que ma mère exige que je sois là pendant les trois mois de vacances de l’université. M-Hmmhmm P-Donc euh, très bien euh, on est mariés, la femme doit suivre son mari M-(rire) Ah oui, donc en Angleterre, du coup. Hmmhmm. » Voilà comment Paulette épouse celui qui sera violent envers elle durant 9 ans et s’avérera commettre des violences incestueuses sur sa fille alors même qu’ils se sont séparés, puis ont divorcé, peu après la naissance de cette dernière. Pourtant, auparavant, elle avait rencontré Francis, un type bien … trop bien pour elle : « Paulette-Et puis juste avant de partir, il me dit ben, ce serait bien qu’on se revoie, quand même, peut être un peu plus. Ahhhh ! J’ai eu une réaction de peur, mais de peur, et il m’a dit « non non, mais on a bien le, bien le temps, pas de problème, faut pas aller trop vite, pas de problème, et tout ça ». Et puis après, ça a duré encore, il est venu chez moi (…) quand il est parti, je lui ai dit « je crois Francis que c’est pas possible, c’est pas possible, vous serez pas heureux avec moi ». Et quand je suis rentrée à la maison après l’avoir mis au train, je me suis écrit que j’étais laide, que j’étais tâchée, et que de toute façon, c’était absolument pas possible que je lui dise ce qu’il m’était arrivé, et qu’il était trop bien pour moi » Paulette n’a d’ailleurs pas pu non plus dire les différents abus subis à son premier mari. Agnès et Aurélie ont eu un peu plus de chance que Paulette. Elles sont néanmoins aujourd’hui toutes deux divorcées. Ce, suite, à des conflits avec leur conjoint, et/ou des attitudes destructrices de sa part. C’est en fin d’entretien seulement, qu’il est possible d’aborder le divorce d’Aurélie. C’est dans le magasin qu’ils dirigeaient qu’elle a surmonté sa timidité très handicapante, et appris à prendre des initiatives. Mais son mari, lui, la préférait timide. « Moi-Il te détruisait ? Aurélie-Il me détruisait parce que il acceptait pas que je reprenne un peu des forces, du poil de la bête et tout ça parce que il se sentait euh, il se sentait en-dessous. [inaudible] M-Hmmhmm. Quand t’as commencé à t’affirmer dans le magasin ? A-Ah oui, oui, ça lui a pas plu. » Elle s’était mariée avec cet homme à l’âge de 18 ans, et faisait des fugues depuis l’âge de 16 ans, sans savoir pourquoi elle avait besoin de fuguer. Durant ces fugues, elle se réfugiait notamment chez lui. Le divorce est à son initiative à elle. Quant à Agnès, elle aussi, c’est lorsqu’elle s’affirme qu’elle rencontre des difficultés « Agnès-y’a un mauvais pli qui avait été pris, qu’en travaillant à mi-temps j’avais pris la charge de toute l’intendance, tout ce qui avait un rapport avec la maison. (…) Et puis m’est venue l’idée de travailler à plein temps (…) y’avait quelque chose de très fusionnel, bon qu’était pas forcément d’aplomb mais on avait nos blessures respectives, qui faisaient que on se complémentarisait. Là du coup, je devenais indépendante, et lui il avait plus sa béquille (…). Résultat, la seule issue, après avoir essayé d’en discuter et de réparer tout ça, ça a lâché, ça pouvait pas. M-Ca a été celle qui, celle qu’il souhaitait lui, le divorce finalement ? A-Ouais, c’est lui qui a demandé, il supportait plus le, il se sentait humilié. M-Hmmhmm A-Pourtant le fait que moi je m’affirme, que je prenne mon avenir en mains, c’était pas forcément une humiliation de l’une à l’autre d’être comme ça, c’est lui qui vivait ça comme ça, donc il a pas supporté. » Cet ex-conjoint l’avait remarquée alors qu’elle donnait des cours de poney dans un centre équestre. Ils ont emménagé ensemble alors qu’Agnès avait 21 ans : c’est à cette occasion qu’elle quitte le domicile parental définitivement. Pourtant, elle m’expliquait auparavant que tout le monde était parti tôt de ce domicile, vers 18 ans, car il était impossible de rester dans un tel univers. En fait, je comprends finalement qu’après avoir travaillé plus d’un an dans un premier centre équestre où elle est logée, Agnès doit revenir vivre chez ses parents. Contrairement à sa grande sœur qui a fugué dès 17 ans pour se marier. Les incestées nées durant les années 1970, Danielle et Lydia, ont un vécu très différent avec les hommes, probablement parce que « Le contraste est saisissant entre l’universalité de la reconnaissance du modèle familial asymétrique dans la période d’après guerre et sa contestation par une bonne partie de la nouvelle génération à partir du milieu des années 1960 » (Neyrand – Rossi, 2004, p. 33). Elles arrivent après ce tournant, cependant qu’Agnès et Aurélie semblent l’avoir vécu de l’intérieur, et de façon coûteuse. Pour autant, leur vécu est lui aussi fortement marqué par l’expérience des abus incestueux. Elles en disent d’ailleurs beaucoup plus que les plus anciennes, n’hésitant pas à parler ouvertement des rapports sexuels et de leur caractère difficile : dans tout ceci, sans doute un effet de génération. Lydia est la seule à ne pas être passée directement du domicile parental à un domicile partagé avec un conjoint ou petit-ami. Ceci est du à la présence de sa marraine, qui s’était brouillée avec l’incesteur quand Lydia avait 10 ans. Lydia pense que c’est cette brouille qui a laissé le champ libre à son père pour la violer à partir de ses 11 ans. Sa marraine, durant toute cette période, c’est son espoir : elles correspondent en secret, et Lydia tient bon en attendant de pouvoir partir, pour ses 18 ans, chez cette marraine. Mais s’étant beaucoup idéalisées l’une l’autre, elles ne cohabitent que quelques mois, ne s’entendant pas. Lydia est alors recueillie par la fille de la marraine et son conjoint, qui l’aident à trouver un travail et à acquérir son autonomie, puis conservent depuis des liens réguliers avec elle : on dirait qu’ils ont constitué une véritable famille d’accueil pour Lydia. Néanmoins, son avenir avec les hommes lui paraît longtemps lugubre : « Lydia- Marc [son conjoint rencontré il y a deux ans], je le vénère, pourquoi, parce que ben, voilà, il est gentil et, et il me fait mais toi aussi tu m’apportes. Je lui fais : mais comparé à ce que lui m’apporte c’est rien, donc il a beau, enfin il a beau me répéter me dire machin et tout, ça rentre pas hein. M-Hmmhmm. Et … toi le lien que tu fais entre ça et ce qui t’es arrivé, c’est comment ? L-Il m’a complètement détruite. Il m’a complètement euh, j’aurais pu avoir une vie où, même si j’aurais peut-être pas du avoir une vie super machin, mais au moins, au moins m’estimer un petit peu. Mais là le fait que … oui, il m’a complètement détruit de l’intérieur, il m’a complètement, euh, je suis bonne qu’à ça quoi, je … M-Bonne qu’à ça ? L-A être violée. (…) Pendant des années, je me suis foutu en tête que de nouveau on allait me violer mais que cette fois-ci ce serait un inconnu. (…) M-On allait te violer parce que ? Enfin y’avait une raison ? L-Non. Peut être parce que j’étais bonne qu’à être violée, peut-être qu’à ce qu’on m’utilise, à ce que euh … je saurais pas dire, mais j’ai toujours eu ce sentiment. Là maintenant, c’est vrai que, je m’en rappelle là, mais ça fait quand même quelques mois que j’y ai pas repensé à ça. » Si « les formes de sévices par lesquelles on retire à un être humain toute possibilité de disposer librement de son corps constituent (…) le genre le plus élémentaire de l’abaissement personnel. (…) car la particularité de telles atteintes, torture ou viol [ou « tripotages » sexuels d’un enfant par un/e apparenté/e ou proche], ne réside pas tant dans la douleur purement physique que dans le fait que cette douleur s’accompagne chez la victime du sentiment d’être soumis sans défense à la volonté d’un autre sujet, au point de perdre la sensation même de sa propre réalité ». (Axel Honneth, 2000, p. 162), ici, un pas supplémentaire est franchi : les abus et leur contexte ont amené Lydia à intérioriser qu’elle ne valait que cet abaissement. Les hommes eux-mêmes, paraissent en outre longtemps à Lydia sous un jour assez lugubre : « Lydia- j’ai quand même pas mal changé depuis que je suis avec lui [Marc], mais … Parce que pendant des années, eh ben, du moment où je suis venue vivre chez la fille de ma marraine, pendant toutes ces années, les hommes pour moi c’était de la merde. (…) C’est, je haïssais les hommes, les hommes c’était bon qu’à, c’étaient que des violeurs éventuels hein, et donc pendant des années, j’ai crié ma haine alors que Paul, en fait sans le savoir, c’est lui aussi que j’agressais. Alors que lui c’est un homme merveilleux, (…) Et, bon ben, bon ben, et maintenant, il rigole. Alors, quand il voit Marc, [inaudible], qu’il me voit collée contre lui : « alors rappelle-moi, c’est quoi les hommes ? C’est quoi ? C’est de la merde ? » (rires) » Pourtant, les ravages opérés par l’incesteur étaient encore bien présents dix ans après les derniers viols subis par Lydia. Présents comme des obstacles : « Lydia-C’est vrai qu’au début avec Marc bon on savait pas où est-ce que ça allait nous mener, moi j’avais pas l’impression que … lui il m’a dit : au bout d’un an, je savais pas encore si j’allais, si ça allait heu, si on allait continuer ensemble. Et il m’a annoncé ça y’a pas longtemps hein. Enfin non, les premiers mois il savait pas s’il allait cont, si si, heu, s’il allait tenir le coup, et bon, ben il a continué, puis bon ben voilà (…). Il a toujours été d’équerre en me disant ben écoute si ça tu veux pas ça, tu veux pas ça, tu veux pas, donc forcément ben voilà, et petit à petit on a appris à se connaître et (…) maintenant je lui dis « mais à cause de toi j’ai même plus de phobies ! »(rires) » Or, « Si la reconnaissance est un élément constitutif de l’amour [ici, au sens propre, et pour l’auteur, au sens plus général de lien affectif puissant entre un nombre restreint de personnes], ce n’est (…) pas au sens où l’on prend en compte l’autre sur un plan cognitif, mais au sens où l’on tire de l’affection qu’on lui porte l’acceptation de son autonomie » (Axel Honneth, 2000, pp 131-132) : c’est en rencontrant une personne qui accepte l’autonomie de sa volonté, et les limites parfois difficiles pour cette personne que cela implique, que Lydia parvient peu à peu « à cette strate fondamentale de sécurité émotionnelle qui lui permet non seulement d’éprouver, mais aussi de manifester tranquillement ses besoins et ses sentiments, assurant ainsi la condition psychique du développement de toutes les autres attitudes de respect de soi. » (Axel Honneth, 2000, p. 131). Pour Danielle, cela se passe différemment : son départ la conduit à être hébergée chez des ami/e/s, où elle a une première relation, qui lui fait prendre conscience de la gravité de ce que lui a fait Mr Tromosh « Danielle-Et la première fois que j’ai eu un rapport sexuel, ça a été … (silence) … je me suis mise à chialer. Je, d’un seul coup je comprenais qu’y avait quelque chose qui allait pas du tout, et que, ce qui s’était passé c’était pas normal, que … M-Parce qu’avant c’était comment pour toi, ce qui c’était passé, avant ça ? … (silence) … Est-ce que c’était quelque chose d’ailleurs ? D-Je pense que … Je sais pas si je me souvenais de tout, déjà. (…) Enfin si, enfin non, je pense que j’y pensais pas. M-D’accord. D-(…) puis je, je (silence), j’avais tendance à vachement idéaliser les rapports amoureux, enfin comme une adolescente classique (…). Et du coup quand je me suis retrouvée face à la réalité de ce que c’est, vraiment, en fait, je me suis rendue compte que c’était beaucoup plus, enfin que c’était (silence), comment dire, c’était (silence), autant lié à ce que, à l’idéalisation que je me faisais, enfin, un peu quoi, qu’à ce qui s’était passé avec Tromosh. (…) C’est, c’était la même chose. (…) (silence), et c’est après ça que j’en ai parlé à ma grand-mère, et c’est quelques mois après quand même, parce que entre temps, j’en ai causé avec mon copain de l’époque, parce que ça l’a quand même (rire) traumatisé un minimum cette histoire.(…) je lui avais pas dit qui c’était, je lui avais pas dit que c’était de la famille, je lui en ai parlé vraiment très, très succintement quoi en fait. M-Ouais. D-Je voulais pas, je sais pas, mais je pense que c’est à ce moment, c’est en lui en parlant, en même temps que je lui en parlais, que je me rendais compte de ce qui s’était passé. » De plus, elle n’a nulle part où aller hors de sa famille « Danielle-Donc voilà je me suis retrouvée avec un garçon que en fait, j’aimais pas spécialement [inaudible], je l’aimais bien mais bon, je l’aimais pas spécialement M-Tu t’es retrouvée comment avec lui ? (…) D-C’est à dire que j’avais aucun, je ne voulais pas retourner chez mes parents, heu, la coloc dans laquelle on était était temporaire, (silence) et je n’avais aucun moyen de subsister (...) Donc, je suis restée avec lui, voilà. C’est … très calculé, en fait … puis bon, de toute façon, j’avais pas d’autre choix. M-Hmmhmm. Pendant un an. D-Pendant un an. » Puis elle a des relations successives avec plusieurs garçons, dont cette fois elle est amoureuse. Mais … « Danielle-j’étais très amoureuse au départ ... les relations sexuelles se passaient très bien les ... 2 premiers mois [inaudible], enfin voilà, ça me plaisait bien. Et à partir d’un moment, je sais pas ce qui se passait mais c’est, enfin, ça m’est arrivé quand même quasiment à chaque fois, en fait, je fais, je m’ennuie, ça m’ennuie, et j’ai envie … d’y cogner dessus. Y’a ce, ce truc qui revient, y’a, c’est, des images qui commencent à revenir, et je suis incapable de le gérer, il me touche : « rhhhh !! » [répulsif], j’ai envie de, envie de taper quoi, c’est plus possible, mais ce, (silence) ça s’est passé comme ça, quasiment … pas pour quasiment : pour tout, pour tous (…), pour tous mes copains ça s’est passé comme ça » Or, « pour parvenir à une relation réussie à soi, [l’être humain] a besoin d’une reconnaissance intersubjective de ses capacités et de ses prestations ; si une telle forme d’approbation sociale lui fait défaut à un degré quelconque de son développement, il s’ouvre dans sa personnalité une sorte de brèche psychique, par laquelle s’introduisent des émotions négatives comme la honte ou la colère » (Axel Honneth, 2000, p. 166). Ici, la brèche est bien présente. Pourtant, il faut préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’un défaut d’approbation sociale, mais de pratiques actives de destruction de la part de l’incesteur, qui ont pour conséquence également des pensées ressemblant beaucoup aux « je ne mérite que ça (ou « pas mieux ») » relatées par Lydia ou Paulette : « Danielle-Enfin en plus le pire c’est ça, c’est que j’ai suffisamment ce truc de, vu que je peux pas être heureuse, enfin, surtout à l’époque, maintenant un peu moins, maintenant pas, même pas du tout (rire), euh, non, vraiment plus du tout, mais j’avais vraiment ce truc, de vu que je peux pas être heureuse, autant rendre les autres heureux. Et du coup, en fait, je tenais le coup (…) Je tenais le coup. Jusqu’à ce que, vraiment, heu, mon intégrité morale, physique, puisse plus. Jusqu’à ce que ça casse. M-D’accord. Donc tu rendais ton mec heureux jusqu’à ce que tu ne puisses vraiment plus ? D-Jusqu’à ce que vraiment je sois vraiment trop, euh, dans un monde ailleurs tout le temps. C’est à dire que au bout d’un certain temps je, j’étais en permanence, ailleurs. M-Dans un de tes mondes euh ? D-Ouais, dans mes mondes parallèles [où elle s’imaginait soit protéger des gens, soit que des gens la protégeaient] ». Danielle traverse par ailleurs actuellement une phase de questionnement, ne se retrouvant plus ni dans l’identité « d’hétérosexuelle », ni dans celle « d’homosexuelle ». Ceci fait suite à un moment où elle est sortie avec des filles. L’incesteur était un homme, pourtant avec les filles … « Danielle-c’est moins violent, avec les filles, c’est moins j’ai envie de taper, c’est pas ça, parce que, peut-être parce que aussi c’est, enfin c’était, ben parce que ça me viendrait pas à l’idée de taper une fille [ça ne se fait pas de taper une fille] (rires simultanés) C’est peut être ça aussi. Mais ça me faisait la même impression de, « tu me touches j’ai pas envie là ». » Et finalement, les ex de Danielle deviennent pour certain/e/s ses ami/e/s : elle a beaucoup d’ami/e/s, qui sont aussi des confident/e/s important/e/s pour elle. « Et … le monde parallèle, ça se produit aussi avec les filles, ou c’est différent ? D-Ben ce qui est différent, c’est que, j’y suis plus beaucoup, en fait. (…) je pense pas que ce soit une question de fille ou de garçon, c’est que j’y suis de moins en moins depuis justement qu’on a vachement discuté avec Fabrice [un de ses ex] » Ainsi, au-delà des hommes, avec qui les incestées ont souvent appris qu’il fallait « tenir le coup », nous débouchons sur l’importance plus globale de l’entourage affectif des incesté/e/s, et sur les autres aspects de leur vie. Parmi eux, un aspect important également : le travail. 3) Le rôle du travailEn effet, alors que la plupart des mères étaient mères au foyer (sauf celle de Danielle), leurs filles travaillent. Or, ce n’est pas parce que les abus incestueux se produisent dans l’espace domestique, qu’ils n’ont aucun impact en-dehors. Au contraire, ici aussi, les incestées peuvent se sentir nulles : « Lydia-au boulot j’ai, même si les gens me disent que je suis une bonne gardienne, moi je me sens la pire des gardiennes, heum, on a beau me faire des compliments, ben non, pour moi c’est normal, tous les services que je rends c’est normal je suis bonne qu’à ça. (…) M-Et t’es toujours nulle malgré ça ? (…) L-Ah oui oui. (…) Là euh, Marc m’a dit ben oui mais tu vois [inaudible] mais regarde les étrennes que t’as eues. Ca prouve bien que les gens t’estiment et … c’est vrai que j’ai eu des belles étrennes quand même. (…) J’ai toujours eu de belles étrennes, mais malgré ça, je me dis c’est pas parce qu’ils m’aiment bien, c’est parce que dans l’année, je leur ai rendu des services. (…) Et les services que je rends, des fois je vais très loin dans les services hein. (…) et je, je quémande aussi de rendre des services. » Le travail peut constituer un moyen de choisir sa vie soi, de « mener sa guerre » « Paulette-La deuxième chose que ça [les viols] m’a fait c’est : il m’est arrivé des trucs affreux, mais mes petites copines juives dont la famille a disparu dans les camps de concentration, ça aussi, ça leur est arrivé, il leur est arrivé quelque chose d’affreux. C’est la guerre. Leur guerre, c’est les camps de concentration, qui ont tué une partie de leur famille. Ma guerre, c’est ce mec-là, eh bien je vais me débrouiller toute seule et je vais construire ma vie. Et, la troisième chose c’est : ma mère ne m’écoute pas, elle ne m’entend pas, elle ne me comprend pas : c’est moi qui déciderai ce que je fais. » (fin de face de cassette). Pour Paulette, la décision, c’est de faire des études qui lui permettent de partir loin de sa mère et du « magma » tout autour. « Paulette-quand je bossais pas bien ou quand j’avais pas de bonnes notes, je me disais « ma belle, il faut que tu bosses hein, parce que pour t’en tirer, pour te sortir de tout ce magma, c’est uniquement en travaillant. » Elle devient enseignante-chercheuse, alors qu’elle est issue de milieu populaire. Elle se croit bien sûr, pour reprendre les mots de Lydia, « la pire des » … enseignant/e/s-chercheurs/euses. Mais ses étudiant/e/s trouvent ses cours remarquables, et à force, il faut bien qu’elle l’entende : « Moi-Donc finalement, le fait d’être prof de fac et de, d’avoir des étudiants qui te disent « vos cours, ils étaient bien et tout », euh, ça a contribué à diminuer cette dévalorisation ou ? Paulette-Ah oui, oui. Oui, quand même. C’est à dire que, maintenant, j’oserais plus dire à voix haute que, que je valais rien, que je savais pas de quoi je parlais, parce que j’aurais peur que les gens se fichent de moi. M-(rire, puis dit sur le ton du clin d’œil :) Mais ça t’arrive de le penser ? P-Heu, pas tout à fait, mais ça m’arrive de penser que quelques fois euh, j’avais pas tout à fait assez travaillé un aspect du problème. M-Hmmhmm. Ouais. Des petits restes comme ça. P-Ouais. Non c’est à dire le côté perfectionniste en fait » En effet, « Lorsque la qualité de mon travail est reconnue, ce sont aussi mes efforts, mes angoisses, mes doutes, mes déceptions, mes découragements qui prennent sens. Toute cette souffrance n’a donc pas été vaine, elle a non seulement produit une contribution à l’organisation du travail mais elle a fait, en retour, de moi un sujet différent de celui que j’étais avant la reconnaissance. La reconnaissance du travail, voire de l’œuvre, le sujet peut la rapatrier ensuite dans le registre de la construction de son identité. (…) Alors le travail s’inscrit dans la dynamique de l’accomplissement de soi. » (Christophe Dejours, 2000, p. 41). Ici avec les limites explicitées par Paulette : au fil des décennies, son travail et surtout le regard de ses étudiant/e/s lui ont permis d’évoluer de ce sentiment de ne rien valoir à ces restes : le côté un peu perfectionniste. Mais le travail peut aussi détruire, et c’est à mon grand étonnement que je réalise, au travers des expériences vécues par Agnès et Aurélie, son rôle dans le désenfouissement des abus subis enfant. Rôle impensé à ce jour concernant les incesté/e/s, les ouvrages citant comme source de résurgence du trauma uniquement des événements ayant trait à la vie familiale et privée, comme le moment de donner naissance à un enfant, ou encore le moment où l’enfant atteint l’âge de sa mère lors des premiers abus qu’elle a subis [15] . Agnès avait cherché à travailler dans l’équitation, activité qui lui avait beaucoup apporté « Agnès-Mais j’ai jamais connu avant tard. Donc, à travers l’activité scolaire. Et là malgré mes trouilles qu’il fallait monter sur un truc qu’était haaaannnn ! M-(rire) A- C’était immense, je voyais ça comme une montagne, monter dessus, se faire trimballer, mon Dieu on peut diriger ça ? Mon Dieu j’ai, j’ai les capacités de prendre les choses en main, en charge ? [pendant ce temps-là, je continue de rire] De m’affirmer ? Pfou, c’était le Pérou ! (rire) C’était extraordinaire ! » Elle exerce finalement en tant que secrétaire, dans plusieurs entreprises successives. Dans la dernière, elle prend des responsabilités syndicales, ce qui lui vaut des ennuis de la part de la direction : elle subira des pratiques de harcèlement, de mise à l’écart, et une tentative, à laquelle elle a brillamment fait tourner court, de supprimer son poste pour la licencier. De plus, à cette époque, sont mises en place de nouvelles méthodes de gestion du personnel de l’entreprise, notamment via une formation en « psychologie » [16] durant cinq ans, dont voici un aperçu des résultantes « Agnès-Et après, si tu veux, les gens se rendaient compte que, quand t’avais des blessures, tu pouvais pas forcément parler de tout, et tu pouvais être arrêtée dans certaines discussions et avoir des limites. Comme ça. Et les gens provoquaient des discussions sur tout et rien pour voir où tu en étais (…) pour savoir jusqu’où tu pouvais aller et savoir si t’avais des limites et si t’avais une limite forcément t’avais une souffrance et du coup t’étais euh reléguée au placard, on te regardait plus (…), on te regardait, « oh ben celle-là elle a des problèmes », etcaetera, t’étais cataloguée. [inaudible] (…) donc pas performant pas rentable, mais c’est marrant parce que les mêmes personnes qui se plaignaient ou qui se battaient pour avoir des augmentations de salaires et qui se battaient contre l’injustice, sont devenus des bourreaux, en dénigrant l’autre, en, si tu veux en, et en détectant, en allant rapporter à … n+1, bien souvent » Un collègue apprécié d’Agnès se suicide, et de façon plus globale, ces méthodes provoquent beaucoup de souffrances chez les employé/e/s de cette entreprise. Agnès fait partie des personnes plus particulièrement ciblées, et du fait qu’elle est divorcée depuis récemment, subit aussi du harcèlement sexuel. Suite à une série d’arrêts de travail longs, elle est aujourd’hui en train de perdre son emploi. C’est en 2004 que, lors de son premier arrêt de travail, ses premiers souvenirs concernant son enfance remontent, sous forme de cauchemars qui la démolissent. Elle m’explique qu’au travail, c’était pareil que dans sa famille puisque là aussi, « personne n’était à sa place ». J’ajoute, après avoir décrit plus haut ce fonctionnement familial, que les ressemblances me semblent frappantes : contrôle (et autocontrôle réciproque) sur les relations entre les salarié/e/s, avec un système où tout est rapporté à la direction, qui se sert des informations ainsi obtenues sur la vie privée des employé/e/s pour les classer, les stigmatiser, les démolir. On se souvient du contrôle des relations par le père dans la famille d’Agnès, et de ses effets : l’isolement et le silence. Cela peut d’ailleurs poser la question des similitudes entre les situations de harcèlement (moral et sexuel) rencontrées au travail, et celles de violences intra-familiales (dont les violences sexuelles), qui rencontrent le même type de difficultés à être prouvées et reconnues devant les tribunaux en France. C’est dans un contexte différent, non pas induit par des méthodes de management pensées et préméditées à l’échelle d’une entreprise, mais par des relations interpersonnelles discriminatoires vis à vis d’Aurélie, que cette dernière se retrouve en arrêt maladie puis perd son emploi. A cette époque (2002), elle avait divorcé et travaillait dans l’immobilier. Elle y réussissait bien, mais sa cheffe d’agence avait une « petite préférée », s’ensuivent diverses pratiques peu correctes envers Aurélie, et au bout d’un an, son envoi en stage … de débutant, alors qu’elle est expérimentée. Cette humiliation conduit Aurélie directement en arrêt maladie car elle en fait des chutes de tension importantes. Et lorsqu’elle reprend le travail, faisant une chute de tension à chaque fois qu’elle voit sa cheffe d’agence, elle finit par être contrainte à démissionner, n’arrivant plus, physiquement, à marcher jusqu’à son lieu de travail. Depuis, elle n’a pas retrouvé d’emploi stable. En fait, cette cheffe d’agence, par son nom, ses manières, ses attitudes…et ses chiens, ressemblait à la mère d’Aurélie, me précise-t-elle. Elle lui ressemble peut-être également par le fait d’avoir une « petite préférée » et les pratiques discriminatoires associées envers Aurélie. Finalement, le travail apparaît dans ces deux cas comme un lieu de rencontre avec des situations destructrices qui ressemblent à celles vécues jadis dans la famille. Rencontre qui conduit à la remémoration, douloureuse et coûteuse, de ce passé, et à devoir recourir à l’aide de psychothérapies. 4) Incestées et psychothérapiesDans tous mes entretiens, les thérapies évoquées par les incestées, de quelque génération qu’elles soient, débutent entre la fin des années 1980 et aujourd’hui. Les itinéraires thérapeutiques sont souvent complexes : plusieurs thérapeutes dans tous les cas (successifs ou simultanément), parfois un/e psychiatre pour des médicaments, et souvent plusieurs méthodes thérapeutiques différentes tentées. Les thérapies sont très diverses : de groupe, basées sur les mémoires corporelles (« méthode des cuirasses ») ou encore la psychogénéalogie, les constellations familiales ; individuelles, d’inspiration analytique (mais pas de psychanalyses au sens strict), inspirées de la PNL ou encore de l’analyse transactionnelle. Les thérapeutes exerçent dans des lieux très variés : hôpital, CMP, cabinet … ils/elles sont psychiatres ou psychothérapeutes, mais aussi, parfois, thérapeutes plus marginalisé/e/s : une « psy » recommandée par une tireuse de cartes, et qui n’est pas officiellement reconnue comme « psy », et « une bioénergéticienne », qui agit avec son pendule. Dans presque tous les cas, le/la « psy » est l’interlocuteur/trice perçu/e comme naturel/le, évident, au premier abord. Evident pour l’entourage : se rendant compte que la personne ne « va pas bien », il lui est suggéré « tu devrais aller voir un/e psy ». Seule Paulette me cite un autre interlocuteur : le curé, auquel sa mère l’aurait probablement envoyée faire pénitence, si elle avait confié les abus subis à ses parents. La psychothérapie est alors décrite avant tout en termes « d’écoute », de « lieu où parler », et mes interlocutrices qui pensent en ces termes n’évoquent pas spontanément cet aspect de leur histoire : c’est suite à question de ma part en fin d’entretien, que Lydia, Danielle et Paulette me parlent de leur parcours vis à vis des psychothérapies. Ainsi, Lydia, qui fait des ménages, incitée par ses premiers patrons à qui elle a expliqué que son père l’a violée, et qui voient combien elle va mal, suit leurs conseils : « Lydia-Et donc, comme moi je connaissais rien euh, machin, donc j’ai été dans un centre de médico psychologie M-Mmmhmm L-Sauf que je sortais de là dedans, M-Un CMP en fait, c’est ça ? L-Ouais. Euh, je ressortais j’avais qu’une envie c’était d’port, d’aller chez les flics. » [années 90] Elle arrêtera finalement d’y aller, ce qu’elle m’explique simplement par le fait qu’à l’époque, c’était trop tôt pour elle, qu’elle avait surtout envie qu’on lui « foute la paix ». Danielle évoque quant à elle le rôle en Justice, négatif, des « psy » de ses cousin/e/s, également abusé/e/s par leur agresseur commun, je la questionne ensuite : « Moi-Et … pour toi … tu me parlais des médocs et du médecin tout à l’heure [Danielle a eu prescription de médicaments contre la dépression et l’angoisse] … donc y’a eu tout de suite la réaction de ton beau père de, de te proposer de porter plainte, et par contre, par rapport aux psychos, tout ça ça, ça s’est posé comment ? Danielle-(Soupir) euh … Ben euh… [chantonné : ] « nininininin » … c’est vrai que ma mère me disait qu’il faudrait que j’aille voir un psychiatre. M-Hmmhmm D-Mais … elle l’a fait tout le temps, enfin, dans le but que j’aille voir un psychiatre. M-Euh, depuis quand ? D-Euh … depuis que je me suis barrée euh, en claquant la porte [croyant qu’ils allaient emménager chez son agresseur elle s’était enfuie, et réfugiée depuis chez des ami/e/s à elle] » [années 90] Ce qui peut étonner ici, c’est qu’auparavant, lorsque Danielle, mineure, s’était lacérée les poignets pour être autorisée à aller chez une copine par sa mère, cette dernière n’a semble-t-il aucunement songé au psychiatre. C’est finalement quand Danielle a une réaction saine : fuir « en claquant la porte » pour ne pas emménager chez son agresseur, que le mot « psychiatre » est prononcé. L'idée selon laquelle ce qui est important c’est le « il faut en parler », la perception de la thérapie en termes « d’écoute », débouche par ailleurs parfois sur un possible recouvrement de rôles entre les « psys » et l'entourage, aux yeux des incestées. Ce qui pose, en miroir, la question de l’importance de l’entourage (quand il y en a un) et de son soutien, moral et aussi matériel : c’est chez ses premier/e/s ami/e/s que Danielle a trouvé refuge, quand à Lydia, c’est chez Marion et Paul, les enfants de sa marraine, qu’elle a été hébergée durablement après avoir fui le domicile de son incesteur à sa majorité. « Danielle-Voilà. Et sinon ... j’ai pas vu [inaudible] à part je pense euh, c’est euh. Peut être ce qu’il faudrait, parce que en fait je pense que la, la, la grosse part de, d’extério, de, enfin de parler de ça ou quoi, je l’ai fait avec … mes ami/e/s. Du coup ça peut être, peut-être, déjà y’a des choses que je ne peux pas dire, puis … puis ça peut être euh, pesant pour les ami/e/s aussi. » « Moi-Ouais. Une dizaine d’années [de psychothérapies], par épisodes en fait, c’est ça ? Lydia-Ouais. Ouais ouais. Donc euh, tout en sachant que bon, même si y’avait pas les psys, j’ai toujours eu dans ma vie Marion et Paul, qui ont toujours été, M-Mmmhmm. D’accord. L-Ils ont toujours été aux petits soins, ils ont toujours été à l’écoute, ils me laissaient leur dire ce que je voulais sans me, sans me … si j’avais envie d’en parler j’en parlais, si j’avais pas envie j’en parlais pas : ils m’ont vraiment mis sur les rails quoi c’est… » Une autre façon d’envisager sa psychothérapie, est en rapport avec la mémoire : il ne s’agit pas d’être « écoutée », de « parler », ou du moins ces mots ne sont pas employés comme éléments centraux. Ici, la psychothérapie, est décrite comme méthode pour en finir, via l’exploration du passé, avec des symptômes ou un mal être très dur, comme Aurélie et Agnès. Les thérapies sont alors évoquées d’emblée par les incestées elles-même, assez tôt durant l'entretien : « Agnès, parlant de sa thérapie corporelle-Puis petit à petit, ben est ressorti ce, ce souvenir euh, à force de de, de sonder, d’avancer, de décharger au niveau émotionnel le souvenir, petit à petit c’est un petit peu comme … un sac où se sont accumulées les choses, [inaudible] puis on arrive à toucher les choses qui sont en-dessous. Donc je suis tombée petit à petit avec cette, cette idée-là, cette image [du viol qu’elle a subi, très jeune, par son frère aîné]. M-Hmmhmm A-Et effectivement ça correspondait à une zone de mon corps qui était très tendue très crispée et puis qui, qui s’est lâchée » [début des années 2000] Par ailleurs, le déroulement des thérapies peut osciller entre le pire et le meilleur, comme le montrent les deux témoignages littéraires suivants : « Bien sûr, elle a rêvé, toutes les petites filles rêvent de coucher avec leur père. Freud, ce génie, a parlé, tout le monde enseigne ses géniales idées. (…) Elle avait retrouvé des bribes, des morceaux, des preuves du passage à l’acte, et lui, le psychothérapeute, devant le groupe, niait sa vérité et la faisait douter. (…) Il la forçait à raconter l’histoire avec son père comme une histoire d’amour (…). Dans un autre groupe, elle avait soutenu que son père l’avait violée. Avec un bon sourire rassurant, le psy lui avait affirmé qu’elle avait le droit de coucher avec son père. » (Eva Thomas, 2003, pp 59-60). Plus loin, l’auteure s’interroge « Qu’est-ce qui me retient éloignée du divan ? Bien sûr, il y a mes expériences avec les psychothérapeutes : avoir des relations sexuelles avec deux d’entre eux a été la répétition symbolique du passage à l’acte de mon père et a abouti à une perte de confiance envers le monde psy. » (Eva Thomas, 2003, p. 197). [pas de dates à ce propos dans le livre] Eva Thomas s'en « sortira » finalement sans thérapeute : en créant, un livre autobiographique, la première association « SOS inceste ». Puis en changeant de prénom pour l'état civil. C’est pourtant sur le divan de la « psy » consultée depuis son adolescence, que Virginie Talmont retrouve quant à elle la mémoire, via une relation très différente de celles citées à l’instant : « pourquoi j’imagine qu’il pourrait faire du mal à notre fille, pourquoi j’ai peur d’être une mère perverse, ouh la vilaine, ouh la vilaine, ouh la folle, mais que fais-je en liberté ? (…) Angélique m’interrompt : « pourquoi vous vous sentez si mal face à votre père ? » Je suis en thérapie depuis cinq ans, j’ai déjà raconté tout ça, qu’il était trop dur, trop froid, que je vivais sous la terreur, que…et puis, silence. Silence, silence. (…) je le sens bien, il y a autre chose, autre chose dont je n’ai jamais parlé (…). La petite voix en moi se fait plus précise. Le sexe. Le sexe et mon père. Voilà, c’est ça, le sexe et mon père. (…) Au fur et à mesure des séances, les mots se précisent. J’ai peur, terriblement peur, du sexe de mon père. Pourquoi du sexe de mon père ? Je me fais violence pour parler, j’ai honte, honte de parler du sexe de mon père, quelle est cette femme qui parle du sexe de son père, j’ai l’impression d’être une obsédée du sexe, une obsédée du sexe de mon père, ouh que c’est affreux, ouh que je suis sale, ouh que je suis moche, ouh que je suis dégueulasse de parler du sexe de mon père (…). Angélique intervient régulièrement quand je me tais durant de très longues minutes, elle tente de me rassurer. « Virginie, dites-moi pourquoi le sexe de votre père vous fait si peur. Est-ce que vous l’avez vu ? » ». (V. Talmont, 2005, pp 63-64-65) [pas de dates dans le livre] Dans mes entretiens, les situations apparaissent intermédiaires : si Aurélie a voulu arrêter d’emblée sa psychothérapie parce que la thérapeute lui déplaisait, de nouvelles chutes de tension l’ont obligée à revenir, et la thérapeute ayant alors changé d’attitude, elle a poursuivi. Après avoir été suivie par une thérapeute (bioénergéticienne) non remboursée qui la croit, Agnès souhaite travailler avec un thérapeute masculin et remboursé, mais : « Agnès-quand je discutais de ces choses-là avec le thérapeute, il ne me croyait pas. C’était un psychothérapeute traditionnel, donc formation freudienne jungienne, donc euh, il relativisait, en fait, tout ce que je faisais remonter M-il te disait quoi si tu te souviens ? A-il me disait « oh, il faut faire attention, ça peut être votre psychisme qui, qui crée ces images, euh, dans la mesure où vous vous rappelez pas les faits précisément, et que c’est sous forme d’impressions ou d’images euh, imprécises, ça peut pas avoir eu lieu », enfin pour lui ça, il fallait émettre des, des doutes M-mmmhmmA-Mettre des gros points d’interrogation sur la véracité de ces choses-là. Et, du coup, chaque fois que je sortais du cabinet du thérapeute, je me sentais MAL, M-Hmmhmm A-Je me sentais mal, mais quelques fois euh, ça remuait tellement, c’était fracassant hein. Autant, je fonçais dans le mur avec la voiture, des choses comme ça » [années 2000] Ainsi, quand Didier Fassin et Richard Rechtman expliquent qu’il y a un quart de siècle, « La victime – qui du reste n’était guère pensée sous cette qualification – était frappée d’illégitimité. En somme, le doute pesait sur le traumatisme » et que dans leur ouvrage, « Il s’agit d’appréhender ce mouvement par lequel ce qui provoquait la suspicion vaut aujourd’hui pour preuve – autrement dit, par lequel le faux est devenu le vrai. » (Fassin – Rechtman, 2007, p. 16), quand ils expliquent donc cette évolution, il me semble qu’il faut la nuancer, concernant au moins les victimes d’inceste. Et s’agit-il d’ailleurs seulement de soupçon ? Je pense que la théorisation de Fassin et Rechtman ne suffit pas à comprendre ce qui se passe là, pour les incesté/e/s, ici à différencier des vétérans de guerre, rescapé/e/s des camps nazi ou victimes d’attentats terroristes également cités par ces auteurs. Dans ces cas, le soupçon ne portait pas sur la véracité de leur histoire, difficilement niable [17] mais sur celle de ses conséquences, du lien avec leur état de personnes traumatisées. Le soupçon, c’était de dire : votre état psychique traumatique, nous doutons qu’il soit dû (par exemple) à la guerre à laquelle vous avez participé. Pour l’inceste, le thérapeute d’Agnès met les faits eux-même en doute. De plus, cette mise en doute de la réalité telle qu’elle revient en mémoire n’est pas le seul problème relaté par les incestées : existent aussi des conduites d’évitement du sujet (l'inceste) dans les thérapies, qui, plus qu’à la mise en doute, me semblent renvoyer à la continuation du silence sur les abus incestueux tel que je l’ai déjà explicité (Stéphane La Branche, 2003). Parmi les conduites d’évitement, celle qui focalise l’attention sur les effets traumatisants du divorce est relatée dans plusieurs entretiens : « Moi-Tu en as fait plusieurs comme ça, petite période et puis « pouf » ? Et … t’as arrêté tu… Danielle-Alors euh … M-A chaque fois c’était pour les mêmes raisons ou c’était, y’avait des raisons … ? D-Non, pas du tout. La première euh, le premier je, j’ai arrêté parce que, il revenait tout le temps sur le fait que j’avais été abandonnée par mon père donc euh c’était très important M-Mmmhmm D-Il commençait à me gonfler, parce que, mon père, d’accord, oui, c’est vrai, c’est important, certainement, mais c’était pas de ça dont je voulais parler. M-Mmmhmm D-Voilà, donc euh M-Mais tu lui avais parlé de euh, de machin ? D-De Tromosh, oui. M-D’accord. Et lui il revenait tout le temps sur t… D-Voilà. (…) » Or, la focalisation sur les effets du divorce est précisément aussi un des éléments qui avait empêché la mère de Danielle de penser à d’autres éventualités pouvant expliquer les importants changements de comportements de sa fille, survenus vers l’âge de cinq ans, son âge lors du divorce, et aussi moment où Mr Tromosh est entré dans leurs vies … « Danielle-ma mère dit (moi je me souviens pas), ma mère dit que j’étais une enfant très, justement, très ouverte, très calin, très euh, à tout le temps parler, bavarder, avec elle et tout, et que, elle, elle l’a mis sur le compte de, de leur séparation avec mon père (…) que je suis devenue superrenfermée, à pas aimer qu’on me touche » A cet égard, ce que relate Paulette de l'histoire de sa fille est sinistrement exemplaire des conséquences possibles de « croyances scientifiques » concernant la famille, articulées au silence fait sur l’inceste par une thérapeute : « Paulette-Et c’est comme ça qu’elle a commencé une psychothérapie, qui a duré un certain temps, jusqu’à un jour où la psychothérapeute nous a téléphonés en disant : « voilà deux séances qu’Hélène n’a pas ouvert la bouche, alors je voudrais que vous veniez avec elle tous les deux et je voudrais vous parler à tous les trois »[Hélène, sa mère et son beau-père], ce qui a été fait. Et là, devant Hélène, elle a dit : « voilà, j’ai voulu voir tes parents parce que je ne peux pas laisser la psychothérapie euh … s’embourber dans le silence, donc je vais proposer une autre solution : je vais proposer la psychothérapie institutionnelle ». Et on était dans [un lieu] de la France, pas très loin d’un endroit où il y a trois cliniques de thérapie institutionnelle qui sont connues, assez anciennes, tout ça. Moi-Mmmhmmm P-Donc elle avait en vue une de ces cliniques. Et c’est comme ça que ma fille est entrée pour la première fois dans une, dans une clinique euh psy. M-D’accord. P-Et Plusieurs années après, c’est à dire après qu’elle ait crâché l’inceste, puisque « l’histoire d’Eva [Thomas] c’est la mienne », j’ai téléphoné à la psychothérapeute pour lui dire euh, et bien il y a du nouveau, on savait pas pourquoi Hélène allait mal, maintenant on sait au moins une chose, c’est qu’il y a une histoire d’inceste. [voix de fausset :] « Aaah … oui, c’est curieux, c’est vrai que, quand elle est, quand elle s’est enfoncée dans le silence, le dernier mot qu’elle avait prononcé avant, c’était le mot inceste ». M-Mm. Donc elle l’avait dit ? P-Donc elle l’avait dit. Mais … euheuh … la psychothérapeute l’avait virée vers une clinique, et elle n’avait pas dit au directeur de la clinique : ça. M-D’accord. P-Le directeur de la clinique n’a eu d’autre choix, mais dans les trois mois, que de vouloir l’envoyer chez son père [qui est l'incesteur d'Hélène]. M-Pourquoi « aveuh pas d’autres choix » ? P-Ah ben il a dit « faut qu’elle aille chez son père, on peut rien faire de plus pour elle, faut qu’elle aille chez son père, il faut remettre de l’ŒDIPE dans cette histoire. M-D’accord. C’est … il pensait en fait que ça venait du fait qu’elle était euh, chez sa mère ? P-Oui. » [ces faits se déroulent vers le milieu des années 80] Ceci alors que Paulette a quitté en catastrophe son ancien mari, quand cette fille avait 9 mois, car après des années de violence envers Paulette, il avait eu un (énième) geste, violent et dangereux, visant Paulette mais qui a failli atteindre le bébé. Cela avait constitué un déclic pour cette dernière. « Paulette-je me sentais complètement piégée, et que, avec Jean [son fils aîné, adoptif] qui avait été adopté, qui avait déjà eu une brisure dans sa vie, (…) je ne voulais pas causer une deuxième brisure M-Ouais P-donc je me disais il faut que je tienne, il faut que je tienne. Heu, jusqu’à ce que les enfants soient grands, et après je pourrais faire ce que j’ai envie de faire. Et puis, j’ai pas tenu. M-Heureusement … P-Heureusement, oui, parce que j’aurais fini en piteux état. » Entre le père théorique imaginé par le praticien, et celui réel, dangereux, quitté par Paulette, quel grand écart ? Ce récit pose clairement la question « du rôle normatif qu’on leur fait jouer [aux concepts psychanalytiques tels la fonction maternelle et la fonction paternelle] dans la régulation sociale et psychique de tout ce qui n’entre pas dans le cadre d’une triangulation classique [père – mère –enfants] ». (Neyrand et Rossi, 2004, p. 40). A ces problèmes avec des thérapeutes qui renvoient au silence par l’évitement et/ou en tentant d’imposer d’autres sujets, s'ajoute la question financière. Pour certaines, les thérapies, cela coûte cher, au vu de leurs revenus faibles, et il peut également leur sembler injuste d’avoir à payer alors que ce sont elles les victimes : « Lydia-Après, j’ai été en voir … j’ai été voir une psy. Sauf que fallait la payer M-Mmhmm L-Et donc que ça coûte une fortune, et quand on touche euh, 800 euros ben, voilà. C’est un peu cher. Après j’ai été voir un psychiatre qui était remboursé mais fallait quand même avancer donc, voilà, j’ai dû arrêter. M-Mmmhmm, ouais. L-Donc à chaque fois c’était l’argent qui me bloquait hein, M-Ouais, ouais. L-Et eux en prison c’est gratos, c’est dégueulasse. » De plus, oser poser ce problème financier au « psy » peut être hors de portée : « M-Et y’avait pas de possibilités de discuter avec eux des tarifs ? L-J’ai jamais, j’ai jamais, j’ai jamais osé. M-Mmm. Ouais. L-J’ai jamais osé. J’estimais que je ne méritais pas ça donc … leurs tarifs c’était ça donc c’est, c’est … M-Mmhmm L-Puis bon j’aurais même pas pu M-Donc c’est que t’as, t’as pas osé … ? L-Ah oui, ça j’ose pas hein, ce côté financier euh » On se souvient du rôle destructeur de l’argent et de sa rétention, dans la famille de Lydia, Lydia qui trouve finalement une psychothérapeute dans un hôpital, dont elle fait l’éloge : « Lydia-elle écoute, elle est gentille, elle est douce, elle me fait dire des trucs, elle me fait vraiment prendre conscience des choses et elle me fait avancer. » et d’ajouter : « L-Comme quoi que ça peut arriver des psys qu’on ne paie pas et qui sont supers. » La bioénergéticienne consultés par Agnès concentre également les éloges, même si elle ne pourra répondre au besoin, très important pour Agnès, de rencontrer d’autres incesté/e/s : « Agnès-Ca tombait bien. Mais on avait de très bons rapports, et je dirais qu’elle m’a sauvé la vie cette dame parce qu’elle était toujours présente, je pouvais l’appeler à n’importe quelle heure de la journée (…) elle était très à l’écoute et elle avait des tas de méthodes euh … différentes pour travailler là-dessus [sur les incestes subis par Agnès]. Bon elle me fait travailler au niveau des rêves, les écrire, les exprimer, elle me faisait travailler au niveau d’écrits, d’écrire des lettres à mes parents pour leur parler de ces problèmes. » Et même être un « bulldozer », peut être plutôt bien perçu : « Aurélie-C’est quelqu’un, qui était très euh, c’était un bulldozer [inaudible]. Alors l’autre, on allait en thérapie chez elle, on pouvait rien ne pas dire hein, elle faisait tout sortir [inaudible]. Elle avait une technique terrible. M-Hmmhmm A-Alors qu’elle était pas reconnue comme euh, les psychologues qui sont répertoriés, (…)Elle était assez rentre dedans et assez heu, fiouu. Alors on pouvait pas s[inaudible]. Si elle voulait choper elle chopait. M-Hmmhmm A-Alors, là y’avait des choses qui sortaient. » Finalement, les « psys » apprécié/e/s de ces incestées sont ceux ou celles qui écoutent, font avancer, font dire des choses, « chopent », « ont une technique terrible », ou encore disent « des choses intéressantes » (Danielle). Pour autant, même dans ce dernier cas, suivre une psychothérapie peut s’avérer difficile : « Danielle-Et puis la troisième c’était celle qui m’a dit des choses intéressantes et ça s’est terminée en fait parce que euh, … ça me mettait dans une colère … noire. A chaque fois que je devais y aller ou que j’en revenais, je pétais des trucs. M-Ah oui ? D-J’ai … m … on commençait, enfin, on commençait à parler avec ma mère, et je m’énervais, je prenais un truc sur la table, je le balançais par terre. M-Mmhmm D-J’me mettais à tout casser euh … j’ai cassé une porte vitrée comme ça, d’ailleurs. M-Mmh. D- (douleur soudaine) Ah ! …(silence, puis : ) C’est rien, c’est une douleur intercostale M-Ca va ? D-C’est pas grave. M-(rire nerveux) D- … et donc voilà. Je me suis dit bon, ça va, ça suffit. M-Ouais. Et après ? D-Après j’en ai plus vu. M-D’accord. D- [silence, puis inaudible, puis chantonné :] « j’m’en porte pas plus mal », je sais pas, j’en sais rien. Non, je sais pas, je pense à la fois que ça peut être utile, euh ça, ça pourrait m’être utile et à la fois j’ai pas du tout envie, j’ai peur de me retrouver justement dans ce, dans cette phase là M-De colère ? D-Que j’ai pas dépassée du tout avec la précédente, de colère M-Mmh. D-Et donc, euh, j’ai pas réussi à gérer du tout, et j’ai peur que ça revienne, en fait. » Danielle m'a expliqué, par ailleurs, avoir subi de gros accès de dépression, ayant nécessité des traitements médicamenteux, et me parle de ses activités très prenantes comme étant aussi un moyen de ne plus être dans cet état : dès qu’elle a un moment de creux, cela revient. Paulette, quant à elle, après m'avoir précisé avoir effectué de nombreux séjours en clinique pour ses dépressions successives depuis son second divorce, et être toujours sous médicaments, m'explique : « Paulette-et la raison, une deuxième raison pour ne pas vouloir faire de psychanalyse, c’est que je connais des amis qui ont fait des psychanalyses, celui pour lequel ça a duré le plus longtemps, a été trente ans. M-(rire) P-Et moi je trouve que même cinq ans de psychanalyse, à, je suis modeste, deux séances par semaine M-Hmmhmm P-ça te coûte … beaucoup d’argent. Et moi j’aime mieux mettre, si j’avais cet argent, j’aimerais mieux le mettre dans … des tas d’autres choses. Donc voilà. M-Des tas d’autres choses ? P-(silence, puis :) Non mais de toute façon c’est un luxe que, que moi je pourrais pas me permettre une psychanalyse. 45, 45 euros la séance, deux séances par semaine M-Hmmhmm P-90 euros par semaine, 4 fois 9, M-(rire) … oui, bon, j’ai compris ! P-…par mois. Non mais c’est, c’est complètement fou. » Ici, l'impossibilité, voire la « folie » financière est mise en avant, et d'une manière plus générale, le coût (en temps, aussi). Paulette me précise par ailleurs que : « Paulette- je voulais pas le faire, parce que toute ma vie, j’ai beaucoup discuté avec des amis, de tout un tas de choses, j’ai beaucoup écrit, j’ai beaucoup lu, j’ai beaucoup réfléchi, et je trouve que euh, le travail que j’ai fait, même si ça n’est pas fait dans un certain ordre comme tu le fais avec un bon thérapeute, c’est quand même un travail qui m’a permis de progresser et d’arriver à mener ma vie. » Mais en écoutant encore un peu, d'autres éléments sont présents : « Paulette- la première [psy], c’était intéressant, ça m’a, si, ça m’a fait prendre conscience heu … de deux ou trois choses mais, les autres euh … je les. Mais c’est aussi de ma faute : la manière dont je l’ai évoqué, c’est « il faut que je vous dise que, mais bon, c’est tellement ancien j’ai beaucoup réfléchi à tout ça, je pense que c’est complètement dépassé », ils ont été trop contents de le laisser complètement dépassé. (silence) Mais il faut dire que je suis peut-être pas un client … facile pour un psychothérapeute, parce que M-(rire étouffé) c’est à dire ? P-(long silence) je ne sais pas, je, je, je pense que maintenant je suis trop vieille, j’ai trop fait … j’ai trop fait le tour 25 fois, 50 fois, je peux plus. (…) Très franchement, j’ai, non, puis j’ai pas le temps, maintenant, de toute façon. J’ai plus le temps, parce que je suis vieille, et si je veux encore faire quelque chose dans ma vie, il faut pas que je perde du temps à des choses de ce genre, quand même. M-D’accord. Donc la psychothérapie comme perte de temps (rire). P-Non non mais il ne faut pas exagérer, je veux pas dire euh …non, je te, j’ai bien dit M-(rires) J’essaie de résumer ce que je comprends de ce que tu me dis, c’est tout. P-Non non mais j’ai bien dit, j’ai bien dit que la psychothérapie que j’avais faite en … [début des années 90], ça m’avait beaucoup apporté et vraiment je, je m’y étais impliquée. Mais c’est vrai que si on me dit « ah, maintenant, vous devriez faire une psychothérapie, ah ben ça va être une fois par semaine », ah là là, non, j’ai pas le temps. (…) M-Est-ce que tu as d’autres choses auxquelles moi j’ai pas pensé ? P-Non je ne pense pas. M-Non ? P-Je pense qu’on est… M-Hmmhmmm ? P…on est allées… M-(rire) P-…on a fait le tour 25 fois hein » C'est par ces mots que se termine mon entretien avec Paulette, qui s'était présentée à moi avant tout comme mère de victime d'inceste, et qui, à la fin de la première cassette d'enregistrement, s'étonnait presque qu'il y en ait une deuxième. Elle a comme point commun avec Danielle ses hésitations à se penser victime d'inceste elle-même, m'expliquant que ce qui lui est arrivé n'est rien à côté de ce qui est arrivé à sa fille. « Paulette- Mais mon histoire, c’est rien à côté de celle d’Hélène, comme tu, quand tu vois, c’est … Je dis pas que c’est rien, je dis que c’est rien à côté de. M-Oui. Mais … on va continuer à parler un peu de ton histoire, pour le coup. P-Hmm. Euh, je vais peut être, euh, arrêter carrément le four. M-Ouais. [Pause pour arrêter le four, puis changement de sujet] » "Je ne m'en porte pas plus mal", "on a fait le tour 25 fois", "ce n'est rien à côté de" … comme si ces vécus étaient insignifiants, minimes, pas si graves. Cela pose la question de l'adhésion des incestées elles-même à une hiérarchisation et une minimisation des actes qu'elles ont subi. 5) L’inceste : une frontière floue, une hiérarchie des abus ?J’ai évoqué plus haut cette étudiante en anthropologie rencontrée à la sortie d’un colloque, qui m’avait informée avoir une copine concernée, mais qui ne savait pas si cette copine rentrait « dans mon sujet » (l’inceste), car c’était par un oncle. Paulette, violée par le fils aîné de sa famille d’accueil, puis par son cousin, évoque uniquement, au téléphone, les viols dans sa famille d’accueil. Elle m’explique alors qu’elle n’est pas sûre de rentrer dans mon sujet, pas sûre donc, d’être victime d’inceste. Danielle, quant à elle, lors de notre prise de contact téléphonique, m’explique également qu’elle ne sait pas si elle fait partie de ce sujet pour mon mémoire, car c’est par le grand-père de son cousin qu’elle a été abusée. De plus en plus étonnée, j’ai d’un coup réalisé : tous les livres de témoignages publiés sur le sujet, évoquent des viols, par le père. L’inceste, tel qu’il parvient à être édité en livres, et donc un peu pensé, c’est le viol par le père ? Quelles sont donc les frontières de l’inceste ? Même les associations de victimes donnent en fait chacune des définitions différentes sur leurs sites internet. Ainsi, pour SOS inceste Nantes : « l'inceste est une relation à caractère sexuel entre des membres d'une même famille: père/fille, père/fils, mère/fille, mère/fils, frère/soeur, oncle, tante, grand-parent... ou toute personne ayant autorité parentale sur l'enfant: beau-père, belle-mère ou concubin, concubine... Il s'agit d'attouchements et/ou d'actes de pénétration sexuelle (vaginale, anale, buccale) par organe sexuel, doigts, ou au moyen d'un objet. » [18] Pour SOS inceste Grenoble : « l'inceste désigne toute relation sexuelle entre membres de la même famille : père/fille, frère/sœur, mère/fils, oncle/nièce, grand-père/petite-fille, mais aussi père/fils, mère/fille etc. [c’est moi qui souligne : ] La notion d'inceste peut être élargie aux relations sexuelles entre un enfant et toute personne investie d'une autorité : enseignant, éducateur, moniteur, prêtre, voisin, soignant etc. » [19] , définition très proche de celle adoptée par AREVI. Enfin, étrange fait aux yeux de l’anthropologue : sur ces trois associations, deux citent une théorie anthropologique, celle de la prohibition universelle de l’inceste énoncée par Claude Levi-Strauss, comme voix d’autorité (et c’est la seule citée ainsi) pour énoncer l’interdit. Côté incesté/e/s, un premier axe de difficulté à se situer « dedans » semble constitué par le degré de lien de parenté, avec notamment l’opposition famille par le sang / famille « hors le sang ». Ainsi, le début de l’entretien avec Danielle est consacré en partie à cette interrogation : « victime d’inceste ou de pédophilie ? ». Voici le point de départ : « Danielle-La première fois que je suis allée sur ce site [internet] c’était parce que … c’était pour voir en fait comment d’autres personnes qui avaient été victimes euh, d’inceste, … in, inceste je sais pas si, enfin c’est, c’est, c’est vachement, flou dans ma tête. Enfin d’autres personnes qui avaient été victimes de, de pédophilie en fait plutôt. Dans ma tête c’est plus ça en fait. » Puis, un peu plus tard, je la relance sur ce distingo : « Moi-D’accord. Et, c’était des forums internet, tu me parles d’inceste ou de pédophilie, c’est sur quels forums que t’as été, justement ? D-J’crois que c’est plus, enfin, je crois que je suis surtout allée sur euh, les victimes de pédophilie. (…) M-D’accord. D-Moi, j’ai du mal avec [inaudible] : vu que c’est pas une personne qui est directement mon grand père, j’ai du mal à M-Hmmhmm D-Enfin à la fois je, je (silence). A la fois je me dis que c’est … ben, c’est en quelque sorte un inceste parce que c’était quelqu’un qui était, c’était le grand-père de ma cousine, donc euh, quelqu’un que je voyais comme un grand père puis j’ai pas d’autres grands pères. » En effet, tous ses grands-pères sont soit décédés, soit inconnus. Les termes d’adresse demandés par ce parent par alliance et son épouse semblent, enfin, assez explicites : « M-Et dans, dans ta famille, enfin ce, le grand père de cette cousine euh, il était comment, il était, enfin, tu me dis c’était un peu ton grand père, c’est à dire ? D-Heu, c’est à dire que … le, le couple … moi j’avais, ma grand mère, mais le, le couple se présentait. Enfin, en fait leur nom euh, ils se faisaient appeler « mamichou et papinou ». » Ici, donc, aucun lien de sang, mais en revanche, une parenté construite par de nouvelles personnes qui viennent occuper une « place » laissée vacante dans la famille. Celle du grand-père maternel de Danielle, « viré » du domicile par son fils aîné car violent envers la grand-mère de Danielle ? C’est ce même fils aîné qui épouse la fille de « papinou », créant l’alliance. Danielle souligne « l’omniprésence » de ce couple, appuyée par le contraste économique : c’est une famille de médecins, qui ont plusieurs maisons, sont riches. « Danielle-Je sais pas comment, je me souviens pas comment ça s’est établi le fait que, en gros, ils prenaient la place des grands parents de la famille en fait. M-Hmmhmm D-La place du euh … (silence). Je pense que c’est … c’est parce qu’ils avaient, c’est parce qu’ils avaient de l’argent. En plus c’est vrai que, vu qu’ils ont aidé ma mère pour ses études d’infirmière, [passage inaudible] A partir de ce moment-là ils ont toujours été euh … omniprésents tout le temps. » Pédophilie ou inceste ? Marie-Pierre Porchy, Juge d’instruction, cite en exemple : « Woody Allen, lui-même, n’avait-il pas semé le trouble en devenant l’amant de la fille adoptive de sa compagne Mia Farrow ? « Qu’ai-je fait de mal puisque ce n’est pas ma fille, que je ne couche pas avec sa mère, que sa mère n’a jamais été ma femme et qu’elle n’est pas la mère par le sang de sa fille ? ». Démonstration éventuellement convaincante sur le plan intellectuel, elle n’avait toutefois pas convaincu l’opinion publique qui avait réprouvé cette relation en la qualifiant d’incestueuse. » (Marie-Pierre Porchy, 2003, p. 25). Mais pour aller plus loin dans cette interrogation, peut-être faut-il s’inspirer des travaux d’Agnès Martial concernant les familles recomposées. Dans un chapitre consacré à l’inceste, elle construit un historique de l’évolution de ses frontières et de sa perception en France. Ainsi apparaît l’importance de l’affinité : « Au concile de Rome, en 721, l’Eglise définit précisément la notion d’affinitas. « Dans un mariage consommé, les deux époux sont devenus une seule et même chair, una caro. La copula ayant mêlé leurs sangs et confondu leurs personnes, la parenté de l’un se communiquait à l’autre sous forme d’affinitas ».(Esmein, 1891, p. 416) » (Agnès Martial, 2003, p. 81). C’est à dire que les apparenté/e/s du/de la conjoint /e devenaient ses propres apparenté/e/s dès l’acte de chair accompli. Par exemple, un beau-père devenait ainsi affin de sa belle-fille, ce qui rendait toute union entre lui et elle incestueuse. C’est également la théorisation classique de la prohibition de l’inceste (notamment du 2e type) en anthropologie, où les apparenté/e/s, y compris par affinitas, parce que constitué/e/s d’humeurs, de substances perçues comme identiques, ne doivent pas mettre ces humeurs en contact par un acte sexuel. Agnès Martial propose d’ajouter, à cette conception de l’inceste beau-parental qu’elle nomme « substantialiste », une conception relationnelle. Elle en date l’émergence en France au 19e siècle : « Pour la première fois, semble-t-il, c’est en référant la beau-parenté au modèle de la filiation de sang que l’auteur commente l’interdit (…) il ne s’agit plus ici d’affinité mais de « pseudo-parenté », d’imitation du lien de filiation » (Agnès Martial, 2003, p. 85). Elle ajoute : « L’interdit de l’inceste se joue donc dans l’appréciation des rôles de chacun dans la famille, plutôt qu’il ne fait référence aux liens de parenté : « On considère comme un inceste toute relation sexuelle entre un enfant et un adulte qui a avec cet enfant un rôle parental. C’est à dire qu’en dehors des liens du sang sont incluses les relations entre un enfant et son beau-père, une belle-mère ou des substituts parentaux stables, concubins, nourriciers par exemple », écrivent Brigitte Camdessus et Robert Kiener dans un ouvrage sur la maltraitance (1993, p. 235). Cette définition de l’inceste, qui fonde la relation beau-parentale dans les faits d’une parentalité vécue et partagée, trouve un écho dans l’application pénale des textes de loi. » (Agnès Martial, 2003 , p. 96). Et c’est bien à ce registre de « pseudo-parenté », d’imitation du lien de filiation, que semble faire allusion Danielle dans ses interrogations et doutes autour de la question « inceste ou pédophilie ? ». La parole est alors à Paulette qui, quant à elle, m’explique que les viols subis de la part du fils aîné de sa famille d’accueil, âgé d’environ 20 ans, c’est bien une sorte d’inceste : un inceste « pas classique », et elle développe les différences : « Paulette-je me suis rendue compte que en fait, je pouvais être à SOS inceste pour ma fille, mais je pouvais y être aussi pour moi-même. Parce que, moi je n’avais pas vu, vécu une situation d’inceste classique, Dieu merci, parce que euh, je pense que, quand c’est extérieur au père, grand père, oncle etc, c’est à dire des gens qu’on aime, qu’on respecte, c’est sûrement euh, enfin ça fait pas les mêmes effets dévastateurs ou du moins ça n’a pas les mêmes conséquences de, que, que quand c’est un véritable inceste. (…) Ce qui veut dire que moi je pouvais le détester cordialement, et que y’avait pas le mélange de « ben c’est quand même mon papa, tonton, grand papa, je sais pas quoi, donc je l’aime quand même. Moi c’était vraiment un AGRESSEUR, je le détestais, et je n’avais qu’une envie, c’était de me trouver quelque part dans un coin pour lui planter le couteau quelque part. » Un inceste « moins pire », en somme, qu’un « inceste classique » ? Pour autant, le renvoi au silence s’avère lourd de conséquences. Notamment, quels sentiments restent possibles vis à vis de cette mère, suite à l’épisode que Paulette nous relate ci-dessous, et ceux qui suivront ? « Paulette-Moi j’étais toujours debout sur le tas de fumier, parce que c’était seulement de là qu’on pouvait voir le chemin qui montait de la vallée par lequel arrivaient mon père et ma mère à pieds. Quand ils sont arrivés, j’ai couru vers eux, et j’ai dit à ma mère : « je veux rentrer à [ville] sous les bombes ». M-Hmmhmm P-Et ça c’est une phrase qui m’est restée, comme il reste, on garde certaines phrases sans les bouger. Et la réponse a été : « tais-toi, ne dis pas des bêtises, occupe toi de ta petite sœur ». Et j’ai eu une guerre ouverte avec ma mère pendant … 50 ans. (silence) C’est à peu près ça. Heu, parce que ma mère n’avait pas voulu entendre et qu’elle y comprenait rien, et que de toute façon il fallait que je me débrouille toute seule, et que, elle me punissait toujours pour rien, et quand j’avais quelque chose à lui dire, ben y’avait pas moyen de … M-Qu’elle entende ? P-Qu’elle entende. » Les auteurs de l’ouvrage La violence impensable relèvent quant à eux/elles, dans un chapitre intitulé « les abus sexuels extrafamiliaux », que « les conséquences des abus sexuels extrafamiliaux peuvent être identiques à celles de l’inceste, lorsque ces abus se produisent dans des familles qui ne soutiennent pas l’enfant, et vont parfois jusqu’à le considérer comme responsable des violences qu’il a subies. » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 131). Ainsi, l’importance, du point de vue de psychologues, de délimiter des frontières entre inceste et pédophilie se trouve en quelque sorte relativisée par le rôle dévastateur du silence construit par les adultes de la famille, qu’il s’agisse d’inceste ou de « simple » pédophilie. Ou bien d’abus par le fils aîné de la famille d’accueil trouvée par la famille de la mère de Paulette. Paulette qui me relate ensuite son entrevue avec sa mère, plusieurs décennies après ces événements : « Paulette-Et donc, comme elle se souvenait bien, je lui dis : « ah voui, voui, tu … je voulais VRAIMENT rentrer à [ville] tu sais. Euh, est-ce que tu te souviens de ce que je t’ai dit ? -Ah non, mais tu disais toujours que tu voulais rentrer à [ville] [ton exaspéré excédé par un caprice récurrent], que tu voulais pas rester ! » M-Hmmhmm P-Je lui dis : « oui mais cette fois je t’ai dit précisément « je VEUX rentrer à [ville] SOUS LES BOMBES » -Aaah ! C’est vrai que t’as dit ça. » Je
dis : « et tu sais ce que tu m’as répondu ? »,
je lui dis : « eh ben tu m’as répondu « occupe-toi
de ta petite sœur, tais-toi et occupe-toi de ta petite sœur ».
(silence) Je lui ai dit « ben voilà, la raison pour laquelle
je préférais rentrer à [ville] sous les bombes, c’est que j’avais
été abusée par le fils aîné de Mme [nom de la famille d’accueil],
et que je savais pas comment dire que je pouvais plus rester
là. » Alors elle est restée silencieuse un bon moment,
et puis après elle m’a dit : « Ah. C’était difficile
ce qui se passait à ce moment-là. (silence) Ah, mais c’est pour
ça que tu voulais pas y aller l’année d’après ! » P-« Tu voulais pas y aller l’année d’après ». Donc, elle s’est souvenue que l’année d’après je voulais pas y aller. Mais, elle a pas demandé pourquoi. Alors là je lui ai expliqué : « ben le problème c’est que tu as pas demandé pourquoi, et que pour moi, ben j’étais toute seule, avec mon histoire secrète, et que c’était drôlement difficile à porter et que je savais pas comment faire, et que, et que, c’était mal. J’allais mal, je, j’étais pas bien du tout, et vraiment ça a été très difficile pour moi pendant toute mon enfance et toute ma jeunesse -Oh oui ! Mais après, de toute façon, tu courais après les garçons ! ». Alors je lui ai dit « mais attends, j’ai pas fini. J’ai encore une chose à te dire et alors tu vas encore attendre quelques minutes. Plus tard quand j’avais 12 ans, un été, j’ai eu une angine de Vincent. Est-ce que tu te souviens de ça ? -Ha oui, puis alors, tu pouvais pas sortir, on était toujours obligés de rester dans la maison avec toi ». Je dis « Oui, oui oui, c’est ça. J’avais une angine de Vincent qui m’empêchait de sortir et de rencontrer d’autres enfants. Eh ben, figures-toi que juste avant, y’avait mon cousin Christophe, qui tous les jours, il me … tripotait, il me … -Ah NON NON NON ! CHRISTOPHE, C’EST PAS POSSIBLE ! Ca Christophe, C’EST PAS POSSIBLE ! Et puis DE TOUTE FACON, T’AVAIS BIEN PLUS DE 12 ANS, T’EN AVAIS AU MOINS 14 OU 15, et puis DE TOUTE FACON, TU COURAIS TOUJOURS APRES LES GARCONS ! MAIS CHRISTOPHE, C’EST PAS POSSIBLE ! ». Alors je la regarde, et je lui dis : « ben euh, écoute, tu pense ce que tu veux de ton … neveu, mais moi je t’ai dit ce que j’en pensais. Si jamais tu essaie de me remettre en contact avec lui, il peut y avoir toute la famille autour de nous, je m’approcherai de lui et je lui dirai, les yeux dans les yeux : « voilà ce que tu m’as fait, et je T’ACCUSE de me l’avoir fait » -AH MAIS TU PEUX PAS DIRE CA PARCE QUE SA, SA FEMME ELLE A RIEN A VOIR DEDANS ! ». Alors j’ai dit : « ben si elle est pas là, tant mieux pour elle. Mais, si elle est là, si tu as fait qu’on se rencontre … -Oueuh, moueuh ! ». Mais en fait, elle s’est débrouillée pour qu’on se rencontre pas. » Ainsi, c’est incidemment que Paulette m’apprend cette autre agression, clairement incestueuse, par son cousin : après avoir évoqué l’histoire, douloureuse, de sa fille durant quasiment la face A entière de la première cassette, puis les viols qu’elle-même a subis dans sa famille d’accueil. Et c’est de me raconter cette discussion avec sa mère qui la conduit, presque sans le faire exprès on dirait, dans le fil du récit, à évoquer l’abus par ce cousin. Mais alors surgit un autre problème : celui de l’âge, de l’écart générationnel. « M-Oui oui. Et … il était, il avait quel âge par rapport à toi ? P-Il avait 8 ans de plus que moi. Donc si tu veux, c’est pas des gens de la même génération. M-De la même génération ? P-C’est pas, c’est pas, c’est pas des gens qui ont, qui avaient le même âge que, c’est pas, ils n’avaient pas le même âge que moi [le fils aîné de la famille d’accueil, ainsi que le cousin] M-Oui oui oui oui. P-Y’avait une différence d’âge. » Qui vient comme en écho à cette citation : « Il s’agit ici de frères nettement plus âgés que l’enfant abusé. Dans les cas d’inceste frère-sœur, le frère est le plus souvent pubère, alors que sa sœur est encore une enfant. Les jeux sexuels entre enfants du même âge font partie d’un domaine très différent, celui de la découverte de l’identité sexuée, et n’ont de ce fait rien de pathologique » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 105, note n°19). Mais alors, répond Agnès, que je connaissais auparavant uniquement comme incestée par son père : « Agnès-Et puis dans cette atmosphère-là, ben, j’ai … le premier frère, donc, de cette nouvelle fratrie, qui à l’âge de 4 ans, donc, c’est suite à la découverte et à la réouverture des mémoires, que ce grand frère, (…) donc euh, m’a violée, et j’ai gardé cette blessure physique au fond de moi toutes ces années, sans savoir … Mais je pense que ça a été quand même … terrorisant et violent au point que j’ai pu en perdre connaissance et en perdre la mémoire. C’était vraiment à ce moment-là je pense, que ça a été enfoui. Mais à partir de là, j’étais dans une, je me souviens d’être dans une terreur totale, pour tout (…) M-Ce frère il a combien d’années de plus que toi ? A-Il est décédé aujourd’hui. M-Il est décédé ? A-Ouais, ouais il est décédé à cinquante euh … M-Hmm, il est mort jeune ! A-A cinquante, non cinquante deux. Cinquante deux. Dans des conditions dramatiques. Donc, combien d’écart on avait, euh, 6 ans. M-Hmmhmm A-Donc il avait heu … une dizaine, dix onze ans quand ça c’est arrivé, ça, cet événement, en fait M-Quand il t’as violée en fait ? A-Ouais quand il m’a violée. C’est vrai que c’est un mot que j’ai encore du mal à employer et je sens que l’émotion est forte. M-Ouais, ouais. A-[inaudible] Et heu … Donc c’était un gamin quoi si tu veux, il savait pas ». Aurélie enchaîne à son tour : « Aurélie-Enfin bon moi ce qui a fait que … Moi c’était mon frère. [inaudible]. Donc on avait euh, 5 ans, 5ans … il avait 5 ans de plus que moi Moi-Ouais A-Et j’étais, j’étais jeune, mais lui aussi M-Hmhm A-J’avais 5 ans donc lui euh, il avait 9 ans » Puis elle apprend que sa grande sœur a aussi été incestée par ce demi-frère aîné : « A-Puisqu’elle s’est confiée à mon petit frère, en pleurant, en disant ce qu’elle avait subi, [inaudible]. Elle a subi des choses, et elle a fait subir. M-Elle a subi de … A-Moui. Alors est-ce qu’elle a subi … M-… du grand frère ? A-… consentante ou pas, ça ! M-Euuuuh … elle a subi enfant ? A-Ben elle avait deux ans de moins que lui alors …M-La question elle se pose pas A-Ouais mais je pense que y’a eu des choses où elle était consentante, donc à mon avis un peu [inaudible]. C’est pour ça qu’elle dit rien, qu’elle euh, elle fait comme si de rien M-Tu veux dire que il lui a pas imposé de choses par la violence quoi ? (Silence, pas de réponse, quant à moi je passe à un résumé reformulation oral de tout ce que j’ai retenu … et nous reprenons sur autre chose) » Ainsi, les violences sexuelles par un germain pré-pubère, rarissimes selon des psychologues, sont relatées par deux incestées sur mes cinq entretiens. Si l’on ajoute les abus sur d’autres membres de la famille, c’est l’absence d’abus par un garçon de la même génération, souvent un germain, pubère ou non, qui devient l’exception dans mon corpus. Et, même quand la différence d’âge est faible, il s’agit bien d’abus, et non d’expériences de découverte mutuelle par « touche pipi », selon l’expression consacrée : lorsque Aurélie s’interroge sur le consentement de sa grande sœur, aussi bien que lorsqu’elle évoque, plus loin, le « jeu du gynécologue », consentement et « jeu » se situent dans le cadre d’un rapport de domination puisque, consentante ou non, l’on « subit », c’est le mot qu’elle emploie. Il faut de plus préciser qu’Aurélie, juste avant, m’expliquait que cette grande sœur, tout en ayant été incestée par ce demi-frère, a également été sa complice pour l’agression des cadet/te/s, en étant infirmière dans ce « jeu du gynécologue », où lui était le gynécologue, ce qui induit que la question du consentement de cette sœur peut aussi être mise en relation avec la question suivante : le statut de complice est-il compatible avec celui de victime ? Question importante, que je délaisse ici, pour aborder d’abord un dernier type de hiérarchisation des abus : le distingo viol et autres abus sexuels. Dans certains cas, je ne saurai d’ailleurs pas s’il s’est agit de viol ou d’attouchements, car l’incestée ne reprend pas ces catégories pour décrire les abus : « Moi-Tous les jours ? Aurélie-Pas tous les jours, mais…souvent. (silence) M-Et ce que j’ai vu c’est que, sur les témoignages [du forum internet], donc, ton père a réagi, puis après ça a continué, puis … A-Ca a continué différemment après [inaudible], il était toutes les nuits sous le lit, il se mettait sous mon lit et puis il me tripotait, jusqu’à ce que je me réveille. » Mais dans la majorité des cas, le distingo est fait. Il peut l’être pour simplement affirmer que c’est quand même de la même gravité : « Agnès- Donc, y’a pas eu de viol paternel, mais y’a eu comportements incestueux, (…)Y’a eu comportements incestueux, regards incestueux, paroles, attentions incestueuses si tu veux, ça revient un peu au même au niveau ressenti. Y’a eu ces intrusions dans ma chambre à des moments [des moments où elle et ses frères et sœurs pouvaient être en train de se déshabiller pour aller dormir](…), donc y’a eu ça, y’a eu un épisode où je suis partie avec lui à la pêche, et je, j’ai eu des attouchements sexuels pendant … cette période-là. » Lorsque Agnès évoque ces ressentis, elle emploie de façon récurrente les mots « blessures », « traumatisme », ce qui semble s’inscrire tout à fait dans l’ensemble de phénomènes pointés par Didier Fassin et Richard Rechtman concernant l’évolution sociale vis à vis de la figure du traumatisme, qui désormais qualifie la victime alors qu’il y a un quart de siècle, il disqualifiait le héros qu’il rendait, par exemple, incapable de retourner au combat ou, plus prosaïquement, le travailleur qu’il rendait incapable de retourner au travail. Ainsi, « le recours au registre traumatique s’impose rapidement comme un moyen de faire reconnaître le fléau social de la maltraitance sexuelle » (Fassin – Rechtman, 2007, p. 174). Ce ne sont pas les actes en eux-même, mais leurs conséquences traumatiques, qui font leur gravité, c’est pourquoi un « comportement incestueux » peut être mis sur le même plan qu’un viol incestueux. Ce n’est pas le cas, en revanche, pour Paulette, qui, spontanément, parle en termes d’actes pouvant aller plus, ou moins, loin : « Moi-C’est quelqu’un de différent du coup [le cousin] P-Ah oui, c’est quelqu’un de différent. Mais lui c’est pas allé très loin, parce que, je suis tombée opportunément malade (…)Puis l’année d’après, lui, il avait 22 ans ou quelque chose comme ça, et il avait ses copines et ça lui suffisait. M-Mais quand même il t’as tripotée, quoi, pour le coup ? P-Mais il m’a tripotée, oui, il me tripotait, il, il venait me faire faire de l’allemand, et il me tripotait pendant qu’on était à … à table, assis, à faire de l’allemand, enfin. Puis quand j’allais chercher du bois pour le feu, il venait avec moi, et puis sur le tas de bois, enfin bon. Mais, je pense que, je crois pas qu’il serait allé plus loin que ça. Mais de toute façon, c’était pas bien, quand même hein. M-[insistant :] Oui mais quand même il te tripotait, quoi. P-Il me tripotait. Oui oui. M-Pendant tout le temps que tu y étais et que tu étais pas hors de sa portée P-Hmmhmm. Exactement, et après, je me suis mis hors de sa portée en tombant malade. » Ainsi, le tripotage par le cousin, cela « va moins loin » que le viol par l’aîné de la famille d’accueil, même si, quand même, lorsque l’anthropologue insiste, le tripotage s’avère effectué dans une liste de lieux qui montre son omniprésence jusqu’à la maladie opportune de Paulette, et, quand même, si « c’était pas bien ». Le registre ne semble d’ailleurs pas être ici celui du traumatisme, c’est à dire de l’atteinte psychologique, mais celui du bien et du mal, c’est à dire de l’atteinte morale, que l’on retrouve également via les termes « tâchée », « flétrie », employés par Paulette. Lydia, en revanche, depuis qu’elle a lu l’ouvrage J’avais 12 ans, témoignage d’une incestée violée par son père au même âge qu’elle, sait que ce que son père lui fait, se nomme viol. Pour autant, elle ne nomme pas clairement comme abus incestueux les « tripotages » commis sur elle et ses sœurs devant la famille et ses amis par l’incesteur. Et d’autre part, lors du procès, son statut de victime de viol ne semble plus si clair pour ses interlocuteurs/trices : « Lydia-Heum…ah par contre il me demandait si ça me faisait mal, souvent ça, effectivement il me posait la question, donc je disais oui alors que non. M-Hmm. L-Parce que, euh, bon, là c’est, je sais pas si tu veux des détails gore [en appuyant de la voix sur « gore »] M-C’est comme tu, comme tu le sens. L-Moi je m’en fous hein. Non, c’est qu’en fait je pense qu’il n’allait pas jusqu’au bout M-Ouais L-Parce que, y’a une histoire de « déflorée ou de pas déflorée ». Et donc, il allait pas jusqu’au bout. Donc physiquement il ne me faisait pas mal, sauf que j’allais pas dire « vas-y, tu me fais pas mal continue » M-Oui oui oui oui L-donc je lui disais « oui », voilà. [inaudible] M-Hmmhmm L-Donc voilà, donc ça ça a été un détail contre moi, parce que, plus tard, parce que « ah ben oui, mais il vous a pas déflorée donc il vous a pas violée ». Ben, si. M-Hmmhmm L-Donc, mais je pense qu’il était assez pervers pour savoir un peu la limite et, mais bon il … lors du procès, ça a été « mais de combien ? », limite fallait leur faire les scènes pour regarder le nombre de millimètres quoi. M-Hmmhmm L-Enfin c’était un peu gore quand même, mais bon … M-Un peu, oui ! L-Ouais. Mais bon, ben c’est, ils se basent là-dessus et euh M-Hmmhmm. C’est à dire qu’y aurait eu juste les attouchements, c’aurait pas été pareil ? L-Ben non, déjà, on n’allait pas aux Assises. Donc euh … sauf que moi il … d’un centimètre ou deux je pouvais pas le savoir de toute manière : je pense que je ne ressentais rien. Je pense que … j’ai souvent dit que j’étais une pierre à ce moment-là donc, sans émotions, sans rien, donc il pouvait pas me faire mal, il pouvait rien me faire. M-Hmmhmm L-Donc euh, j’étais un corps. » Que sanctionne la Justice française dans ce vécu d’abus incestueux ? Et comment accueille-t-elle les demandes d’action (plaintes) des incesté/e/s ? C’est ce que nous allons voir maintenant, côté incestées. 6) Victimes d’inceste et JusticeUn premier élément est que, dans les textes, le terme inceste n’apparaît ni dans notre Code Pénal, ni dans notre Code Civil. Dans le Code Civil, est simplement énumérée la liste des apparenté/e/s avec lesquel/le/s le mariage est prohibé. Dans le Code Pénal, est définie une échelle hiérarchisée de délits et crimes sexuels : l’atteinte sexuelle, l’agression sexuelle, le viol. Ces délits et crimes sont aggravés si la victime est un mineur de moins de 15 ans. Enfin, ils le sont encore plus si l’auteur est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui. Marie-Pierre Porchy, Juge d’instruction, relève : « la qualité de mineur et le lien de l’agresseur (parent, personne ayant autorité) avec sa victime ne sont pas pris en compte par la loi pénale au titre des éléments constituant l’infraction. Ces éléments n’en sont que des circonstances aggravantes » (Marie-Pierre Porchy, 2003, p. 26). Ceci la motive, ainsi que des victimes d’inceste regroupées en associations, à qualifier la loi française « d’incestueuse », car ne nommant et ne définissant pas l’inceste elle participe, expliquent-elles, à l’occulter. Pour autant, ces textes ne sont pas figés : ils sont la loi à un moment historique donné, faite par des humains élus par d’autres humains depuis 1789. Jusqu’à la Révolution de 1789, précisément, ce qui était condamné était non la violence sexuelle, mais la défloration : le viol, c’était la perte, par la contrainte physique, de l’honneur de la femme, et elle était tenue de préférer se défendre à mort, plutôt que « d'accepter » cet outrage. La notion de « violences « inférieures » à celles du viol » (Georges Vigarello, 1998, p. 115), inexistante auparavant en France, est créée à l’occasion de cette Révolution. Elle est pensée sous l’angle de l’atteinte à la pudeur, et non du traumatisme, concept alors inexistant [20] . Les viols de femmes adultes parviennent très peu jusqu’aux tribunaux : ce sont les viols d’enfants qui sont objet le plus souvent des très rares procédures. L’enfant y est d’ailleurs suspectée d’être « libertine » ou « débauchée ». Et ce sont des viols d’enfants non incestueux : l’inceste, quant à lui, fait atteindre au soupçon de libertinage son paroxysme, tant et si bien que l’enfant peut, elle aussi, être jugée coupable si l’affaire est portée en Justice (Georges Vigarello, 1998, p. 45). Après quelques évolutions entre les années 1850 et 1900, il faut attendre les années 1970 et un important mouvement social : le mouvement des femmes (MLF), pour de véritables changements. C’est en effet sous l’impulsion concrète des féministes et de leurs soutiens que le « procès d’Aix » en 1978 est transformé en « procès symbole » (Georges Vigarello, 1998, p. 243). Pour la première fois, le viol y apparaît comme un saccage, une destruction psychique des victimes, donc une atteinte à la personne, et non plus une atteinte morale, une flétrissure, un déshonneur pesant sur elle. D’autre part, le procès aboutit à la refonte du concept de viol dans le Code Pénal : « Plusieurs définitions se succèdent dans la séance du 28 juin 1978 au Sénat. La formule proposée à l’issue des échanges assimile viol et attentat : « Tout acte sexuel de quelque nature qu’il soit, imposé à autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol » (…) Les difficultés pourtant commencent dès la définition instituée : qu’entendre par « tout acte sexuel » ? Où s’amorce la gravité ? Le simple fait [sic] de relever la jupe d’une passante pourrait constituer un attentat à la pudeur » (Georges Vigarello, 1998, pp 248-249). Voilà les raisons pour lesquelles la version définitive choisit de préciser : « Tout acte de pénétration sexuelle ». Ce débat sur le texte législatif apparaît alors comme la résultante d’un « processus pratique au cours duquel des expériences individuelles de mépris sont interprétées comme des expériences typiques d’un groupe tout entier [ici, les femmes], de manière à motiver la revendication collective de plus larges relations de reconnaissance. » (Axel Honneth, 2000, p. 194). Par ailleurs, le nouveau texte permet de penser et punir également le viol subi par un homme, ce qui n'existait pas auparavant. Mais Georges Vigarello fait remarquer que, comme à toutes les époques antérieures, il existe un écart, en défaveur des victimes, entre le texte et son application concrète. Un exemple, probablement caricatural, de cet écart a été vécu par l’auteure de ces lignes, lors de la convocation au commissariat faisant suite à son dépôt de plainte direct au Procureur, au début des années 2000 « Elle
me demande de m'asseoir. Elle s'installe devant son ordinateur,
me montre mon courrier : " j'ai reçu votre courrier … ".
Je ne sais plus ce qu'elle a dit ensuite. Toujours est-il qu'elle
a des questions à me poser, et qu'elle note les réponses sur
son ordinateur. Des questions froides, crues, sans égard pour
ma personne. (…) Ce
n'est pas le Code qu'elle me ramène, mais un document procédural
fait par la police. [le document comporte les cases : viol
- crime = prescription 10 ans, agression sexuelle - délit =
prescription 3 ans ; la case agression sexuelle par ascendant
ou personne ayant autorité - délit aggravé = prescription 10
ans par dérogation, n’y existe pas, elle est pourtant créée
dans le Code Pénal depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998] (extrait de mes notes d’époque, prises à la sortie du commissariat pour atténuer le choc : à l’issue d’une heure de questions comme celles ci-dessus, j’apprends en effet ainsi que « c’est prescrit », ce que la fonctionnaire de police me retraduit : « non votre incesteur ne sera jamais convoqué par nous pour être questionné ») Ici, il est patent qu’il existe le Code Pénal, et son interprétation au quotidien dans un service de police spécialisé en violences sexuelles, via les mémentos procéduraux internes, en décalage parfois important. Et le décalage se fait, précisément, sur les « circonstances aggravantes » dues au fait qu’il s’agit d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Assez curieusement, est en outre évoquée la possibilité d’un « jeu sexuel » entre une enfant de 6 ans et un adulte ascendant ou ayant autorité sur elle. Cela n’est pas sans faire écho aux propos tenus par l’épouse et complice d’un incesteur, qui évoque aussi cette activité ludique : « Danielle-Donc, Mme Tromosh donc, hein, a dit au procès que tout ça euh, c’était ludique, c’était pour jouer » Cela peut également faire écho à une question qui est relevée par Lydia : « Lydia-Ce qui m’a un petit peu choquée c’est heu … parce que bon, j’ai lu tout le dossier – j’ai lu tout le dossier, et, ce qui est bizarre c’est qu’ils posent la question si, à l’époque du collège, j’étais du genre aguicheuse » Et, enfin, peut aussi faire écho à la notion de confusion formulée par des psychologues, qui la limitent peut-être un peu vite à la famille concernée : « La famille à transactions incestueuses est régie par plusieurs niveaux de confusion : confusion psychique, confusion des générations et des âges, et avant tout confusion des rôles » (Gruyer – Nisse – Sabourin, 2004, p. 102). Sauf qu’ici, nous sommes dans un commissariat de police (mon cas) ou une enquête suite à plainte pénale (Lydia). Survivances, reliques de l’Ancien Régime, comme pourrait le laisser penser un historique du viol qui montre un progrès sans faille, même s’il est un progrès heurté, au fil des époques ? Confusion ? Ou bien coexistence persistante entre différents référentiels, dont celui, bien présent et pas que pour les incesteurs, qui fait penser l’abus incestueux comme un éventuel jeu, quelque chose de ludique, voire questionne le caractère aguicheur de la jeune victime ? Peut-on remarquer le possible parallèle avec des propos d’hommes concernant le caractère « rigolo » pour eux de l’idée de violer une femme adulte (Daniel Welzer-Lang, 1988, pp 65-67) ? L’inceste, un jeu, le viol d’une femme adulte, rigolo ? Etranges confusions … Toujours est-il que, si le recours aux « psys » semble évident, celui à la Justice l’est moins : la première patronne de Lydia lui suggère le « psy » pour aller mieux, pas la plainte pénale. Et c’est aussi autour de l’axe « soin / Justice », mais pour l’incesteur, que s’organise l’hésitation d’Aurélie alors qu’elle a environ vingt ans, à la fin des années soixante-dix : « Moi-Ca t’était venu à l’idée comme ça, [inaudible] tu l’as ruminé longuement, jusqu’à ? Aurélie-Ah oui oui, jusqu’à ce que je croie que la prescription était épuisée. M-D’accord. A-Parce que dans ma tête j’avais une date. [passage inaudible] Mais ce qu’y a aussi c’est que je me suis toujours dit qu’il était malade, que c’était une maladie, [inaudible] M-Et du coup porter plainte, par rapport à lui, ça faisait ? A-Ca faisait heu, ben fallait plus le soigner que de l’emprisonner quoi. » « La violence sexuelle ne relève [alors] plus du territoire du mal, mais de celui de la santé » (Georges Vigarello, 1998, p. 280), explique l’auteur en évoquant quant à lui un décret de 1996 qui oblige les auteurs de violences sexuelles sur mineur/e/s à être incarcéré(e)s dans des établissements permettant un suivi psychologique. On peut, je pense, étendre cette remarque aux incesté/e/s lorsque l’important pour elles est exclusivement de « se soigner » du traumatisme, ou bien que … l’incesteur soit soigné, et non de dénoncer le(s) coupable(s) pour le(s) faire sanctionner. Pour autant, la plupart des incestées avec qui j’ai eu des entretiens ont tenté de porter plainte. Aurélie a été aiguillée par sa « psy » lorsque toutes deux ont compris que l’incesteur avait abusé d’autres personnes qu’elle : « Aurélie-Ben, si tu veux moi, déjà pour moi j’étais seule. Après, ben il allait toucher … et puis ma psy elle me dit « il a pas des enfants le bonhomme là ? », ben, je lui dis si. [inaudible] Moi-Ouais, ouais. Hmmhmm. A-Et elle me dit mais euh, les gens ils sont [inaudible], on devrait être obligé de signaler, de faire un dépôt de plainte, quelque chose, on peut pas, elle dit, c’est quand même un devoir, si tout le monde fait ça euh, ben … C’est comme ça que j’ai réagi, en fait. » Mais dans le commissariat « Aurélie-Tous les bureaux étaient occupés, bon puis y’a fallu qu’on reste dans l’entrée du commissariat, que je raconte ce que j’avais à lui dire [inaudible]. C’est fou hein ! M-Ouais. Et … ça c’est passé comment après ? A-Eh ben après elle me dit « ben écoutez euh, il faudrait que vous alliez parler avec Monsieur machin parce que lui euh, il s’occupe de ces affaires-là ». » [années 2000] Aurélie n’est jamais retournée là parler avec « Monsieur machin », dissuadée par cet accueil. Agnès non plus n’a jamais porté plainte, ses incesteurs étant tous décédés lorsque les incestes lui reviennent en mémoire de façon douloureuse. Quant à Paulette, elle a été porter plainte pour sa fille. Et pour elle ? Elle m’explique que l’agresseur étant mort, cela ne s’est pas posé. Et pour le cousin ? « Moi-Il est encore bien vif, oui … Paulette-C’était quand même en 1950.(…) M-[et à l’époque :] C’était déjà y’a trop longtemps ?P-Oui, et puis de toute façon, ça pouvait pas se poser pour moi, parce que j’étais toute seule. Comment voulais-tu que je fasse, comment voulais-tu que ça me vienne à l’idée ? (…)Y’aurait fallu que je rencontre quelqu’un qui me dise « ben, tu sais, ce que t’as vécu, c’est quand même pas normal, tu pourrais peut être faire quelque chose », mais, hop. (…)Non je … mon prof de sciences nat’, quand j’étais en 4e, aurait peut être pu faire ça. Parce que j’avais des, j’avais des rapports vraiment très, très … M-Hmmhmm P-Oui, on discutait beaucoup, mais … (silence, puis chuchoté) je pense pas que ça se faisait, à l’époque, tu vois. (…)Pas pour des trucs datant d’aussi loin dans le passé. Parce que quand j’étais en 4e, quand j’étais en 4e, c’était, c’était en … 1950. Ah ben non, c’était pas y’a si longtemps que ça. Non c’est vrai, c’était pas très très vieux. Mais de toute façon, comme il était mort, y’avait rien à faire. M-Ouais, d’accord. P-Et le cousin, aller porter plainte pour des attouchements, alors là vraiment je pense que, on m’aurait dit mais c’est ridicule, c’est risible. Je t’assure hein. » Une différence frappante avec les plus jeunes est que ces dernières ont effectivement porté plainte. Mais peut-être une différence est-elle surtout qu’elles, ont pu croiser des interlocuteurs/trices qui leur disent « ben tu sais, ce que tu as vécu, c’est quand même pas normal, tu pourrais peut-être faire quelque chose ». Lydia porte ainsi plainte 7 ans après sa majorité, car elle en a marre que sa famille ne la croie pas quand elle explique que son père l’a violée, et aussi parce que, participant à une association de victimes d’inceste, elle se rend de plus en plus compte que les conséquences de l’inceste dans sa vie, c’est grave, c’est important. Danielle porte plainte parce que lorsque son beau-père apprend les actes incestueux de Tromosh, pour lui, c’est évident : il faut porter plainte. « Moi-donc, tu en as parlé à ta grand-mère, puis elle t’as invitée à en parler à ta mère D-Et ma mère en a parlé à [mon beau-père] qui a immédiatement, immédiatement appelé heu, ssss … parce qu’il avait, il connaissait une avocate, qui était très bien (…) Enfin bon, il a, immédiatement lui c’était heu, c’est pas possible ça peut pas, ça peut pas passer comme ça. » C’est d’ailleurs le seul cas, parmi mes entretiens, où un membre de la famille de l’incestée se positionne de cette façon. Il s’agit de plus d’une plainte groupée : la grand-mère de Danielle informant tout le reste de la famille, il s’avère qu’il y a d’autres incesté/e/s. Presque toutes les victimes de cet incesteur se succèdent au même commissariat de police pour déposer plainte. « Danielle- En fait, vu qu’il prenait la plainte de mes deux cousines qui étaient encore mineures, il a pris ma plainte aussi mais c’était un [inaudible] pour mineurs, comment on appelle ça ? M-D’accord, spécialisé quoi. D-(…) Et … j’ai lu ce qu’il avait écrit après, enfin, ce que j’avais dit en fait. C’était, très, très, très bien, enfin, il a écrit exactement ce que je lui ai dit (…). C’était très complet, (…) enfin, je, j’avais été impressionnée par la façon dont il avait réussi à retranscrire tout ce que je lui avais dit, sans, sans le détourner, sans … » A la gendarmerie où elle se rend, Lydia est également bien reçue, ce qui revêt une importance particulière, qu’elle explique : « Lydia-Donc le lendemain j’y vais avec ma mère, et, voilà, je porte plainte pour euh, pour viol et une femme flic m’a auditionnée pendant 4 heures. Ca a été superdur, mais bon elle a fait des pauses, parce qu’elle voyait que c’était superdur. Elle m’a fait faire des dessins des tables où j’avais été violée, des pièces où étaient les lits et tout ça. Et au bout des 4 heures, elle m’a dit une phrase que j’oublierai jamais c’est : « je sais pas si ça peut vous aider mais moi je vous crois ». Donc elle, au bout de 4 heures, me dit « je te crois », enfin « je vous crois », alors que ma famille il leur a fallu 7 ans. Donc voilà, puis c’était pas n’importe qui c’était, pour moi c’était la Justice, donc c’était très important. » Ainsi, durant les années 2000, en France, l’accueil dans les commissariats demeure aléatoire, oscillant, un peu comme celui par les « psys », entre le pire et le meilleur. Pour autant, l’entretien avec un/e policier/e n’est que la première étape d’une procédure en Justice, et, au final, seul l’incesteur de Lydia, chauffeur routier au chômage, sera condamné à plus de 10 ans de prison ferme en première instance, puis sa peine sera divisée par deux en appel. La Juge a tout fait, m’explique Lydia, pour obtenir encore plus d’aveux de lui jusqu’à la fin du procès. L’incesteur de Danielle, en revanche, est condamné à 4 ans de prison avec sursis. Danielle me rapporte que la Juge regrettait vivement qu’il lui échappe du fait de la prescription de certains faits, dont ceux touchant Danielle. Mais elle ne sait pas bien ce qui s’est passé, car « Danielle-Voilà donc j’ai, signé ma plainte et, heu, je suis repartie à [ville], parce que j’habitais à [ville], et à partir de là plus de nouvelles. Du tout. De ce qui se passait. Y’a eu un procès, j’étais pas au courant que le procès avait lieu, je sais pas ce qui s’est passé, personne m’a tenue au courant Moi-Hmm. Alors que t’avais porté plainte. D’accord. D-(…) C’est tous les faits, pour moi c’étaient tous les faits qui étaient avant 86 étaient prescrits. (…) Et après 86 y’a eu des trucs et je sais que c’était noté dans ma plainte, donc y’a quelque chose qui va pas. (…) y’a trois tonnes de trucs qu’étaient pas prescrits je, je, je comprends pas. Et donc j’ai pas été prévenue du procès, j’ai été prévenue du rendu du jugement, (…) je suis venue pour mon anniversaire chez ma mère, en fait. Et y’a ma grand-mère qui me dit « ah tiens le rendu du jugement pour Tromosh c’est aujourd’hui ». Ah. D’accord. M-Donc ta grand-mère elle elle était au courant ? D-Oui. Oui oui. Mais je pense qu’elle devait croire que j’étais au courant » Elle a pensé ensuite à demander l’accès aux minutes du procès, mais il s’est tenu dans la ville de l’incesteur, et aller à cet endroit est impossible pour elle : cela la rend malade. Quant à Lydia, qui depuis dix ans prenait des traitements antidépresseurs : « Moi-Et … en même temps, ces traitements t’as pu les arrêter après le procès, est-ce que … Lydia-Ouais. Le procès y a joué pour beaucoup. D’avoir été reconnue victime et lui coupable, et ça me fait mal de dire ça parce que, ben, quand je vois toutes celles sur les forums [internet], ça me bouffe, ça me bouffe, et je m’en culpabilise de me dire pourquoi moi j’ai eu de la chance et pas les autres. M-Hmmhmm L-Pourquoi moi j’ai le droit à un procès qui s’est bien passé, j’ai le droit à des aveux, j’ai réussi à le piéger machin et tout et, quand je vois l’effet que ça a sur ma vie (…) » Ainsi, le procès et la condamnation ont des effets bien réels pour Lydia, mais la culpabilité revient, sur le mode du « pourquoi moi et pas aussi tou/te/s les autres ? ». Le fait d’obtenir Justice est assimilé à de la « chance ». « Chance » qui permet aussi ceci : « Lydia-Le procès a remis vraiment les choses à leur place même vis à vis d’eux [les frères et sœurs et la mère de Lydia]. Vis à vis de leur propre histoire, euh, qu’après chacun dira ce qu’il voudra, mais ça a remis les choses à leur place. C’est que c’est lui l’abuseur, c’est lui le méchant. » En effet, « De même que le passage au game confère à l’enfant la capacité d’ajuster son comportement sur une règle qu’il dégage en faisant la synthèse des perspectives des différents joueurs, de même le processus de socialisation en général s’effectue sous la forme d’une intériorisation de normes d’action produites par la généralisation des attentes de tous les membres de la société. En apprenant à généraliser en lui-même les attentes normatives d’un nombre toujours plus grand de partenaires, au point de les ériger en normes sociales d’action, le sujet acquiert la capacité abstraite de participer aux rapports d’interaction de son environnement conformément aux règles qui les régissent. Car ces normes intériorisées lui disent à la fois quelles attentes il peut légitimement adresser aux autres membres du groupe, et quelles obligations il est tenu de remplir à leur égard. » (Axel Honneth, 2000, p. 95). L’action de la Justice, sous la forme de la Cour d’Assise dont le Jury représente symboliquement tou/te/s les membres de la société, a ainsi pour effet de s’opposer à la socialisation incestueuse. Ceci, en amenant un nombre plus grand de partenaires sur lesquels s’ajuster, que ce n’était le cas avec ce « partenaire » unique à la perspective unique et destructrice qu’était l’incesteur. Cela induit une évolution des normes intériorisées par les membres de la famille de Lydia. En revanche, quand il y a prescription, les incesté/e/s sont tout à fait officiellement contraintes au silence. Eva Thomas relate cette découverte qui est l’objet de son deuxième livre : « Elle vient de relire ce qu’on en disait dans la presse (…) « le procès de la honte », « la mémoire violée », « le non droit à la parole ». (…) Le président a rappelé chaque fois aux témoins : « vous chercherez autant que faire se peut, dans votre déposition, à ne pas témoigner sur la vérité des faits diffamatoires, puisque la preuve en est interdite. » Il est interdit de parler publiquement de faits prescrits non jugés. C. a parlé à la télévision des viols incestueux subis dans l’enfance, elle en a parlé sans donner son nom, ni le lieu [mais à visage découvert]. (…) Son père a porté plainte en diffamation et maintenant C. est là, assise au banc des accusés, c’est elle la « prévenue » et son père a le droit de l’attaquer et de demander des dommages et intérêts. L’avocat de C. résume la situation : « le père vient demander publiquement réparation, en honneur et en argent, des viols qu’il a commis sur sa fille ». Mais cette phrase-là est aussi interdite, en principe. La vérité est interdite de tribunal aujourd’hui. » (Eva Thomas, 2004, pp 25-27). Suite à ce procès qui a eu lieu en juin 1989, et a suscité l’indignation, les délais de prescription ont été allongés une première fois pour les viols et agressions sexuelles sur mineur/e par ascendants ou personnes ayant autorité. Le problème de fond subsiste néanmoins : tou/te/s les incesté/e/s pour lesquelles il y a tout de même prescription aujourd’hui, comme Paulette, Aurélie ou Danielle, sont exposées au même risque, si elles parlent publiquement, tant que leur incesteur est en état de porter plainte. Finalement, on peut remarquer avec Axel Honneth que « il s’agit [là] des modes de mépris personnel dont un sujet est victime lorsqu’il se trouve structurellement exclu de certains droits au sein de la société. [ici, celui de pouvoir, à minima, témoigner, faire récit d’un crime subit] (…) l’expérience de la privation de droits est typiquement liée à une perte de respect de soi, c’est à dire à l’incapacité de s’envisager soi-même comme un partenaire d’interaction susceptible de traiter d’égal à égal avec tous ses semblables » (Axel Honneth, 2000, pp 163-164), or, « parce que l’idée normative que chacun se fait de soi-même – de son « moi », dans la terminologie de Mead – dépend de la possibilité qu’il a de toujours se voir confirmer dans l’autre, l’expérience du mépris constitue une atteinte qui menace de ruiner l’identité de la personne tout entière » (Axel Honneth, 2000, p. 161). 7) La parole et ses effets : généalogies de l’incesteD’autre part, ce problème de fond s’avère important aussi parce que c'est, précisément, quand d'autres parlent des abus sexuels subis, que la plupart des incestées que j'ai écoutées peuvent nommer ce qui leur a été fait.Lydia lit, adolescente, le témoignage de Nathalie Schweighoffer, violée par son père aux mêmes âges qu'elle, ce qui lui fait comprendre que ce qu'elle subit s'appelle « être violée par son père ». La fille de Paulette, entendant le témoignage d’Eva Thomas à la télévision, explique à sa mère après des années de silence, que l’histoire d’Eva, c’est aussi son histoire à elle. C’est ainsi que Paulette prend contact avec SOS inceste, pour sa fille … et en discutant avec les membres de l’association, intègre que le « péché mortel » dont elle était coupable se nommait en fait abus sexuel dont elle était victime, assimilable à un inceste. C’est une émission de Delarue sur ce thème, qui permet à Aurélie d’en parler à son frère cadet. Quant à Danielle, c’est en 1996 qu’elle a 20 ans et parle, ce qui peut peut-être expliquer le mot « pédophilie » mis par ses mère, grand-mère et beau-père, sur les exactions de Mr Tromosh, mot repris par elle pour nommer ces exactions : c’est en 1996, précisément, que Marc Dutroux et la pédophilie sont sous le feu des projecteurs médiatiques. Pédophilie, viol par le père, inceste : des mots prononcés dans l’espace public via émission télévisée ou livre, qui permettent aux incestées de « penser aux viols comme à des viols » (Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, 2007, p. 17), et plus largement aux abus sexuels comme à des abus sexuels. En revanche, la variété des mots utilisés pour qualifier ces abus montre que l’assertion selon laquelle « Tous [les enfants], victimes ou non, savent que l’inceste est interdit » (Dorothée Dussy, Léonore Le Caisne, 2007, p. 16, souligné par moi) est fausse aujourd’hui, tout comme elle l’était lorsque Marie-Pierre Porchy constatait : « dans le cadre de mon activité professionnelle, il m’est arrivé de faire des interventions scolaires au titre de la prévention de la délinquance. Certains établissements scolaires ont ainsi souhaité que je sensibilise les enfants à la prévention des abus sexuels. J’ai découvert, avec une certaine stupeur, que de nombreux enfants ignoraient non seulement le terme même d’inceste, mais également sa prohibition elle-même » (Marie-Pierre Porchy, 2003, p. 25). Bien sûr, si le mot n’est jamais prononcé, comment peut-il être connu et pensé, au premier chef par les enfants incesté/e/s à qui l’incesteur explique, comme à Danielle par exemple, que leur relation, c’est un peu comme dans le film « les oiseaux se cachent pour mourir », donc permis et tout à fait normal ? Mais le témoignage public d’autres incesté/e/s, ou bien « parfois un policier ou un juge qui, lors d’une allocution télévisée ou dans un entretien publié, relate une affaire d’inceste, notifi[ant] qu’il s’agit d’un crime (…) [ou encore] Par la légitimité de son écoute, le psychanalyste. » (Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, 2007, p. 18), s’ils permettent de penser aux abus comme à des abus, permettent également, ensuite, de mettre au jour la généalogie de l’inceste, comme cela a été le cas pour Aurélie par exemple. On se souvient qu’Aurélie avait parlé à ses parents, à 8 ans, des violences sexuelles qu’elle subissait de son demi-frère régulièrement, durant leurs absences. Ce demi-frère a été corrigé à coups de ceinturon par leur père, la mère restant sans réactions. L’affaire a été close ainsi par les parents. Cet incesteur, quant à lui, a continué ses agressions jusqu’à son départ de la maison. Bien plus tard, en 2002, suite à son début de psychothérapie, Aurélie recontacte sa mère par téléphone. Elle apprend alors que sa mère avait été incestée par un oncle paternel, mais « Aurélie-[citant sa mère parlant d’elle : ] « Et puis elle est pas forte, parce que moi aussi je sais ce que c’est : j’ai subi ça trois fois [inaudible] », puis elle avait été plus forte que moi parce qu’elle elle était arrivée à garder … M-Ah ouais ! [ton surpris] A-Ah ouais, et que moi, j’étais faible » Faible pour n’avoir pas gardé le secret, la force étant ici de savoir se taire ! Quelle règle ! Stéphane La Branche explique que « Les règles apprises dans des situations bien précises [par exemple d’abus incestueux] et névrosées en viennent à se généraliser et à se pérenniser. (…) Les règles internalisées deviennent la façon unique de vivre, de ressentir, de percevoir et de se comporter avec les autres. Ceci permet aux relations de pouvoir [ici, à l’inceste] de se propager. » (Stéphane La Branche, 2003, p. 32). Voici la suite de la mise au jour de cette propagation : en 2002 également, un soir, Aurélie regarde une émission à la télé en compagnie de son petit frère. C’est une émission de Delarue sur l’inceste. A la fin, elle lui explique que ça lui est arrivé à elle aussi, ce qui est montré à la télé, et demande à ce frère de ne pas le répéter. Il lui répond alors que lui aussi a été abusé par ce demi-frère : « Aurélie-M’enfin lui il dit « voilà, moi, j’ai subi des choses, mais quelque part, j’ai pas été trop maltraité, hein. Il me dit, voilà, j’ai fait ma vie » Et toujours avec Stéphane La Branche, je remarque ici que « La dénégation se manifeste dans le silence que la victime s’applique à elle-même, ce qu’elle s’empêche de penser. Elle nie la colère, la peur et même les événements et leur importance. (…) [Mais] lorsque l’enfant nie pour lui-même ce qui s’est passé au sein de la famille, il commence à internaliser les règles de la dynamique familiale induites par l’abus, et à les accepter comme étant les siennes » (Stéphane La Branche, 2003, p. 29). Aurélie a moins bien réussi dans cette entreprise, c’est probablement pour cela qu’elle passe pour la « faible », la « fragile psychologiquement », la « malade » de la famille, notamment auprès de sa petite sœur. Lasse de ce statut, justement, elle lui explique lors d’une conversation téléphonique les incestes qu’elle a subis de leur demi-frère. C’est à la suite de cette conversation que la petite sœur retrouve ses souvenirs d’abus à elle … Enfin, en 2006, après une séance de psychogénéalogie, Aurélie ressent une colère contre elle-même et contre sa mère qui la conduit à l’envoi d’une lettre à cette mère, au demi-frère agresseur, et à sa grande sœur, avec copie pour information à son petit frère et à sa petite soeur. C’est alors que la grande sœur confie à leur petit frère avoir été elle aussi abusée…en lui demandant également le secret. Secret dont aura vent Aurélie à l’occasion d’une conversation avec ce dernier, car, me précise-t-elle, quand il a bu, il devient plus facilement bavard. Elle comprend donc là que son demi-frère a abusé de toute la fratrie. Cela la pousse à téléphoner à une des filles de ce demi-frère, qui a deux filles et un garçon, tous majeurs. Sur le coup, cette dernière ne lui répond rien. Mais le soir, elle craque, et va confier au petit frère d’Aurélie que son père, le demi-frère d’Aurélie, l’a abusée elle aussi. On se souvient alors qu’Aurélie avait pensé à porter plainte, autour de ses 21 ans. Mais qu’elle se disait à cette époque qu’il fallait plus soigner son jeune incesteur que le punir (ni l’un ni l’autre n’a de toute façon pu être tenté). Aujourd’hui, elle regrette ne pas avoir porté plainte alors, quand elle voit le nombre de personnes qu’il a abusé cependant qu’elle pensait être sa seule victime : son opinion est que seule la police peut arrêter cela, sinon, affirme-t-elle, cela va continuer sur des générations. La nièce d’Aurélie ne voulant pas porter plainte contre son incesteur, ce dernier est toujours dans l’impunité. Aurélie étant de toute façon hors délais pour porter plainte elle-même, conclut, crûment : « Aurélie-Alors faut attendre la chair fraîche. » Quant à sa situation vis à vis de sa mère, suite à cette dénonciation de son incesteur dans sa famille, elle transparaît dans les attitudes de cette dernière alors qu’elles sont au chevet de la petite sœur, atteinte d’une maladie dont elle mourra peu après : « Aurélie-Elle a fait comme si j’étais une étrangère. (…) J’étais dans la chambre d’hôpital, j’aurais été la voisine de ma sœur c’aurait [inaudible]. Je faisais plus partie de la famille. » C’est ainsi que lorsque la victime « persiste dans sa révélation et sa dénonciation, [elle sera alors], et avec elle ceux qui la soutiennent, (…) vraisemblablement sacrifiée ou rejetée, implicitement ou non : on oubliera de lui rendre les clefs de la maison de campagne, on ne la conviera plus aux réunions familiales, à moins qu’on refuse définitivement de la revoir. » (Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, 2007, p. 30). L’histoire de Lydia pourrait presque être la suite de celle-ci, à la différence qu’Aurélie a fait au mieux pour dénoncer son demi-frère, et que Lydia a porté plainte contre son père « Lydia-je vais revenir quelques années avant, heu, quand rien ne se savait, je devais avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. J’allais dans sa famille à lui, notamment chez une de ses sœurs à lui, donc une de mes tantes, et un jour je lui ai dit : « voilà ce que ton frère m’a fait », elle m’a dit textuellement « je te crois, il m’a fait la même chose quand j’étais jeune ». (…) M-Donc elle elle a été abusée par son frère aîné ? L-Voilà, quand ils étaient jeunes. Sauf que elle me dit écoute, je croyais que c’était normal, et elle m’a dit après j’ai rencontré mon mari et après j’ai fait ma vie. (…) Et elle a ma mère au téléphone, et à un moment donné j’entends ma mère crier « mais pourquoi tu l’as pas dit avant, ça fait 7 ans que ma fille elle souffre ! », donc ma tante venait d’avouer à ma mère, que ben elle avait été abusée par lui quand elle était jeune (…) Moi lors de la plainte, je me suis pas démontée(…), j’ai dit ben voilà ce que ma tante m’a dit, elle l’a avoué à ma mère et à mon frère. Donc maintenant il va sans dire que je suis personne non grata là-bas, vaut mieux pas que j’aille foutre les pieds à [ville] parce que sinon M-Y compris auprès de ta tante ? L-Surtout auprès de ma tante ! Elle voulait pas que ça se sache, donc, voilà. (…) M-En fait comment tu es devenue persona non grata pour elle, comment ça s’est … ? L-Ah ben quand j’ai porté plainte contre son frère. M-Et … enfin, elle t’as dit reviens plus me voir ? Enfin ça c’est passé comment ? L-Ah oui oui, bien sûr, bien sûr, c’est, t’aurais pas du faire ça, euh, voilà, mes grands-parents [paternels], c’est (…) on n’est plus tes grands-parents, enfin voilà quoi » Cette tante a quant à elle, lors du procès, nié avoir subi des abus incestueux, et a finalement contribué à financer l’avocat de l’incesteur de Lydia. Ainsi, nous voyons se dessiner à travers ces deux cas de figure, d’une part, l’existence d’une véritable généalogie de l’inceste, connue partiellement des incesté/e/s dès lors qu’elles ont commencé à parler dans leur famille d’origine. D’autre part, le rôle clef du silence dans la continuation des violences incestueuses, dans la continuation de cette généalogie de l’inceste, et enfin, un véritable système de sanctions interne à la famille. Là où la Justice ne juge pas l’incesteur, la famille proche de l’incesteur, elle, en revanche, sanctionne l’incesté/e qui a osé parler ou porter plainte, et ce d’une des sanctions les plus sévères possibles : l’ostracisation, le bannissement. Dans le meilleur des cas présent dans mon corpus, qui reste pourtant peu enviable, l’incesteur est lui aussi mis à l’écart, du moins en certaines occasions : c’est le cas dans la famille de Danielle. Ainsi, lors du mariage de sa cousine Sandrine, postérieur au procès, Danielle n’a pas été invitée. Son oncle dont les filles ont révélé avoir été aussi abusées a failli ne pas être invité non plus. Finalement, trois personnes ne seront pas invitées à ce mariage : l’incesteur, Danielle, et l’aîné de ses cinq cousins, celui qui avait parlé à ses parents bien avant le procès (ces parents s’étaient alors contentés de ne plus laisser leurs enfants seuls avec Mr Tromosh, sans se soucier de savoir s’il existait d’autres victimes, ni envisager de porter plainte). La mère de cette cousine, fille de l’incesteur, a de plus soufflé à la mère de Danielle, lors de ce mariage, un « j’espère que vous ne ferez pas de scandale ». Ainsi, sont renvoyé/e/s dos à dos l’auteur du crime et celles de ses victimes qui ont eu le courage de le dénoncer. Dos à dos ? En apparence seulement : il faut préciser que cette fille de l’incesteur, ainsi que Sandrine, sont restées en relation avec lui. Ceci cependant que les autres enfants de l’incesteur, eux, ont à l’inverse déménagé à plusieurs centaines de kilomètres de la ville où il réside … après avoir, selon la grand-mère de Danielle, expliqué durant le procès qu’il serait mauvais pour ses victimes (leurs enfants) que leur incesteur aille vraiment en prison. La généalogie de l’inceste est d’ailleurs particulièrement impressionnante ici, Mr Tromosh ayant abusé au moins dix enfants dans la famille. Pour autant, elle montre aussi que le terme « généalogie de l’inceste » est peut-être trop restrictif : dans la famille de Danielle, il n’y a semble-t-il pas eu d’incestes auparavant. En revanche, il y a eu de la violence intrafamiliale et au moins un abus sexuel non entendu. Violence du grand-père sur la grand-mère maternelle de Danielle, ainsi que sur leurs trois enfants (dont la mère de Danielle). En plus des coups, Danielle me cite la répartition de l’espace dans ce foyer : son grand-père s’était réservé pour lui seul une des deux pièces de 15m2 de l’appartement, qu’il fermait à double tour. Après la naissance de leur dernier enfant, son épouse a dormi sur un matelas dans la salle à manger, cependant que leurs trois enfants se partageaient la pièce restante, minuscule (« 3m2 », m’explique Danielle). Abus sexuel non entendu, enfin, celui de cette même grand-mère, enfant, par un garçon de ferme : elle n’a pas été crue par sa mère quand elle a tenté d’en parler. C’est d’ailleurs cette expérience qui l’aide à croire Danielle d’emblée. Et c’est précisément lorsque Danielle lui confie ce que lui faisait Mr Tromosh, que cette grand-mère lui apprend ce qu’elle avait subi elle aussi jadis. Enfin, Paulette est la seule incestée de sa fratrie, ce qui semble faire exception par rapport aux autres cas de figure relatés dans mes entretiens. Mais Paulette n’y est pas pour rien : alors qu’elle rentrait les vaches, elle prenait soin de faire en sorte que la fermière s’occupe de sa sœur et de sa cousine, et terminait seule son travail, dans l’étable où elle savait que l’attendait (et les aurait attendu …) son abuseur. Ensuite, elle est effectivement la seule dans la fratrie à avoir été incestée par son cousin, ce qui laisse alors cours de sa part à des questionnements culpabilisants autour du « pourquoi juste moi ? » « Paulette-il a du sentir, il a du comprendre, il a, il doit savoir quelque part, ça doit se voir, à ma manière d’être, que je suis pas pure, que je suis pas fraîche … il a du le comprendre, c’est pour ça qu’il me tombe dessus, parce que, il s’en prend pas à ma sœur, il s’en prend pas à sa sœur [il a une sœur] » Elle me signale par ailleurs, hors magnétophone, que sa mère lui a confié lors de leur entretien l’existence d’autres abus dans sa famille, aux générations antérieures. Puis, quand elle lui demande : « et toi ? », cette dernière se contente de ne rien répondre, et de se réfugier dans sa tasse de thé, ce qui coupe court au dialogue sur ce sujet. Quoiqu’il en soit, l’histoire de Paulette montre comment les effets ravageurs de la honte et de la culpabilité peuvent conduire à accepter de subir, de se sacrifier. Et c’est précisément cette acceptation des violences sur soi, ce sacrifice, pièce importante de la socialisation incestueuse (« l’habitus » de Dorothée Dussy), qui permettent que la violence et les abus continuent, bien couverts par le silence. Silence
poussé à son extrémité, car si « Lorsque l’enfant demande
de l’aide, son discours et son expérience sont souvent niés par
la famille immédiate qui évite de faire face à la situation. »
(Stéphane La Branche, 2003, p. 28), l’enfant devenu adulte
n’en arrive-t-il pas à nier, tout comme son entourage, son besoin
d’aide, son expérience d’abus, à éviter ainsi de faire face à
la situation ? Que l’on songe aux « c’est pas grave »
(Danielle), « mon histoire n’est rien à côté de … »
(Paulette), aux « je croyais que c’était normal » (tante
de Lydia), « j’ai pas été trop maltraité, j’ai fait ma vie »
(frère cadet d’Aurélie), etc. Ainsi se continue, des décennies
après, et avec leur concours, la logique destructrice des personnes
initiée par l’abus sexuel.
Au cours de ce mémoire, nous avons vu comment l’inceste ne correspond que rarement au schéma de l’événement surgissant brutalement de l’extérieur, dans la vie des incesté/e/s (comme une effraction de domicile par exemple). Nous avons vu comment au contraire, il est préparé, construit par l’incesteur au quotidien, et s’inscrit dans une stratégie plus globale de contrôle, de pouvoir, soit de l’incesteur, soit d’une personne qui le soutient de fait et fait corps avec lui (mère d’Aurélie par exemple). Souvent, les abus sexuels y sont une des faces d’un iceberg plus vaste, qui touche tous les aspects de la vie familiale : l’argent et son utilisation, les relations dans le foyer, en constituent des aspects importants. En fait, l’inceste apparaît non comme un désordre, mais comme un système, ou pour reprendre l’expression de Dorothée Dussy, un « ordre social » : il n’est donc pas simplement une relation abusive entre une victime et un coupable, mais aussi un système relationnel entre tou/te/s les membres de l’entourage familial. Notamment, ressort la position des mères, seul recours souvent pensé par les incestées dans mon corpus. Les comparaisons avec la dictature ou le système tortionnaire associé, et pour ce dernier dans ses développements les plus « modernes » : la torture sans traces (« torture blanche » - Sironi, 1999), permettent par ailleurs de situer l’inceste dans les pratiques de mise sous terreur et de démolition utilisant la violence sur le sexe (comme la gégène), plutôt que comme une pratique sexuelle déviante par exemple d’un incesteur qui agirait ainsi par « confusion » entre sa femme et ses filles ou sous l’emprise de quelque autre problème sexuel expliquant ses actes sidérants. Mais ces comparaisons ne permettent néanmoins pas de penser la violence « at home », au foyer. En ce sens, l’étude et la comparaison avec la famille esclavagiste créée au Brésil par des européen/ne/s, et ayant existé jusqu’à la fin du 19e siècle, peut plus probablement permettre de commencer à penser cette violence spécifique. L’inceste et la violence intra familiale souvent concomitante ont une histoire intergénérationnelle, une généalogie, et constituent une socialisation à ne rien valoir, à se détruire, à accepter d’être détruit/e voire à participer à, ou devenir complice de la destruction d’autres personnes. Il se transmet par le silence, et celles/ceux qui s’obstinent à refuser de maintenir ce silence se voient sanctionné/e/s (ostracisation) par la famille de l’incesteur. Les dégâts les plus notoires de l’inceste semblent se situer dans les possibilités de relations de couple, souvent spontanément subies par devoir suite à la socialisation incestueuse (« le rendre heureux », « tenir le coup », etc). Mais l’impact de l’inceste touche aussi le rapport au travail, ainsi que beaucoup d’aspects de la vie quotidienne que je n’ai pas développés ici. Cet impact peut être très différé dans le temps. L’inceste est donc un crime qui n’est jamais archivable, et même des décennies s’étant écoulées, il imprègne fréquemment toute l’existence des incesté/e/s, dans ses moindres replis ... en silence. Pour autant, le silence sur l’inceste ne se limite pas aux familles incestueuses. Ainsi, certain/e/s psychothérapeutes y participent, en évitant le sujet alors même que les incestées l’abordent. D’autres psychothérapeutes mettent en doute l’existence même de l’inceste : ici, il ne s’agit pas de soupçon sur l’ampleur du traumatisme comme cela a été étudié par Didier Fassin et Richard Rechtman par exemple, mais de mise en doute des faits relatés par l’incestée. Pour autant, le/la psychothérapeute peut aussi avoir un rôle crucial dans le dévoilement des différents incestes dans la famille … s’il/elle entend (cas d’Aurélie). Les incestées ont pour certaines des difficultés avec la thérapie telle qu’elle est pensée : l’argent, le coût, peut constituer un obstacle, comme un piège qui se referme, l’incestée pensant comme l’incesteur le lui a appris « ne pas mériter » cette dépense précise, et n’osant pas discuter pour autant les tarifs. Par ailleurs, il existe une hiérarchie des abus à laquelle les incestées adhèrent souvent. Hiérarchie qui étrangement aide beaucoup d’entre elles à continuer à rester dans la case « ce qui m’est arrivé n’est pas grave ». Hiérarchie viol/autres violences sexuelles. Hiérarchie selon le lien de parenté avec l’incesteur (différence de génération ou non, famille par le sang ou non, père ou autre incesteur). Hiérarchie inceste/hors inceste parfois (Paulette), cette dernière démarcation ayant des frontières aux définitions diverses et contradictoires entre elles dans les associations de victimes, et étant entendue à l’inverse dans un sens parfois très restrictif par des incestées ou leurs proches. Cette hiérarchisation des abus est reprise par la Justice, alors que de surcroît l’inceste n’existe pas dans les textes pénaux et civils français (ce qui évite il est vrai la difficile question d’en construire une définition consensuelle et adaptée). De plus, telle qu’elle est conduite aujourd'hui, cette Justice ne permet qu’à un nombre faible d’incesté/e/s d’obtenir reconnaissance. Ses délais pour déposer plainte ne sont pas adaptés à la temporalité du crime incestueux. L’accueil reste très disparate, la minimisation du crime (était-ce un jeu ?), voire la culpabilisation de sa victime (cette enfant de 11 ans était-elle aguicheuse ?), s’ils ne font plus l’unanimité, restent néanmoins bien vivaces. C’est ainsi que la majorité des incesté/e/s sont renvoyé/e/s au silence, au non lieu, au sans suite, qui laisse intacts tous les droits et obligations familiaux (y compris les droits de visite de l’incesteur sur les futurs enfants de ses victimes …). Comme si de rien n’était. Ainsi, la mascarade familiale peut continuer, conforter tout/e un/e chacun/e dans l’idée que l’inceste, ce n’est pas si grave que cela, finalement, et la famille a champ libre pour sanctionner d’ostracisme les personnes qui ont fait scandale pour « si peu ». Si bien qu’en fait, les possibilités de reconnaissance pour les incesté/e/s dans la société française d’aujourd’hui restent précaires, tributaires de la rencontre avec un homme (ou une femme) patient(e), de l’obtention d’un travail permettant une reconnaissance de ses qualités, d’un/e psychothérapeute qui saura entendre, ou encore de ce que Lydia appelle la « chance » en Justice. Cela ne peut d’ailleurs qu’interroger sur les représentations et connaissances de l’inceste qu’ont les interlocuteurs/trices clefs des incesté/e/s : les psychothérapeutes et personnels judiciaires notamment [22] . Il est également possible d’interroger les rôles des mères : pour ma part, j’ai eu accès à des filles de mères généralement non protectrices (voire ostensiblement complices), alors que les associations d’aide aux enfants maltraités ont à l’inverse accès uniquement aux familles où il existe un parent protecteur (souvent la mère). Il m’est alors signalé les difficultés rencontrées par ces mères lorsqu’elles ont à divorcer d’un incesteur pour protéger leur enfant : les mises en cause de la parole de la mère, soupçonnée de manipuler son enfant à la fin d’en obtenir la garde exclusive, ne semblent pas rares. Autre limite de ce travail : je n’ai pas eu d’entretiens avec des hommes incestés, ce qui pourrait être intéressant pour voir les différences et similitudes, les trajectoires de vie personnelles, professionnelles et familiales des hommes et des femmes étant très différenciées dans l’ensemble de la population en France. Enfin, une dernière limite, déjà nommée, est le fait d’avoir eu un entretien avec une personne par famille, toujours celle qui a parlé/dénoncé l’inceste en premier d’ailleurs, ce qui ne permet pas de varier les points de vue comme a pu le faire par exemple Oscar Lewis dans Les enfants de Sanchez. A l’exception de cette dernière limite, plus difficile à contourner, voilà autant de pistes possibles pour une poursuite de cette recherche en master 2. Je pense privilégier celle de l’étude des représentations de l’inceste existantes chez les professionnel/le/s ayant affaire aux victimes d’inceste (anciennes ou encore enfants), et la mise en regard avec l’ordre incestueux tel qu’il peut être pensé à l’issue de mes entretiens avec des incesté/e/s [23] . --------------------------------------------- Quelques termes … Cousine croisée : fille d’une sœur du père d’ego, ou bien fille d’un frère de la mère d’ego. (ego : c’est « moi », c’est la personne dont on part, dans le graphe de parenté) Cousine parallèle : fille d’une sœur de la mère d’ego, ou bien fille d’un frère du père d’ego. Habitus : « L'agent social pour Bourdieu, agit parce qu'il est agi, sans le savoir, par un (…) système de dispositions à agir, percevoir, sentir et penser d'une certaine façon, intériorisées et incorporées par les individus au cours de leur histoire. [ C’est cela, l’habitus] (…) Tout cela se fait sans recours à la réflexion consciente, grâce aux dispositions acquises fonctionnant comme des automatismes. » (Source : http://www.barbier-rd.nom.fr/violencesymbolique.html)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inceste :
faut-il réagir ou désinformer ? Par Dorothée Dussy, anthropologue au CNRS (laboratoire d’anthropologie urbaine), et Marc Shelly, médecin de santé publique, hôpital Fernand-Vidal. tribune libre, L'humanité, 25 mars 2005 « Une bonne campagne contre l’inceste devrait montrer aux parents les limites de l’intimité de l’enfant, en expliquant par exemple qu’il faut fermer la porte de la salle de bains pendant la douche », dit Annie Gaudière, directrice générale de l’organisation Allô enfance maltraitée (le 119), dans l’édition du Monde du 22 février. Les appels téléphoniques reçus par le 119 révéleraient donc des situations de vie à ce point différentes de ce que décrivent les victimes d’inceste devenues adultes pour qu’Annie Gaudière réduise l’abus sexuel intrafamilial à une histoire de porte ouverte ? L’enquête ethnographique et la consultation en milieu hospitalier permettent d’établir un constat certain : l’abuseur ouvre la porte, même quand elle est fermée ; occasionnellement, il la casse. La plupart du temps, il casse chez sa victime toute velléité éventuelle de fermer la porte. « C’est dans l’intimité et dans la confidentialité qu’il faut lutter contre l’inceste, pas en faisant du battage médiatique », dit aussi la coordinatrice de SOS-inceste-pour-revivre. Le silence, la honte, le secret, qui sont des alliés précieux de l’abus sexuel intrafamilial, seraient donc à préserver dans l’intérêt de l’enfant. « La vue de ces encarts publicitaires pourrait bloquer sa capacité à communiquer », affirme enfin le vice-président de l’association Enfance et Partage. Jusqu’à la date de parution de ces encarts, les enfants victimes d’abus sexuels ne communiquaient pas davantage. Les victimes d’inceste ne disent pas l’inceste à l’extérieur de la famille, et le disent peu à l’intérieur de la famille, en tout cas pas tant qu’ils sont enfants. Leurs frères, leurs soeurs, et les éventuelles autres personnes qui cohabitent avec ne le disent pas non plus. Ni durant l’enfance, ni plus tard, quand chacun est devenu adulte. Le peu de signalement d’agresseurs incestueux, ou de confrontations, proportionnellement aux centaines de milliers d’agresseurs, en atteste. Très marginalement, certains dénoncent les abus dont ils ont, ou un proche, été victimes, quand survient le risque que les agressions sexuelles soient reconduites sur un enfant de la génération suivante, par le même agresseur ou par un autre. Pour 60 millions de Français, si on compte 6 % de victimes d’abus sexuels intrafamilial, ce qui est au plus bas de la fourchette proposée par les enquêtes quantitatives (dont la récente enquête ENVEFF), cela fait au moins trois millions six cent mille victimes ; les agresseurs se comptent donc plus probablement en millions, qu’en centaines de milliers. Or, selon les chiffres fournis par l’Observatoire d’action sociale décentralisée (ODAS), le nombre de signalements pour abus sexuels sur les enfants tourne autour de 5 500 par an, en moyenne, sur les cinq dernières années. L’addition de tous les signalements effectués depuis que l’État a installé la procédure ne dépasse donc pas 1 % du nombre de victimes d’inceste en France. Les enfants victimes d’abus sexuels dans leur famille se taisent, car le silence qui entoure cette pratique de leur vie quotidienne, éventuellement assorti de menaces, leur apprend à se taire. Les acteurs de la controverse. Mais qui parle, dans cet échange récent sur l’inceste, dans quel but, dans quel cadre, et comment sont documentés les savoirs des uns et des autres : autant de questions qui permettent d’éclairer autrement la controverse. D’un côté, un regroupement d’adultes, anciens enfants victimes d’abus sexuels intrafamiliaux ; d’un autre côté, des lecteurs, des professionnels du champ social, de la psychologie ou de la protection de l’enfance. Les premiers ont un savoir sur l’inceste fondé sur leur expérience personnelle de l’abus sexuel, et sur le partage de cette expérience. Dans le cadre d’une association et en partenariat avec une agence publicitaire, ils décident de communiquer une part de cette expérience, à leur façon, ce qui est inédit. Jusqu’à présent, les seules représentations graphiques sur l’inceste sont publiées dans le cadre d’ouvrages spécialisés, et montrent des dessins d’enfants victimes d’inceste. Les dessins, qui mettent en scène des organes génitaux disproportionnés, ou bien des animaux ou des objets à forme phallique, ne sont pas laissés à l’émotion du lecteur ; ils sont balisés par les commentaires et les interprétations des professionnels qui soignent les enfants auteurs de ces dessins. Dans la campagne publicitaire présentée par l’agence V, le photographe ne travaille pas comme interprète traducteur de l’image proposée. Il est plutôt assistant de réalisation de l’adulte, ancien enfant victime d’abus sexuels intrafamiliaux, et prête son concours à une restitution réaliste non soumise au filtre de l’interprétation élaborée. Pas de décryptage possible de l’image proposée à travers la symbolisation. La mise en scène d’objets familiers de l’environnement d’un enfant est livrée brute et morcelée, comme dans la représentation infantile : nounours, biberon, caneton, boîte à langue, et pourquoi pas pénis. On peut donc inscrire cette campagne dans un projet de représentation juste - jusqu’au dégoût qu’elle suscite pour tous les publics, victimes d’inceste en tête - et subjectif de la question de l’abus sexuel intrafamilial. De l’autre côté de la controverse, les professionnels s’expriment au titre de leurs compétences et de leur statut de professionnels, experts de la protection de l’enfance ou de l’écoute des enfants violentés. La légitimité de leurs réactions repose sur le fait que ces professionnels travaillent au contact des familles incestueuses. Mais pour autant, le savoir qui fonde leur pratique professionnelle et au nom duquel ils s’expriment dans les colonnes du Monde n’est pas construit à partir de l’écoute des familles incestueuses (manifestement). Il est construit à partir de formations universitaires, qui n’abordent quasiment pas la thématique des agressions sexuelles. La question est inexistante dans les cursus de sciences sociales, marginalement évoquée à l’École nationale de la magistrature via une mise en garde sur les fausses allégations, et reléguée au rang de fantasme oedipien en psychologie. La documentation disponible, en outre, principalement produite en Amérique du Nord dans les départements universitaires de travail social ou de psychologie sociale, consiste principalement en enquêtes quantitatives qui ne peuvent restituer la complexité des situations. Au bout du compte, ce dont témoigne le point de vue de ces professionnels sur l’inceste, c’est de l’insuffisance grave des savoirs sur la question des abus sexuels intrafamiliaux. Grave pour les victimes, d’abord, pour la société, ensuite, compte tenu de ce que coûtent à la collectivité les dépressions à répétition, les dépendances aux produits psycho-actifs, les conduites à risque variées, la désinsertion sociale et les suicides des victimes, que n’aide pas le poids tenace du silence. À travers les réactions qu’elle déclenche, et sans la dissocier de ces réactions, cette campagne n’est pas du tout contre-productive. Elle a au moins le double mérite de révéler les mythes modernes autour de l’abus sexuel intrafamilial et, partant, de fournir une base de travail à partir de laquelle peut s’enraciner la réflexion. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliographie Michel Agier, « La force du témoignage - formes, contextes et auteurs des récits de réfugiés », in Crises extrêmes, face aux massacres, aux guerres civiles et aux génocides, ouvrage sous la direction de Claude Vidal, Ed. La Découverte, 2006 Daniel Bertaux, Le récit de vie, l’enquête et ses méthodes, éd. Armand Colin, 2005 Susan Brownmiller, Le viol, Stock, 1978 Christophe Dejours, Souffrance en France, la banalisation de l’injustice sociale, Ed. Points, 2000 Robert Deliège, Anthropologie de la famille et de la parenté, Ed Armand Colin, cursus, 2005 Michelle Desaulniers, Plaisir honteux, Ed. du Remue Ménage, Québec, 1998 Georges Devereux, De l’angoisse à la méthode, éd. Aubier, 1980 Georges Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, éd. Flammarion, Champs, 1985 Dominique Dray, Victimes en souffrance, une ethnographie de l'agression à Aulnay-sous-Bois, éd. LGDJ / Montchrestien collection droit et société, 1999 Dorothée Dussy, « Construire une anthropologie de l’inceste », intervention à l’occasion du séminaire hors série du Laboratoire d’anthropologie urbaine, 18 novembre 2004 Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne, « Des mots pour le taire, de l’impensé de l’inceste à sa révélation », revue « terrain », n° 48, février 2007, thème « la morale », p 13-30 Didier Fassin et Richard Rechtman, L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, Ed. Flammarion, 2007 Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, folio essais, 2005 Franco Ferraroti, Histoire et histoires de vie, la méthode biographique dans les sciences sociales, Librairie des Méridiens, coll. Sociologies au quotidien, 1983 Michel Foucault, Surveiller et punir, Ed. Gallimard, 2004 Gilberto Freyre, Maîtres et esclaves, la formation de la société brésilienne, Ed. Gallimard, 1974 Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004 Frédérique Gruyer, Martine Nisse, Pierre Sabourin, La violence impensable, inceste et maltraitance, Ed. Nathan, 2004 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Ed. du Cerf, 2000 Maryse Jaspard, Les violences faites aux femmes, Ed. La Découverte, collection Repères, sociologie, 2005 Stéphane La Branche, Mondialisation et terrorisme identitaire (ou comment l’Occident tente de transformer le monde), Ed. L’Harmattan, logiques sociales, série sociologie de la modernité, 2003 François Laplantine, L’anthropologie, petite bibliothèque Payot, 2001 François Laplantine, Ethnopsychiatrie psychanalytique, Ed. Beauchesne, 2007. Pascale Molinier, Les enjeux psychiques du travail, Petite bibliothèque Payot, 2006 Gérard Neyrand, Patricia Rossi, Monoparentalité précaire et femme sujet, Ed. érès, coll. Pratique du champ social, 2004 Anne Poiret, L’ultime tabou : femmes pédophiles, femmes incestueuses, Ed. Patrick Robin, 2006 Marie-Pierre Porchy, Les silences de la loi, un juge face à l’inceste, Ed. Hachette Littératures, 2003 Françoise Sironi, Bourreaux et victimes, psychologie de la torture, Ed. Odile Jacob, 1999 Eva Thomas, Le sang des mots, éd. Desclée de Brouwer, coll. Psychologie, 2004 Alice Verstraeten, A corps perdus, survivre à la "disparition forcée" dans un réseau de familles : Buenos Aires, Argentine, 2004-2005, Mémoire de master recherche 2ème année, Anthropologie, université Lyon 2, sous la direction de François Laplantine, 2005 Daniel Welzer-Lang, Le viol au masculin, Ed. L’harmattan, Logiques sociales, 1988 Daniel Welzer-Lang, Les hommes violents, Ed. Lierre et Coudrier, 1991 Témoignages : Virginie Talmont, Inceste, récit, Ed J’ai lu, 2005 Eva Thomas, Le viol du silence, Ed J’ai lu, 2003 [1] Le seul ouvrage évoquant cette question est édité au Québec, et très difficile à se procurer en France car épuisé : il s’agit du livre « plaisir honteux » (cf. bibliographie), qui décrit comment le fait d’avoir ressenti du « plaisir » augmente les sentiments de culpabilité des victimes d’abus sexuels, notamment incestueux. [2] Pour la terminologie, je m’inspire de l’ouvrage La violence impensable : « Pour plus de clarté, nous utilisons une terminologie qui précise les rôles de chacun à l’intérieur de la dictature familiale. En effet, le terme incestueux, selon le Petit Robert signifie à la fois « coupable d’inceste » et « issu d’un inceste », ce qui nous apparaît comme une confusion supplémentaire dans un domaine où la confusion est la règle pathogène première. Dans les familles à transactions incestueuses, l’enfant incestueux est l’enfant né de l’inceste. Lorsqu’un enfant est victime d’inceste, nous le désignons comme enfant incesté ou abusé. » (p 105). Quant à l’auteur des abus, il sera dénommé « incesteur » ou « abuseur ». [3] Cf. annexes [4]
Je ne peux citer les travaux de ce chercheur, difficilement contournables
sur les questions de violences intrafamiliales, notamment conjugales,
sans rappeler les faits suivants. En 2005 : dénonciation
publique par l’ANEF des actes de harcèlement, moral et sexuel,
rapportés depuis plusieurs années par des étudiantes à son encontre,
étudiantes dont aucune n’a osé porter plainte étant donné notamment
le caractère … difficilement contournable de ce chercheur. Daniel
Welzer-Lang a perdu le procès en diffamation qu’il a alors initié
contre l’ANEF et l’AVFT et dont il entendait reverser les dommages
et intérêts à une … « association féministe de son choix ».
et http://leblogducorps.canalblog.com/archives/2007/06/19/index.html [5] Je ne reprends pas la notion de « viol », restrictive car elle n’inclut pas, dans la vision commune aujourd’hui en France, les attouchements et autres formes d’abus sexuels assimilables (exhibitionnisme, voyeurisme …). [6] www.arevi.org [7] Source http://www.ivry.cnrs.fr/lau/spip.php?article152 [8] Il s’agit du forum internet de l’association SOS inceste pour revivre de Nantes, mais il en existe d’autres et ce que je relate ici y serait vrai également [9] Charte du groupe de parole des victimes – cf annexes [10] hors entourage familial, dont je ne prends pas en compte les réactions. [11] Et ai pu compter alors sur mes directeurs de mémoire pour en discuter [12] Le travail d’analyse entrepris par Françoise Sironi, des méthodes utilisées dans la Grèce des Colonels pour construire les tortionnaires, me semble une piste intéressante pour interroger le « comment devient-on un incesteur ? ». Car même si certains incesteurs commencent très jeunes, cela signifie nullement que c’est inné chez eux, dans leur nature, ou autre explication se faisant passer pour scientifique et qui permet surtout de penser que les incesteurs sont des erreurs de la nature, des « monstres », et non des humains qui auraient pu évoluer autrement. C’est à dire permet surtout d’éviter de penser qu’ils sont eux aussi produits par notre société, en font pleinement partie, ne sont pas « ailleurs ». [13] Au sens précis du mot en anglais, celui de « home sweet home », formant oxymore avec les mots « violence », « démolition ». [14] Des collègues de travail plus âgé/e/s que moi m’expliquent du moins que pour eux/elles, cela avait été la norme. [15] Pour les incestés, il n’existe pas d’études équivalentes semble-t-il. [16] Entre guillemets, car il s’agit ici d’une utilisation perverse de la théorie psychologique concernée (ici l’analyse transactionnelle). Un peu comme si l’on utilisait une clef anglaise de 20 pour frapper quelqu’un, alors que l’usage normal des clefs anglaises est de servir à assembler des objets en serrant des boulons. [17] Hormis par les négationnistes concernant l’existence des camps d’extermination nazis. [18] http://www.sos-inceste-pour-revivre.org/ [19] http://www.sosinceste.org/actual/notredefinition.htm [20] Ce qui ne veut pas dire qu'un vécu que l’on identifierait, nous, rétrospectivement comme traumatique, lui, n’existait pas. [21] Le délai de prescription est le délai au-delà duquel une plainte n’est plus recevable en Justice. Sauf exceptions, en France, au pénal il est de trois ans après les faits pour les délits, dix ans pour les crimes. [22] Ainsi que les professionnels de la protection de l’enfance, tels les responsables du n°119 par exemple - cf article du journal l’humanité en annexe [23] cinq entretiens n’ayant pas vocation à montrer de manière exhaustive les procédés des incesteurs(euses). Je précise ceci car j’ai moi-même pu continuer à croire, suite à la lecture de l’ouvrage Les hommes violents (Daniel Welzer-Lang) que mon incesteur n’était pas un homme violent, puisqu’il ne l’était pas comme cela était décrit dans ce livre : notamment, il n’avait jamais de phases non violentes, dites « lune de miel », censées être caractéristiques (mais qui ne sont en réalité qu’un des procédés possibles pour maintenir son emprise). Pourtant, il était bel et bien, et est encore, un homme violent, en plus d’être coupable d’incestes. Il est vrai qu’il n’a jamais fait la moindre ecchymose à personne … Cette note vaut pour réflexion sur les limites à fixer à toute typologie ou théorisation : ce n’est pas parce que ses « cases » n’incluent pas un cas, que ce sont la typologie ou la théorisation qui ont raison. |