Licence "GNU / FDL" attribution pas de modification pas d'usage commercial Copyleft 2001 /2014 |
Moteur de recherche interne avec Google |
Par Patric Kruissel
|
Le 18 Février 2004, j'ai reçu un mail libellé ainsi : "Bonjour Votre adresse E-mail sur un site Internet me permet d'envisager que vous êtes sensibilisé par le problème du chômage et/ou de la protection de l'environnement. Je me présente ; je suis militant dans plusieurs associations qui luttent contre le chômage et pour la protection de l'environnement, mais ce n'est pas en leurs noms que j'exprime les idées ci-dessous. Ma démarche consiste à faire partager certaines idées avec le maximum de personnes (particuliers, associations, partis, syndicats...) pour les faire évoluer et présenter une solution novatrice pour que nos modes de production s’orientent progressivement vers une économie, non plus au service des puissances financières, mais au service de la satisfaction de nos besoins, une économie plus respectueuse des Droits de l’Homme, une économie plus équilibrée entre le Nord et le Sud, mais surtout une économie plus respectueuse de l'environnement. Un résumé de l'analyse a été publié à l'une des adresses suivantes : http://www.monde-solidaire.org/article.php3?id_article=987 http://www.verts-brest.infini.fr/Brest-ouVert/IMG/analyse_chomage_resume.rtf et le texte complet se trouve à l'une des adresses suivantes : http://www.monde-solidaire.org/IMG/pdf/analyse_chomage.pdf http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/ses/vie-ses/hodebas/kruissel.html ..../ .... Patric Kruissel " J'ai choisi de publier ce document parce qu'il analyse de façon rationnelle et classique le chômage. Le résultat est, de ce point de vue, pertinent. Ma démarche est un peu différente, parce que je pense que le chômage ne peut pas être séparé du fonctionnement du capitalisme contemporain et de la lutte de classe que les capitalistes mènent par toutes sortes de moyens pour gagner toujours plus d'argent, pour maintenir et accroître leur domination. De mon point de vue, le débat porte donc sur la possibilité d'une économie non capitaliste et des moyens pour y arriver. Ph. C. Nantes le 18 Février 2004 Voici donc le texte in extenso Imaginer une autre société Par Patric Kruissel Le désastre du chômage massif, avec la multiplication des emplois précaires, l'aggravation des inégalités, l'instabilité croissante des familles, menace la cohésion même de la société. Il remet en cause les systèmes de protection sociale construits en fonction du plein emploi, du travail à plein temps et de la famille stable.1 Définition du chômage 1.Le chômage au sens du BIT Etre sans travail, être disponible pour travailler, et avoir fait des démarches en vue de trouver un emploi. 2.Le chômage frictionnel Le chômage frictionnel est dû aux demandeurs d' emploi, qui pendant une courte période, sont sans travail après avoir quitté leur ancien emploi. Le chômage frictionnel est inférieur à 2 % de la population active. Pour cette raison, on considère qu' un taux de chômage inférieur à 2 % correspond à une économie de plein emploi. 3.Le chômage conjoncturel Le chômage conjoncturel résulte d' un ralentissement économique temporaire. Il résulte d'oscillations temporaires de l'activité économique. 4.Le chômage saisonnier L' activité économique est cadencée par l' offre et la demande de consommation, qui varie sensiblement suivant la période de l' année. De même le marché du travail est rythmé par l' arrivée entre juillet et septembre d' une classe d' âge. Pour ces raisons, les statistiques du chômage sont données en valeurs corrigées des variations saisonnières. 5.Le chômage structurel Le chômage structurel désigne la situation dans laquelle les travailleurs ne peuvent occuper les postes disponibles parce qu' ils n' ont pas les compétences voulues, n' habitent pas là où les postes sont offerts ou ne sont pas prêts à travailler au salaire offert sur le marché. Conséquences du chômage. 1.Perte de revenus L' une des conséquences importantes du chômage sur l' individu, surtout lorsque celui-ci se prolonge dans le temps, est l' exclusion financière liée à la perte de revenu (perte du 13ème mois, restaurant d' entreprise, avantages en nature). La perte moyenne du revenu d' un ménage touché par le chômage représente 25 %. En prenant comme seuil de pauvreté la demi-médiane2 du revenu par unité de consommation, la pauvreté touche 12 % de la population française. Outre l' inégalité économique qui est la principale source de discrimination, le chômage génère une incontestable inégalité sociale et culturelle. 2.Exclusions L' exclusion est sans conteste l' un des termes le plus couramment utilisés pour stigmatiser les dysfonctionnements d' une société qui serait devenue une fabrique à exclus3. La difficulté à définir l' exclusion comme la pauvreté et la précarité tient à son caractère multidimensionnel. Elle peut être sociale, politique, économique ou tout à la fois. On est exclu du logement, de l' accès à l' emploi par exemple. L' exclusion introduit de surcroît l' idée d' une rupture dans un continuum protégé par des droits ou, du moins, des garanties sociales minimales. De plus, elle a une dimension dynamique par le cumul de plusieurs exclusions (travail, revenu, logement, santé...) et par l' impossibilité ou l' incapacité pendant une période plus ou moins longue de « bénéficier, des droits attachés à la situation sociale et à l' histoire de l' individu concerné »4. 3.Endettement Alors que l' on refuse l' accession au logement pour les travailleurs précaires, et les chômeurs (on ne prête qu' aux riches !), les ménages concernés sont souvent sollicités par des prêts à la consommation, avec des taux de remboursement beaucoup plus élevés. Ces prêts génèrent des profits conséquents pour les organismes financiers, qui sont pour l' occasion moins regardants quant à la capacité des clients à honorer leur dette. Certaines personnes au chômage ont les pires difficultés à refréner une frénésie d' achats qui peut être analysée comme un signe d' existence palliatif. Les commissions de surendettement font d' ailleurs du chômage l' une des causes principales du non-remboursement des emprunts contractés par les ménages. L' interruption de remboursement rend exigible la totalité des sommes empruntées et entraîne, dans ses conséquences ultimes, le déclenchement des procédures de recouvrement : rappel, intervention des huissiers de justice, saisies diverses5. 4.Perte de statut social Selon l'organisme Option 45, "Il s'agit notamment de perte de statut social, de remise en question, de baisse d'estime de soi, de dévalorisation, de problèmes de santé physiques et mentaux ">6<. 5.Sentiment d' inutilité Robert Holcman7 écrit « le soupçon de paresse ou d' incompétence lié à l' absence d' activité professionnelle n' a pas encore totalement disparu, en dépit de la généralisation et de la massification du chômage. Qu' il s' agisse d' une fin de contrat ou d' un licenciement (collectif, économique ou individuel), la suspicion pèse encore sur les personnes licenciées ; il leur est souvent attribué une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, puisque certains de leurs collègues n' ont pas subi le même sort ». 6.Perte de logement L' acquisition du logement est exclue pour les chômeurs, à cause d' un revenu trop faible et du manque de stabilité dans le temps de ce revenu. Pour ceux qui ont eu la chance d' obtenir un prêt au moment d' un emploi stable, une période de chômage est souvent fatale à la régularité des remboursements. La revente du logement, dans des conditions financières désastreuses, fait que l' effort financier fait par le ménage pendant de longues années est souvent réduit à néant par cette situation économique imprévue. 7.Conséquences sur l' éducation des enfants La perte de revenu, liée au chômage, a nécessairement des répercussions sur l' éducation des enfants, dans plusieurs domaines, à savoir l' alimentation, l' habillement, le confort et l' espace habitable, la prévoyance de la santé, le soutien scolaire, l' offre de loisirs, le sport, la culture, les vacances… 8.Perte de lien social L' exclusion du marché du travail s' accompagne très souvent d' une tendance au retrait ou à l' isolement vis-à-vis de la famille, mais aussi des amis et des voisins. Sachant que la situation financière n' est pas assurée, les personnes au chômage refusent les invitations et les sorties proposées, parce qu' ils ne peuvent garantir la réciprocité. Alors que la population concernée bénéficie d' un espace temps qui fait souvent défaut aux personnes qui travaillent, on s' aperçoit que le chômeur ne profite pas de ce loisir pour tisser des liens sociaux et se renferme, au contraire, dans un isolement relationnel. 9.Perte du lien familial Ne pas avoir d' activité rémunérée est un frein à la constitution d' une famille. Les plus jeunes, confrontés à la difficulté à trouver un premier emploi, restent plus longtemps au domicile familial et prolongent, pour une part de plus en plus importante, leur scolarité. Leur entrée dans un cycle de vie autonome est alors retardée. Entre 1975 et 1995, le taux de scolarité des 20-24 ans a été multiplié par 3, ce qui faire dire aux auteurs du rapport Guaino8, que l' allongement de la durée des études est dicté de plus en plus par la crainte d' aborder le marché du travail, que le choix de la formation correspond moins à un projet professionnel précis et aux besoins de l' économie. Même s'il vaut toujours mieux être diplômés que ne pas l' être, le diplôme est de moins en moins une garantie d' accès à l' emploi. Les conséquences du chômage se font aussi sentir lorsque le couple est déjà constitué. La persistance de l' inactivité et même l' instabilité de l' emploi rendent le couple plus fragile. Les chômeurs sont deux fois plus nombreux à vivre dans une famille monoparentale. Le nombre de personnes en instabilité conjugale augmente de 64 % si l' un des conjoints est au chômage9. Un chômeur a 2,3 fois plus de chances de divorcer qu' une personne n' ayant jamais connu le chômage10. 10.Maladies Les maux dont souffrent les chômeurs le plus fréquemment sont différents de ceux des actifs. Alors que les personnes occupées déclarent souvent souffrir d'arthrose, de rhumatismes ou de fatigue intense liés à l' emploi qu' ils occupent, les chômeurs se plaignent d' asthme mais surtout de dépressions et de symptômes de mal-être (nervosité, anxiété, angoisse, céphalées, insomnies, vertiges...). Ainsi, lors d' une interrogation liée à l' étude des conditions de vie réalisée par l' INSEE en 1987, 72% des individus déclaraient avoir connu des moments dépressifs d' au moins deux semaines alors qu' ils étaient au chômage, les rendant inquiets, pour 38% d' entre eux, sur leurs aptitudes à occuper un travail. 11.Suicides Louis Chauvel 11, observe un lien entre suicide et chômage et plus précisément entre suicide et crise économique. A l'image des liens entre le taux de chômage des 15-24 ans et le taux de suicide de l'ensemble de la population masculine, d'autres éléments semblent indiquer que le chômage est l'un des facteurs saillants associés aux suicides ou aux tentatives de suicide. Ainsi, en France, les hommes inactifs de 45 à 50 ans sont structurellement des victimes privilégiées du suicide. De même, les catégories socioprofessionnelles où le risque de chômage est le plus fort sont aussi celles où le taux de suicide est le plus élevé.12 Si l' on prend comme référence le taux de mortalité moyen de la population, une étude13 entreprise sur quatre pays (Grande-Bretagne, Italie, Danemark et Finlande) montre que le taux de mortalité des chômeurs augmente de 75 %. La même étude précise que les risques de décès des chômeurs par maladies cardio-vasculaires et rénales augmentent de 50 % et les risques de décès par suicide doublent. 12.Délinquances Une idée répandue, selon laquelle la conjoncture socio-économique a un impact sur le taux de criminalité, est couramment admise dans l'opinion publique. De nombreuses études ont montré la corrélation entre chômage et délinquance. La difficulté intervient lorsque l' on tente de chiffrer la part de délinquance qui a pour cause première le chômage. Quoi qu' il en soit, ce lien chômage délinquance est une donnée que les pouvoirs publics ne peuvent ignorer. Le cas de Mantes-Les Mureaux met particulièrement en évidence le rapport entre le chômage et la délinquance : les adolescents ont vu l'exemple de leurs grands frères au chômage, qui les décourage à faire le moindre effort, notamment sur le plan scolaire. La figure du père souffre, elle aussi, d'une dévalorisation : le père est souvent âgé, abîmé par la vie et ses années de travail. Ces éléments de l'environnement familial et social expliquent le grand absentéisme scolaire, caractéristique fréquente chez les mineurs mis en cause dans les actes de délinquance.14 La difficulté de trouver un emploi est incontestable. Elle s' aggrave s' il s' agit d' un premier emploi ou d' un candidat sans diplôme. Si, face à ces achoppements, des moyens illégaux d' argent facile se présentent, notamment le trafic de drogue, qui rapporte en une journée l' équivalent de ce que peut gagner en un mois un salarié, ne nous étonnons pas que certains basculent dans la délinquance. 13."Plus de chômage, plus d'emprisonnement ?" Au départ de l'étude de Bernard Laffargue et Thierry Godefroy, un constat : les prisons sont principalement peuplées par des personnes pauvres. « La plupart des personnes arrêtées et condamnées à l'emprisonnement pour des infractions "traditionnelles" (vols, violences, et maintenant stupéfiants) sont issues des milieux touchés par la pauvreté et le chômage. Les détenus se distinguent nettement de l'ensemble de la population par leur situation socio-économique et leur place sur le marché du travail (chômeur ou sans profession définie) » Les deux chercheurs, analysant la corrélation entre le nombre des détenus et le nombre de crimes commis, ont introduit une nouvelle donnée : le taux de chômage. "La relation chômage - incarcération est vérifiée indépendamment des niveaux de criminalité enregistrée"15, expliquent-ils. Michel Lagrave16 cite une étude britannique selon laquelle un million de chômeurs supplémentaires sur 5 ans entraînent 50 000 morts supplémentaires, 60 000 cas de maladies mentales, 14 000 condamnations pénales. D' après l' étude de Brenner17, qui porte sur la période 1950 à 1980 aux Etats-Unis (à l' époque le taux de chômage était beaucoup moins critique qu' actuellement), une hausse de 10 % du taux de chômage entraine :
14.Drogues Le lien entre le chômage et une consommation plus élevée de drogue, et le renforcement de ce lien entre 1996 et 2000, constaté dans les sondages Eurobaromètre, se vérifient dans le rapport annuel de l' OEDT18 pour l' année 2000. Cela met en évidence le fait que les personnes socialement défavorisées constituent l' un des groupes à haut risque pour la toxicomanie. De même, l' OEDT indique que le chômage est l' un des facteurs qui font obstacle à la réadaptation des usagers de drogues.19 15.Stress dans les entreprises Si le chômage génère indéniablement du stress parmi les victimes du fléau, il en est de même à l' intérieur des entreprises. L' insécurité de l' emploi crée de graves conflits dans les entreprises soumises à la concurrence internationale et aux risques de délocalisation. Les employeurs eux-mêmes se servent du chômage pour augmenter la pression sur les salariés (refus de hausses de salaire, accélération des cadences…). L' Union Européenne estime travail à 20 milliards d' euros par an, les coûts engendrés par le stress lié au à l' intérieur de l' Union. L' OIT20 signale que le coût des problèmes de santé mentale liés au travail, dont le stress, représente 3 % du PIB de l' Union. On estime que le coût des maladies et de l'absentéisme dus au stress équivaut désormais à 10 % du PIB du Royaume-Uni, pourcentage qui, dans les pays nordiques, varierait entre 2,5 % au Danemark et 10 % en Norvège. Aux Etats-Unis, plus la moitié des 550 millions de journées de travail perdues chaque année pour cause d'absentéisme dans le secteur privé seraient de près ou de loin liées au stress21. Une note interne de Jacques Barrot affirme : « Dans une économie marchande telle que la nôtre, la conjonction de création d' emplois et de baisse du chômage… a pour conséquence une hausse du prix du travail…. Une telle réduction du chômage se traduirait alors vite, du fait d' une hausse du prix du travail, sauf à envisager un blocage des salaires, par des pertes de compétitivité insoutenables. » On peut appeler çà du cynisme. Le résultat de cette politique est que la part des salaires dans le PIB a été réduite de 10 points en 20 ans, et après on viendra s' étonner que la Sécurité Sociale ou les ASSEDIC soient en déficit, que les caisses de retraite ne vont pas faire face à l' augmentation de l' espérance de vie… 10 points de PIB çà représentent 150 milliards d' Euros par an, et un manque à gagner pour les caisses publiques suffisant pour combler tous les déficits. 16.Votes extrémistes 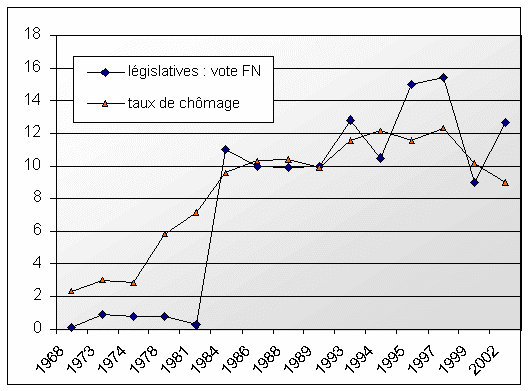 Un petit schéma vaut mieux qu' un long discours : Coûts sociaux du chômage. Aux coûts économiques du chômage que l' on peut évaluer avec plus ou moins de précision, il faut rajouter les externalités (ou effets externes) non prises en compte par la société. 1.Les coûts économiques du chômage Les coûts économiques officiels sont le résultat de la somme des pertes économiques (ASSEDIC, pertes de cotisations pour la Sécurité Sociale et les caisses de retraite, baisse des rentrées fiscales pour l' Etat et les collectivités locales…). La facture annuelle se monte à 70 milliards d' Euros auxquels, il faudrait ajouter, si on veut être honnête une grande partie du coût des minima sociaux, qui s' élèvent en France à 15 milliards d' Euros et du coût des allégements de charges patronales (également 15 milliards d' Euros). Car le chômage est effectivement la cause principale de la situation économique des bénéficiaires du RMI, et le gouvernement a effectivement mis en place les réductions de charges pour permettre aux entreprises de baisser le coût du travail salarié. A en croire le MEDEF, ces baisses de cotisations auraient dû créer massivement des emplois. Au total on peut évaluer les coûts économiques du chômage à 6 % du PIB. Une étude canadienne22 donne une fourchette large, pour les seuls coûts économiques, comprise entre 5 et 12 % du PIB (le chômage s' élevait à l' époque à 10,4 % de la population active). 2.Les coûts externes du chômage A ces coûts économiques, il faut rajouter le montant des effets externes cités ci-dessus, dont pour chacun il faudrait connaitre la part spécifique provoquée par le chômage. L' estimation est beaucoup plus difficile et de ce fait plus sujette à critique. Jacques Nikonoff évalue le coût global du chômage à 13,4 % du PIB23. Qu' on puisse contester ce montant, c' est dans l' ordre des choses, mais il est évident que les pouvoirs publics n' ont pas engagé d' études sérieuses pour confirmer ou infirmer ce chiffre, ou serait-ce qu' effectivement les chiffres font peur ? Ce que l' on peut dire avec certitude, c' est qu' une économie de plein emploi permettrait à la société de faire des économies non négligeables dans un certain nombre de domaines :
Causes du chômage 1.Définition de la productivité La productivité c' est la quantité de production fabriquée par unité de temps Consommation D' où la formule : Productivité = ou C = P x T Temps de travail La consommation est la consommation au sens large du terme, c' est-à-dire le PIB24. Elle englobe la consommation des ménages (70 % du PIB), la consommation de l' Etat (armée, police, services rendus à la population…) et la consommation des entreprises (Investissement et rétribution des actionnaires). De 1946 à nos jours :
La baisse du temps de travail de 10 % est en fait la résultante de 2 paramètres : 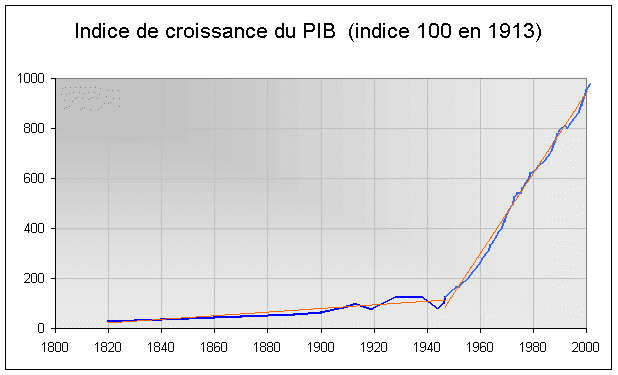
La population active a augmenté de 26 % la durée annuelle 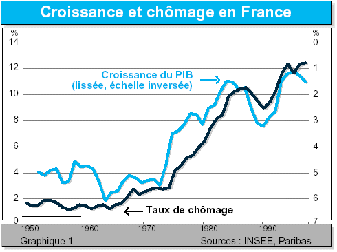
L' immigration a également joué un rôle important dans l' augmentation de la population active. Suivant la formule de la productivité citée ci-dessus (C = P x T), si le taux de croissance est inférieur à l' augmentation de productivité, le temps de travail doit diminuer. De 1946 à 1975, la moyenne annuelle de la productivité horaire a été très forte (5,5 %) et la croissance a permis de limiter la montée du chômage. Depuis 1975, la productivité est plus réduite (2,6 % en moyenne) et la croissance n' a atteint ce niveau que durant le tiers des 25 dernières années, ce qui a eu un effet négatif sur le niveau de création d' emplois et développé le chômage. Sur la courbe ci-dessus, nous remarquons une nette corrélation entre chômage et croissance. Il y a trois solutions à ce problème :
2.Ne plus générer de gains de productivité Si la productivité n' augmentait pas, nous n' aurions, à consommation stable, aucun besoin de réduire le temps de travail, le chômage n' augmenterait pas. Remplacer le tracteur par la bêche, remplacer l' ordinateur par la gomme et le crayon, remplacer les moyens de transport moderne par le cheval ; l' ensemble de ces moyens permettrait de réduire considérablement les gains de productivité et de donner du travail à tout le monde. On se rend bien compte que c' est absurde. « On n' arrête pas le progrès ». On va donc considérer que le facteur productivité est un paramètre intangible, dont la progression annuelle est de 2,5 %. Ce qui signifie, que chaque année, on a le choix entre :
La situation intermédiaire de partage des gains de productivité entre croissance et réduction du temps de travail est bien sûr possible. Les chiffres cités ci-dessus montrent clairement que notre société a privilégié le premier (augmentation de la croissance par habitant de 550 %) au détriment du second (réduction du temps de travail global de 10 %). Quels sont les conséquences de ce choix ? Favoriser la croissance : les conséquences 1.Sommes-nous dans un développement durable ? Depuis 1946, nous avons connu un taux annuel de croissance moyen de 4,5 %, ce qui est sans précédent dans l' histoire de l' humanité. Les experts économiques prétendent que pour éviter une augmentation du chômage, un taux de croissance minimum de 3 % est nécessaire. Si ce taux était maintenu, notre consommation serait multipliée par 19 durant un siècle, multipliée par 370 durant 2 siècles et multipliée par 7100 durant 3 siècles. Inutile d' aller plus loin, l' absurdité de ces chiffres nous fait comprendre que, non seulement notre développement n' est pas durable, mais que notre modèle actuel n' est même pas exportable à l' ensemble des pays de la planète. 2.Effet de serre Sur le réchauffement climatique, les scientifiques sont assez consensuels. Pendant le siècle prochain, la température du globe s' élèvera de 1 à 6 degrés. Si l' on est certain que ce réchauffement aura lieu, il n' est pas encore prouvé avec certitude que notre rejet de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 soit seul responsable de ce réchauffement. L' activité solaire pourrait participer à ce réchauffement. Dans le doute, il serait prudent que la communauté internationale applique le principe de précaution, comme l' a suggéré le protocole de Kyoto. Si chaque habitant de la planète avait notre niveau de vie, nous rejetterions dans l' atmosphère, une quantité de gaz à effet de serre 4 fois supérieure (10 fois pour les USA), à ce que la nature est capable d' absorber. Ne va-t-on pas dans le mur en continuant sur cette lancée ? Il est impossible de quantifier les pertes de vie, les souffrances et les dommages à l' environnement attribuables aux catastrophes naturelles. L' industrie des assurances a calculé que les phénomènes météorologiques avaient causé pour 90 milliards de dollars US de dommages matériels en 1998, soit une augmentation de 50 % par rapport à 1996. Si des mesures sérieuses ne sont pas prises pour inciter nos concitoyens à consommer moins d' énergies non renouvelables, notamment en utilisant des moyens de transport plus respectueux de l' environnement, suites aux catastrophes naturelles (canicule et désertification dans certaines régions, pluies diluviennes et inondations dans d' autres) les injonctions prises risquent d' être fortement liberticides. Cet « écolo-fascisme », que les autorités imposeront pour tenter de sauver les dernières espèces vivantes, nous fera regretter notre imparfaite démocratie. 3.Consommations d' énergie et de matières premières non renouvelables L' exemple des réserves mondiales de pétrole nous démontre clairement que les ressources naturelles de notre planète ne sont pas infinies. Au rythme où nous consommons, pour ne pas dire gaspillons, les carburants fossilisés, les experts ont calculé qu' il ne reste environ qu' entre 50 à 100 ans de réserves pétrolifères. En 200 ans, nous aurons consommé ce que la nature a fabriqué en plusieurs millions d' années. Au nom de quel droit, les compagnies pétrolières extraient, transforment et vendent toute cette énergie en si peu de temps ? Comment expliquerons-nous à nos descendants une telle exploitation abusive des ressources énergétiques ? 4.Développement des pays du Tiers-Monde Le malheur est que pour deux hommes sur trois dans le monde, on est loin de l' euphorie pour tous. Le BNB (Bonheur National Brut) passe pour l' instant encore par le PNB. Pléthore de biens n' est pas le lot de tous et l' excès pour les uns ne fait qu' apparaitre plus clairement, avec le dénouement des autres, les injustices et l' exploitation des pauvres par les riches. Comment concevoir l' arrêt de toute dynamique quand subsistent tant d' inégalités aussi bien entre catégories sociales à l' intérieur des pays intéressés qu' entre pays nantis et pays pauvres ? Paradoxe ? Scandale ? Courte vue ?25 Un rapport26 affirme que les 225 plus grosses fortunes du monde représentent l' équivalent du revenu annuel des 47 % d' individus les plus pauvres de la planète, soit 2,5 milliards de personnes. Dans le même rapport, les auteurs indiquent qu' il suffirait de prélever 4 % de cette richesse, soit 40 milliards de dollars, pour donner à toute la population du globe l' accès aux besoins de base (nourriture, eau potable, éducation, santé). Cette somme de 40 milliards de dollars permettrait de sortir le monde de la misère. Elle correspond à 0,17 % de la richesse des pays de l' OCDE. A chaque fois que nous dépensons 100 Euros, il suffirait de consacrer 17 centimes pour que chaque habitant de la planète ne risque plus de mourir de faim, pour qu' il puisse avoir accès à l' eau potable, qu' il puisse apprendre à lire et à écrire, qu' il puisse enfin accéder aux soins de base indispensables. Personne ne pourra nous faire croire que cet objectif est inaccessible. A titre de comparaison, voici quelques montants (en milliards de dollars) :
La misère n' est pas une fatalité, mais l' égalité est loin d' être en marche. En 1960, les 20 % de la population mondiale vivant dans les pays les plus riches avaient un revenu 30 fois supérieur à celui des 20 % les plus pauvres, en 1995 leur revenu était 82 fois supérieur.26. Quand on parle de pays en voie de développement, on peut raisonnablement se demander si vraiment c' est la bonne voie. Tant que de telles inégalités entre pays riches et pays pauvres subsisteront, tant que les droits de l' Homme ne seront pas instaurés de façon homogène au niveau de la planète, nous ne pourrons juguler l' immigration clandestine. Nous ne pourrons jamais modérer l' exode d' êtres misérables s' arrachant de leur terre natale pour venir glaner quelques miettes de notre festin. Le sujet devient d' autant plus crucial qu' au problème d' écart de richesse s' ajoute la pression démographique. Notre niveau sanitaire et éducatif a permis une relative stabilisation de notre population, ce qui est loin d' être le cas dans les pays en voie de développement. Tant que seront maintenus les exorbitants écarts de salaire entre pays riches et pays pauvres, les entreprises continueront à transporter les matières premières vers les pays à faible coût de main-d' œuvre et les produits finis vers les pays dans lesquels la population est solvable. Les gains financiers de telles opérations permettent largement de rentabiliser les coûts de transport. Les coûts sociaux induits, tels que la consommation d' énergie, le bruit, la congestion des infrastructures de transport, la pollution atmosphérique… restent à la charge de la collectivité mondiale. 5.Croissance et progrès sont-ils liés ? Imaginons un retour un siècle en arrière, on rencontre nos aïeuls et on leur fait la prophétie suivante. Dans un siècle, la production agricole, industrielle et commerciale aura été multipliée par 15. Passé le premier moment d' incrédulité, ils imagineront que la société issue de cette performance économique sera paradisiaque. Mais ceux qui utilisent le PIB comme indice de bonheur collectif, oublient de spécifier que dans le calcul du PIB, on ne déduit pas les évènements qui ont une incidence néfaste sur la population. Au contraire on les ajoute, ce qui peut donner naissance à des situations, pour le moins, paradoxales :
Le travail domestique fourni en grande partie par les femmes, qu' elles soient actives ou femmes au foyer est évalué par les économistes à environ 35 milliards d' heures en France, ce qui est du même ordre de grandeur que le travail salarié. Jean-Hugues Déchaux chiffre entre 31 % et 44 % du PNB l' ensemble de la production domestique des ménages27.
Nous savons que les coûts sociaux engendrés par la circulation automobile (accidents de la route, congestion de la voirie, pollutions atmosphérique et sonore, rejet de gaz à effet de serre…) sont exorbitants. Malgré les taxes importantes payées par l' automobiliste, notamment la TIPP28, celles-ci sont loin de couvrir les coûts sociaux laissés à la charge de la collectivité. Toute mesure incitant à un transfert de la voiture vers les transports en commun (mesure tarifaire, amélioration du confort, fréquence des dessertes…) aurait un effet profitable pour la collectivité. Pourquoi de telles mesures ne sont-elles pas prises ? Là encore, le problème du chômage resurgit, car toutes nuisances causées par une activité permettent à une quantité de personnes d' avoir un emploi. Le médecin devra soigner les accidentés de la route et ceux qui souffrent de la pollution atmosphérique. L' industrie pharmaceutique fournira les médicaments nécessaires. Les garagistes répareront les voitures accidentées. Les assurances règlent les frais… Imaginons un instant qu' on supprime les causes des conflits armés dans le monde. On pourrait penser que ce serait un progrès considérable pour l' humanité, mais dans notre système économique, ce serait une véritable catastrophe. Le nombre de salariés dont l' activité professionnelle dépend de près ou de loin à cette industrie se chiffre par dizaines de millions. Les limites du PIB, en tant qu' indicateur sont largement connues. Il a pour le moins un avantage : on sait ce que l' on mesure (un flux de production, un flux de dépenses). Les difficultés commencent cependant dès que l' on s' interroge sur la liaison entre ces agrégats et un indicateur de satisfaction, de bien-être, voire de bonheur, notion par nature subjective. « Le bien-être national est avant tout un problème d'agrégation d'échelles de préférences individuelles. Cette agrégation se révélant impossible à faire, la notion de bien-être n'est donc fondée sur aucune base rationnelle29 ». Si la « main invisible » d' Adam Smith semble efficace sur le plan de la croissance économique, il n' en va pas nécessairement de même pour le progrès au sens large. Apparemment, la main du marché profite à l' économie mais pas à l' écologie, aux actionnaires mais pas aux salariés. Elle profite à la création de richesse, mais beaucoup moins à sa distribution, à l' innovation technologique mais avec des conséquences contestables du point de vue de l' éthique.30 Si on veut mettre en place un indicateur de progrès, il faut alors classer en positif tout ce qui est censé améliorer le bien-être, et en négatif, ce qui le minore (nuisances et pollutions diverses) c' est-à-dire tout ce que l' on pourrait nommer des « dépenses regrettables ». La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide ont réduit l'utilité d'une bonne partie de l'arsenal nucléaire que chacun est heureux de déclasser. Le bonheur mondial pourrait s'en trouver accru si la dispersion de cet arsenal n'était pas aussi dangereuse que son importance absolue. Pierre Kende avait déjà posé la question en 1977 « Peut-on mesurer le bonheur national ? ». Depuis nous avons fait quelques progrès, cependant marginaux, dans la réflexion. En 1990, la Banque Mondiale calculait un Indice de Développement Humain (IDH), en intégrant en plus du niveau de consommation, le niveau d' instruction, l' état sanitaire de la population, le degré de protection de l' environnement. Pierre le Roy s' exprime ainsi : « A quoi sert-il d' avoir un PIB par tête très important, si vous vivez dans un pays où la démocratie n' existe pas ? A quoi sert-il de vivre dans un pays riche, si l' air que vous respirez est complètement pollué et si la majorité des habitants des autres pays vivent dans le dénuement le plus complet ? »31. La liste des indicateurs retenus par Pierre le Roy pour calculer l'indice du bonheur mondial est impressionnante. Pour autant, on observe qu'elle est, à de nombreux égards, moins complète que celle que publie l'OCDE. L'emploi est le grand absent de cette enquête. La probabilité d'obtenir un emploi, éventuellement mesurée par le taux de chômage, la qualité de cet emploi, les relations sociales engagées dans le travail sont des facteurs essentiels de bien-être. A contrario, la durée du travail et des temps de transport qui lui sont liés, les nuisances et les difficultés du travail lui-même viennent pondérer négativement ce qui occupe, dans tous les pays, une part importante des budgets-temps. Or, le développement, c'est manifestement que de plus en plus d'hommes puissent accéder à un travail et que cesse le chômage déguisé qui ne permet pas de mener une vie digne. 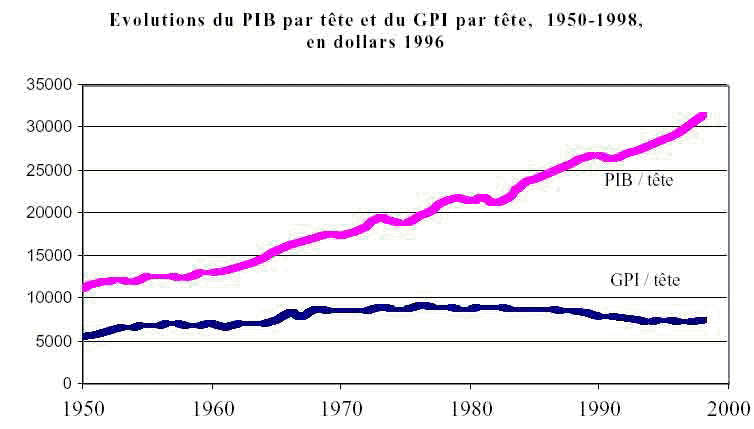 Le graphe ci-dessus donne l' évolution de la croissance du GPI (Genuine Progress Indicator) ou Indicateur de progrès véritable, aux Etats-Unis depuis 1950. Dès 1995, plus de 400 économistes américains ont publiquement reconnu cet indicateur comme une alternative importante au tout-puissant PIB. Si les critères déterminant le GPI sont représentatifs du niveau de progrès de la collectivité, on en déduit que le maximum de bien-être a été atteint au milieu des années 70, et que depuis, l' augmentation du niveau de consommation des américains a globalement fait chuter l' indicateur de progrès. Depuis 1975, nous aurions dû transformer les gains de productivité, non pas en croissance puisque celle-ci nous fait régresser, mais en temps libre. Notre niveau technologique, conjugué avec le niveau de consommation des années 70, nous permettrait de travailler 2 fois moins, ce qui aurait un effet positif sur le GPI (augmentation du temps de loisir et du temps consacré au bénévolat). Pour l' exemple, le tableau ci-dessous donne le calcul du GPI pour 1998 (en bleu, ce qui est compté positivement, en rouge ce qui est compté négativement). Entre le chiffre du départ (5 153 milliards $) qui représente le niveau de consommation et le niveau de l' indicateur de bien-être (1 770 milliards $), nous avons perdu les 2/3 de la somme. Est-ce des « dommages collatéraux » ? Un groupe de réflexion californien a tenté d' établir un véritable « Indice de Progrès Réel » IPR, en ajoutant aux mesures traditionnelles PNB/PIB des paramètres tels que l' activité économique non déclarée, le travail domestique, la destruction de l' environnement, le coût social du chômage, l' incidence de la consommation de drogue sur les budgets de la santé… Les résultats montrent que l' IPR et le PIB ont augmenté en parallèle dans les années 50 et 60, puis l' IPR a diminué pendant les années 70 et 80, alors que le PIB continuait sa croissance. La conclusion est que la croissance économique est un préalable au progrès, mais arrivée à un certain niveau, elle a des rendements décroissants en terme de bien-être. En matière d' environnement notamment, le marché ne garantit pas un développement durable. D'où les jugements désormais bien connus où la performance d'un pays dans un domaine particulier est souvent contrebalancée par une contre-performance dans un autre domaine. Les exemples sont nombreux. Le faible taux de chômage américain est souvent mis en balance avec les horaires atypiques ou l'existence de « working poors ». La performance japonaise jusqu'au début des années quatre-vingt-dix était pondérée par la longueur des temps de transport, l'exiguïté des logements ou encore l'importance des suicides. Il y a deux raisons principales pour que la croissance ne soit pas la solution au problème du chômage :
Il reste donc à étudier la dernière solution. La réduction du temps de travail Il y a deux façons de réduire le temps de travail, ou bien diminuer le nombre de travailleurs ou bien pour chacun d' eux, diminuer la quantité d' heures travaillées. A chacune de ces 2 solutions, correspondent de nombreuses adaptations possibles. 1.Baisse de la population active
La volonté du gouvernement de résoudre le problème des retraites, par la modification d' une seule donnée : l' allongement de la durée de cotisation, sans modifier les autres paramètres économiques (taux de cotisation, mode de financement…) aura des conséquences désastreuses sur le taux de chômage. Si les entreprises se décident à considérer les sexagénaires comme une source d' expérience, et non plus comme une charge salariale, des personnes de 60 ans et plus vont continuer à travailler, freinant du même coup l' entrée des jeunes sur le marché du travail. L' âge moyen de cessation d' activité en France est inférieur à 60 ans.
La baisse du nombre de salariés ne semble pas être la solution au problème. Analysons la dernière solution. 2.Baisse de la durée annuelle du travail des actifs
Par rapport à la loi des 39 heures de 1982, les 35 heures représentent une réduction de 10 % du temps de travail, soit un taux équivalent au taux de chômage. On aurait pu augurer d' un effet favorable sur les créations d' emplois et le chômage. En fait, il faut savoir que toute réduction du temps de travail s' accompagne de gains de productivité non négligeables, pour plusieurs raisons :
Le Conseil Economique et Social32 reprend les chiffres des gains de productivité liés à une baisse du temps de travail, chiffres (cités par une étude américaine) :
A partir des données de créations d' emplois suite au passage aux 39 heures en 1982 (RTT de 2,5 %), on peut extrapoler les chiffres ci-dessous en indiquant :
En fait plus la réduction du temps de travail est faible, plus elle génère de gains de productivité, et donc moins elle ne laisse de place pour des créations d' emplois. Le cabinet de Martine Aubry avait estimé que la création d' emplois résultant du passage aux 35 heures se limiterait à 1 million, soit 4 % de la population active, chiffre qui correspond à l' extrapolation faite ci-dessus. En réalité la DARES33 a chiffré le nombre d' emplois créés par les 35 heures à 370 000, nombre auquel on peut rajouter environ 100 000 emplois qui ont été préservés, c' est-à-dire que la réduction du temps de travail a évité ou atténué certains plans sociaux. Pourquoi cet écart entre le million prévu par le ministère et les 470 000 créés ou sauvegardés effectivement, il y a deux raisons :
Quel a été l' impact sur le chômage de cette création de 370 000 emplois ? Le coefficient d'Okun permet de répondre à la question. En 1962, aux Etats-Unis, Arthur M. Okun avait établi qu'une diminution du taux de chômage de 1 point de pourcentage engendrait une augmentation de la production totale de 3%. Trois facteurs étaient présentés pour expliquer ce rapport de 1 pour 3. Deux de ces facteurs sont liés au comportement des entreprises. En effet, en période de croissance économique, les entreprises augmentent les heures de travail et la productivité avant d'embaucher, ce qui génère une production supplémentaire. L'autre facteur est relatif au comportement de la main-d' œuvre. On considère, qu'en période de récession, des chômeurs sont cachés ou découragés et que, par conséquent, les taux de chômage sous-estiment le nombre réel de chômeurs. Dans un contexte de croissance, ces personnes, en retournant sur le marché du travail, réintègrent les statistiques. Elles, qu'on ne soupçonnait pas vouloir travailler, se trouvent des emplois quand la situation économique est meilleure et permettent ainsi un niveau de production supérieur, sans pour autant réduire le taux de chômage. Selon des études plus récentes, le coefficient d'Okun se situerait aujourd'hui autour de 2. Donc la création de 370 000 emplois permet de générer une baisse de 185 000 chômeurs. Il reste encore 2 millions et demi de chômeurs. En 1997, le rapport Guaino, ancien commissaire au plan chiffrait à 7 millions le nombre de personnes touchées par le chômage. En plus des bénéficiaires des ASSEDIC, le nombre des allocataires de minima sociaux n' a cessé d' augmenter pour atteindre en France 3,2 millions de personnes. Le rapport Guaino précise que les chômeurs non inscrits, parce que découragés, ceux qui ont bénéficié de préretraites, ceux qui bénéficient d' un dispositif de formation représentent une population équivalente au chiffre officiel des demandeurs d' emplois. Il faudrait encore rajouter ceux qui sont à temps partiel subi (n' ayant pas choisi leur temps partiel, ils sont partiellement au chômage), ceux qui subissent quotidiennement l' insécurité du travail (CDD, Intérimaires, emplois précaires…). En fait sur une période de 10 ans un tiers de la population active a fait, au moins une fois, l' expérience du chômage. La moitié de nos concitoyens classe le chômage parmi les 2 sujets qui les préoccupent le plus (ce taux a doublé en 25 ans). 75 % des Français se déclarent inquiets de ce risque pour eux-mêmes ou pour leurs proches.34 Le nombre de chômeurs cachés par les statistiques se manifeste lorsque dans une région un nombre d' emplois créés est conséquent. La baisse du nombre de chômeurs est inférieure à la moitié de cette quantité, parce que ces emplois sont occupés par des personnes qui n' étaient pas ou plus inscrites au chômage. Si l' on souhaitait revenir au plein emploi, il faudrait créer environ 5 à 6 millions d' emplois, ce qui, avec comme seul levier la réduction du temps de travail et compte tenu des gains de productivité cités ci-dessus, nécessiterait que chaque salarié travaille en moyenne à 60 %, voire à mi-temps. Les 2 seuls paramètres à notre disposition pour résoudre le chômage semblent peu prometteurs :
Comme le montre le tableau ci-dessous35, sur des statistiques des pays du G8, ce ne sont pas les pays où l' on travaille le moins qui affichent les taux de chômage les plus faibles.
L' analyse des chiffres bruts devrait être complétée par un indice de la qualité des emplois créés. Nous savons que les emplois créés dans les pays anglo-saxons ont fortement augmenté la précarité de la population active, que le stress dans les entreprises japonaises a atteint un sommet inquiétant. Aux Etats-Unis, le taux d' incarcération est huit fois plus fort qu' en France (8 prisonniers pour mille habitants). De 2 maux, il faut choisir le moindre. Il est sans doute préférable, pour notre société, d' indemniser un chômeur que de supporter les conséquences socio-économiques d' une incarcération. Doit-on en déduire que notre société doit se complaire, comme elle le fait depuis trois décennies, avec un taux de chômage désastreux d' un point de vue économique, incompréhensible d' un point de vue social et intolérable d' un point de vue humain ? Si tel était le cas, ce texte n' aurait pas vu le jour. Pour une autre approche du problème du chômage Aujourd'
hui plus de 70 % des salariés travaillent dans le tertiaire.
Si nous continuons sur cette lancée, les productions agricole et
industrielle seront automatisées et nous nous paierons mutuellement
pour nous rendre des services.
1.Quelle économie souhaitons-nous ? Voici quelques extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme, tous les jours bafouée, à cause de la persistance d' un taux de chômage structurel depuis de nombreuses décennies.
Grâce à notre technologie, nous sommes capables de satisfaire les besoins vitaux de l' ensemble des habitants de la planète. Dans les pays industrialisés, nous allons bien au-delà. La répartition du budget des ménages faite par l' INSEE montre que les besoins physiologiques (nourriture, logement, habillement et santé) sont satisfaits avec environ la moitié du budget d' un ménage type (avec des disparités importantes). Notre économie est largement en capacité de satisfaire ces besoins de base cités par la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme. Il est dans notre devoir de faire en sorte que chacun puisse en bénéficier. Pour cela, il y a deux solutions :
En fait, le travail n' a jamais été un droit, ce serait plutôt un devoir. La richesse est à mettre à l' actif de notre société (colonne recettes), mais les moyens d' y parvenir (le travail, l' énergie, les matières premières…) sont à mettre au passif (colonnes dépenses). Si nous considérons que 50 % de nos heures de travail sont nécessaires à satisfaire nos besoins de base et 50 % pour des besoins moins indispensables, il est logique que tout citoyen participe à cette première moitié de labeur, la seconde restant au bon vouloir de chacun. On peut se passer d' une résidence secondaire, de vacances, de voiture, … on ne peut vivre sans nourriture et soins médicaux, et le logement est également un bien indispensable à une vie digne. Si on répartit 50 % des heures travaillées sur l' ensemble des citoyens valides de 16 à 65 ans (42 millions de personnes), on obtient un temps de travail annuel de 430 heures, soit une journée de travail par semaine. Ce temps de travail laisse aux salariés le loisir d' avoir un contrat de 3 ou 4 jours par semaine avec une entreprise, pour obtenir un complément de revenu, il permet aux étudiants de poursuivre sereinement leurs études aussi longtemps qu' ils le souhaitent, aux artistes de vivre pleinement leur passion sans le souci d' obtenir un travail alimentaire… Il faut savoir ce que l' on veut ; soit une économie au service de l' homme, soit une économie au service du capital. Patric Kruissel Notes
1 Chantal Euzeby « Pistes pour une révolution tranquille du travail » Le Monde Diplomatique Avril 1998 2 Le revenu moyen d' un ménage est égal au quotient du revenu total des ménages par le nombre de ménages, tandis que le revenu médian est celui qui sépare la population en deux parties équivalentes (50 % gagnent plus que le revenu médian, 50 % gagnent moins) 4 Haut Comité de Santé Publique, La progression de la précarité en France et ses effets sur la santé, février 1998. 6 Option 45, rapport annuel 1998 : Organisme communautaire voué à l'intégration des personnes de 45 ans et plus sur le marché du travail. 8 Henri GUAINO, Robert CASTEL, Jean-Paul FITOUSSI, Chômage : le cas français, Rapport au Premier Ministre, Commissariat Général du Plan, Mai 1997. 11 Louis Chauvel, « L'uniformisation du taux de suicide masculin selon l'âge : effet de génération ou recomposition du cycle de vie ? » Revue Française de Sociologie, N°38, 1997. 15 Les coûts du crime en France, estimation monétaire des criminalités, données pour 1988 à 1991. Thierry Godefroy et Bernard Laffargue, Cesdip, n° 71, 1995 17 Brenner « Estimating the effects of Economic Change on National Health and Social Well-Being » 1984 21 Voir professeur Cary L. Cooper, professeur Paula Liukkanen, Dr. Susan Cartwright, Stress prevention in the workplace: Assessing the costs and benefits to organizations, 1996, Dublin, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. 29 Arkhipoff Oleg (1976), « Peut-on mesurer le bien-être national ? », Les Collections de l' INSEE, série C, n°41 Lien d'origine : http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/ses/vie-ses/hodebas/kruissel.html |